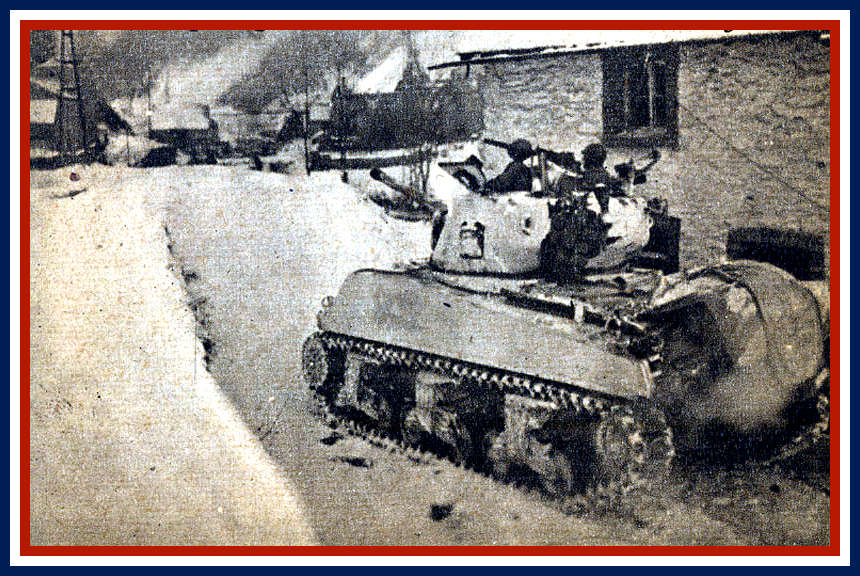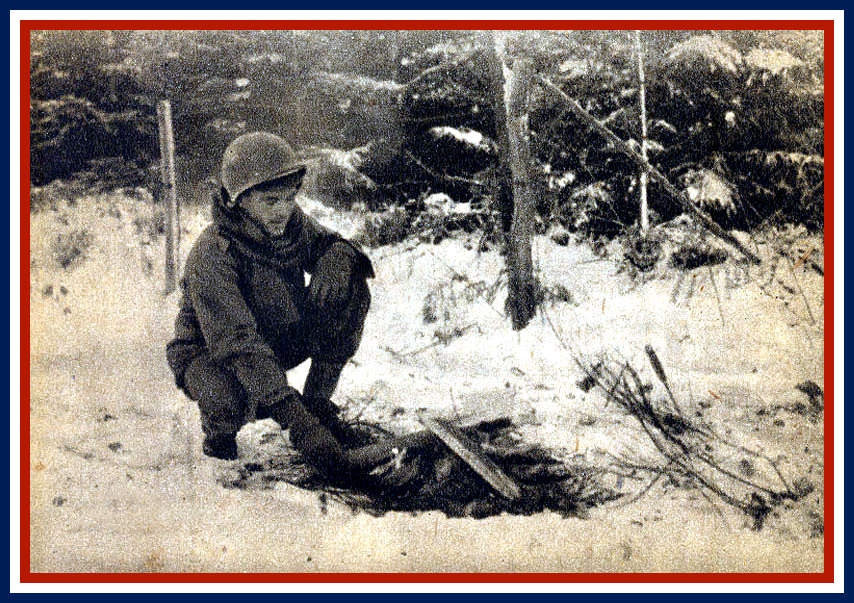Charles COACHE 1918 – 2014

Charles Joseph Maurice COACHE est né le 21 mars 1918 à Saint-Etienne du Rouvray en Seine Maritime (76).
Engagé volontaire à l’Ecole des Apprentis Mécaniciens de l’Armée de l’Air le 1er octobre 1935.
Il obtient son brevet Supérieur Mécanicien Avion le 10 novembre 1936.
Il est nommé caporal le 1er mars 1937 puis caporal-chef du personnel Non Navigant spécialiste (PNN) le 1er août 1937.
Le 1er août 1937 il est muté au Maroc et affecté à la section de l’Air à Agadir.
Le 1er août 1939 il est nommé sergent.
Le 1er novembre 1939 il rejoint le bataillon de l’air 207 sur la Base Aérienne de Marrakech.

De 1941 à 1942 il est mécanicien avion au groupe G.A.R.1/52 et on peut lire dans sa notation qu’il donne entière satisfaction à sa hiérarchie.
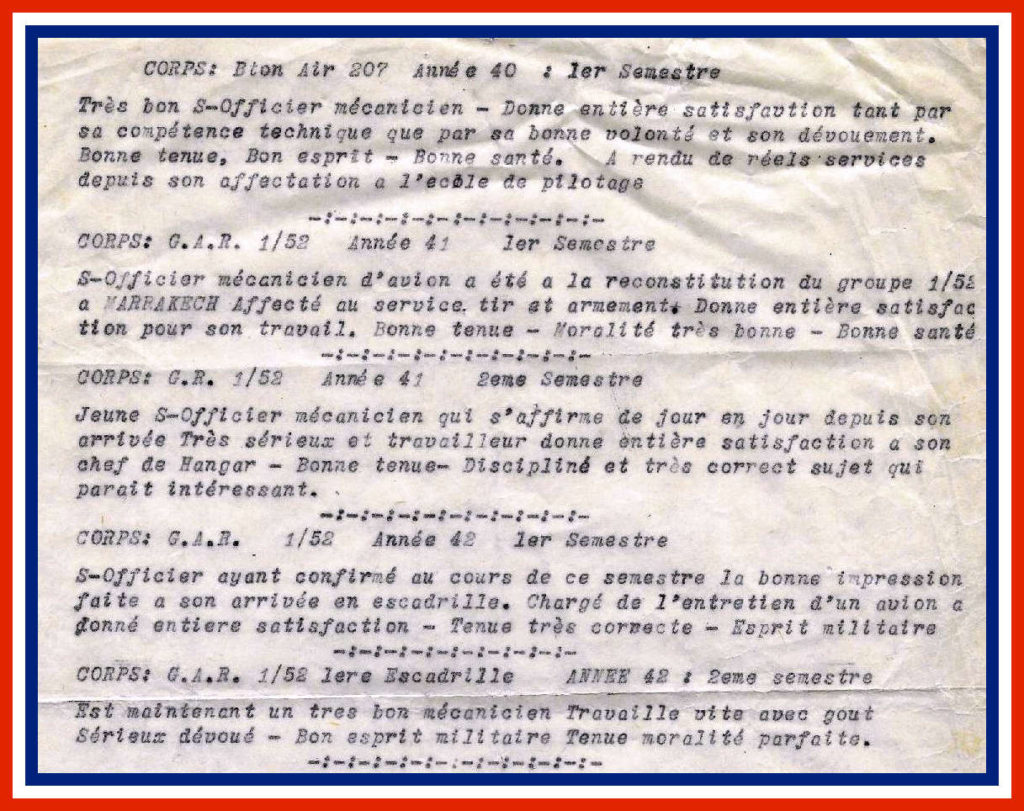
il est nommé sergent-chef le 1er mai 1943.

Volontaire pour le Bataillon de Choc, le 1er juillet 1943 il rejoint le régiment à Staouéli dans la banlieue d’Alger. On peut d’ailleurs lire à se sujet l’appréciation du commandant Lefort du Bataillon de Choc :
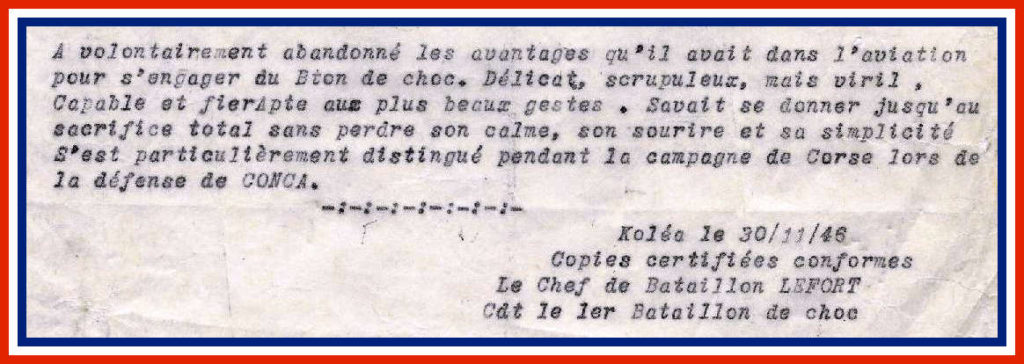
Il participe aux opérations…
…de Corse, dont la traversée avec le sous-marin « Casabianca » pour rejoindre l’île de beauté en septembre 1943 et obtient une première citation (à l’ordre de l’Armée) :
« Sous-officier de grande valeur, modeste animé du plus pur idéal et d’un dévouement absolu, auxiliaire précieux de son chef de section dans la mise sur pied d’une unité remarquablement instruite et homogène. Toujours volontaire pour toute les missions dangereuses s’est révélé comme un chef de premier plan au combat et a participé à plusieurs attaques sur les arrières de l’ennemi. Le 22 septembre 1943 lors de l’attaque allemande contre CONCA(Corse) est resté le dernier sur la position sous le feu des armes automatiques pour assurer le repli de son groupe. Est immédiatement reparti à l’attaque avec les éléments qu’il avait pu rassembler, contribua pour une grande part à l’échec ennemi. Cette citation comporte l’attribution de la Croix de Guerre 1939-1945 avec palme. »

…de l’île d’Elbe en juin 1944…
…Il est nommé adjudant le 1er juillet 1944…
… de France et d’Allemagne, du 15 août 1944 au 1er mai 1945.
Il est blessé le 1er octobre 1944 à Belfaye près de Belfort (à la tête, cuisse et au bras) et est cité le 30 décembre 1944 une deuxième fois (à l’ordre du Corps d’Armée) pour son action :
« Sous-officier animé au plus haut point de cette foi de ce courage de cette conscience qui caractérisent les combattants d’élite. Le 1er octobre 1944 quoique grièvement blessé au cours d’une reconnaissance profonde dans le dispositif ennemi a su ramener sans une plainte la patrouille qu’il commandait ne consentant à se faire soigner qu’une fois sûr d’avoir rejoint nos lignes. Son exemple marquera profondément les hommes qu’il commandait. Cette citation comporte l’attribution de la Croix de Guerre 1939-1945 avec Etoile de Vermeil. »
Lors de la campagne d’Allemagne il est blessé grièvement le 22 avril 1945 à Pfullingen (Bade-Wurtenberg) au poumon droit, et restera en convalescence jusqu’au 1er septembre 1946.
Il est nommé au grade d’adjudant-chef le 1er mai 1945.
Par décret du 20 juillet 1945 il est cité une troisième fois pour l’attribution de la médaille Militaire :
« Chef de section de tout premier plan et d’un courage exceptionnel, le 8 avril 1945 à Brotzingen(Wurtemberg) enlève magnifiquement ses hommes à la conquête de leur objectif sous un tir d’armes automatiques ennemies particulièrement meurtrier. Le 16 avril à Berneck, se distingue de nouveau au cours des combats de rues. Le 22 avril 1945, chargé avec sa section de protéger les chars de tête, est très grièvement blessé d’une balle en pleine poitrine alors qu’il pénètre le premier à Pfullingen. Cette concession comporte l’attribution de la Croix de Guerre 1939-1945 avec palme. »
Il rejoint son unité; le 1er bataillon du 1er Régiment d’infanterie de Choc Aéroporté à Kolea en Algérie.
Il quitte définitivement l’armée le 4 novembre 1946.
A son retour à la vie civile il travaille au Maroc, comme responsable comptable pour l’entreprises Schlumberger, puis dans la Société SAUT du Tarn à Casablanca.
Il décède à Paris le 10 août 2014 à l’âge de 96 ans.

Ses décorations :
Officier de la Légion d’Honneur,
Commandeur dans l’ordre National du Mérite,
Médaille Militaire,
Croix de guerre 1939-1945 avec Palmes et Etoile de vermeil.



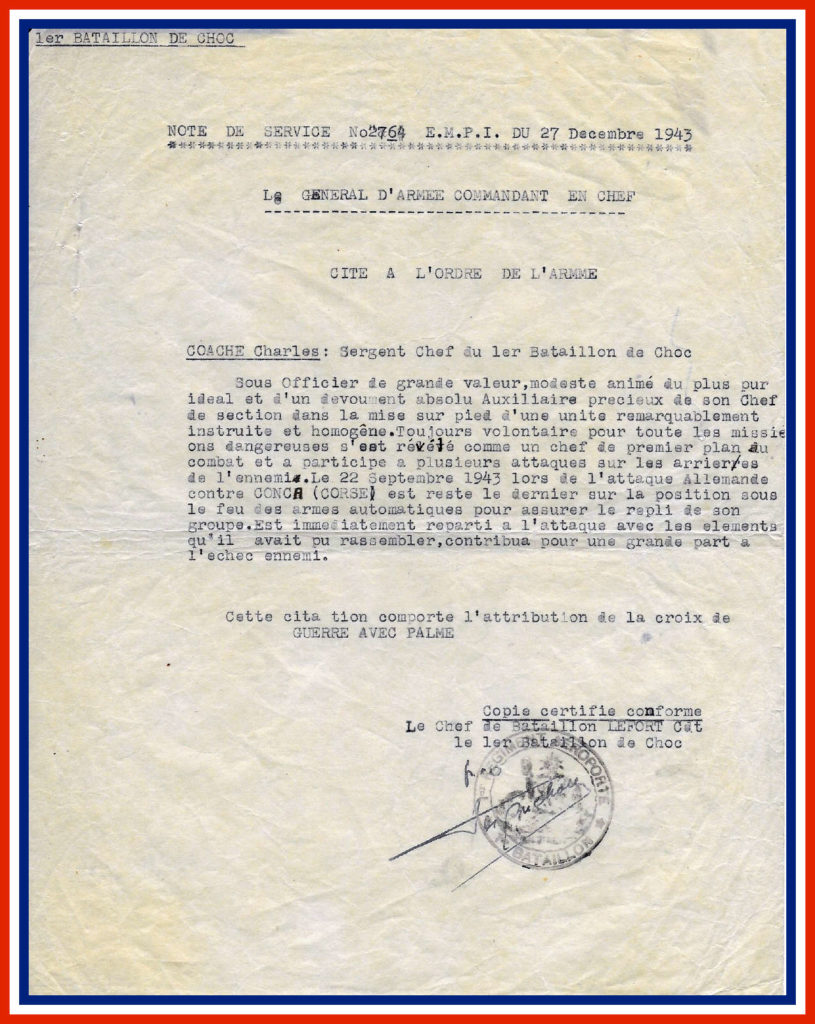
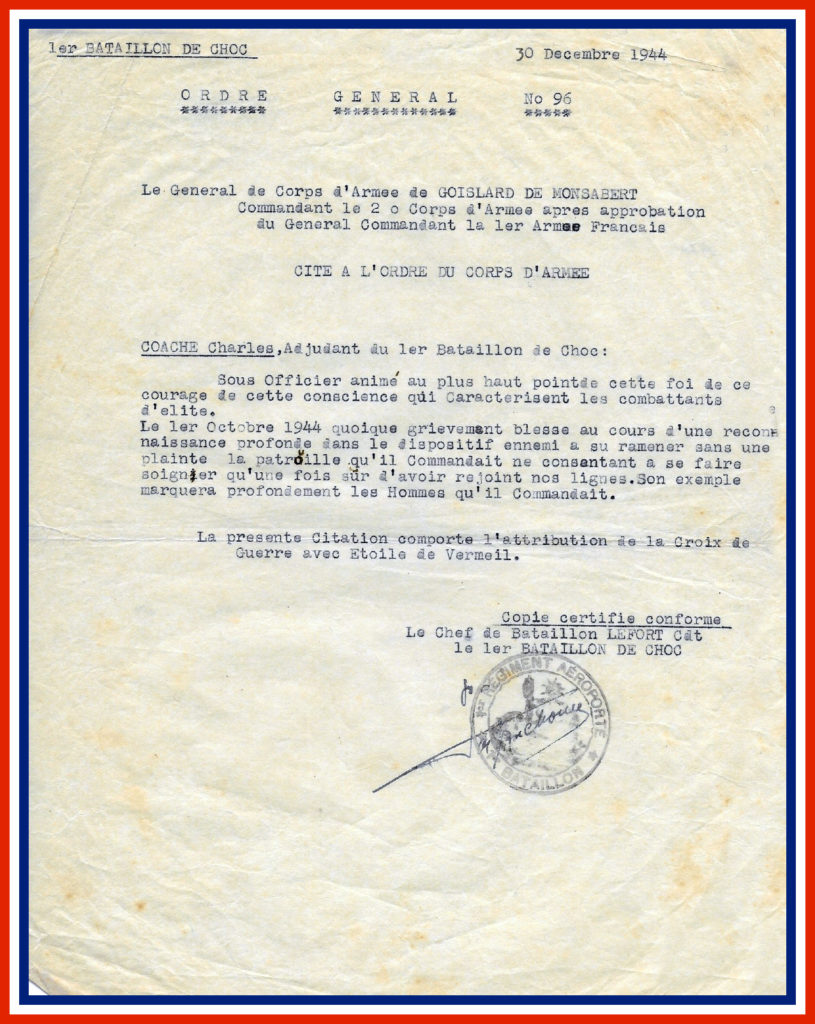
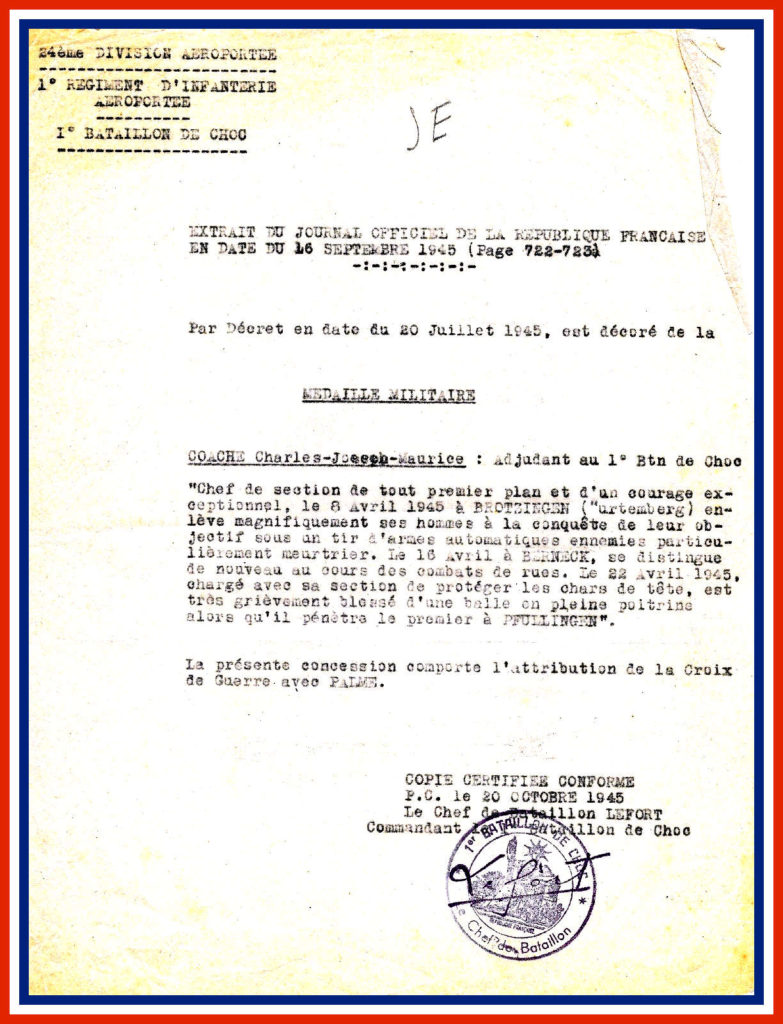
Nous remercions Henri Simorre, grand spécialiste du Bataillon de Choc pour les informations et photos mises à disposition pour la rédaction et l’illustration de ce portrait.
Si l’Histoire du bataillon de Choc vous intéresse : https://1erbataillondechoc.forumactif.com/
Raymond LUQUET 1923 – 2011

Raymond Louis Léon LUQUET est né le 2 juin 1923 à RABAT au Maroc.
Il rejoint le Chantier de Jeunesse n°101 le 29 janvier 1943.
Il s’engage au 1er Régiment de Tirailleurs Marocains (1 RTM) le
12 avril 1943 où il est affecté à la Compagnie Spéciale de
Quartier Général le 11/5/43 à Staouéli en Algéri.
Il passe au Bataillon de Choc le 28 mai 1943 (matricule 141) et est affecté à la 2ème Compagnie.
Le 13 septembre 1943 il embarque à ALGER et débarque à Ajaccio en Corse le lendemain, où il combat avec la 2ème Cie.
Il est nommé Caporal le 1 juillet 1944.
La 2ème Cie du Capitaine Lefort débarque sur l’île d’Elbe le 17 juin 44 à 1 heure du matin et assure la couverture entre San Piero in Campo et Fontana. C’est lors de ces combats que le chasseur Raymond Luquet gagne sa première citation, à l’ordre de la Division :
« Tireur au F.M. possédant un grand sang-froid et un coup d’œil remarquable. Ne pouvant mettre son arme en batterie alors qu’il progressait au milieu de cultures, fit feu en épaulant son F.M. sur des ennemis qu’il aperçut à 200 mètres environ. En abattit un et provoqua la dispersion des autres ».
La présente citation comporte l’attribution de la Croix de Guerre 1939-1945 avec étoile d’argent.
De retour en Corse, il se prépare avec son unité au débarquement en Provence. Le Bataillon de Choc ne sera pas de la 1ère vague, exceptés la section des lieutenants CORLEY- MUELLE (30 hommes) parachutée sur la Drôme les 31 juillet et 1er août et les 10 Chocs parachutés le 15 août sur LE MUY, avec plus de 5000 paras Anglo-Américains.
Le Bataillon débarque en Provence le 19 août et combat dans Toulon. La caporal Raymond LUQUET est cité à l’ordre de la Brigade :
« Tireur au F.M. à sous un feu précis et terriblement violent de l’ennemi protégé la progression de son groupe devant l’Arsenal de Toulon le 22 août 1944. En a également protégé le repli en restant volontairement le dernier sur le terrain battu par les armes automatiques ennemies ».
La présente citation comporte l’attribution de la Croix de Guerre 1939-1945 avec étoile de bronze.
Puis c’est la montée de la vallée du Rhône vers Dijon (septembre 1944), les durs combats des Vosges en octobre 1944.
Le 1er novembre 1943 il est nommé Caporal-Chef.
Le 20 novembre 1944 il se bat dans Belfort, avant la rude campagne d’Alsace où il prend le commandement de son groupe suite à la mort de son Sergent-chef et mène ses hommes au combat dont Jebsheim (68) où le 30 janvier 1945 le bataillon perd en une seul matinée 32 hommes qui sont tués (dont 6 Officiers) et une centaine d’autres qui sont blessés (dont 10 Officiers).
Le 1er Février le Bataillon de Choc doit relever à Durrenentzen(68) le Commando de France qui a eu de lourde perte la veille dans sa tentative de prise du village (53 morts et un nombre très important de blessés).
Le Bataillon arrive à enlever le village au prix de 10 morts supplémentaires et plusieurs blessés dont Raymond qui est grièvement blessé lors de l’assaut d’une barricade ennemie. Il est évacué vers un hôpital militaire de campagne à l’arrière du front (Saint Dié?).
, citation à l’ordre de la Division , croix de guerre étoile d’argent.
Il retrouve le Bataillon de Choc en Allemagne le 2 mai 1945 tout juste pour traverser la frontière autrichienne où il termine la guerre le 8 mai 45 avec ses camarades à Dalaas et fêtent la fin des combats : immense joie d’être en vie mais immense tristesse également pour tous les camarades perdus qui ne sont plus là…
Le 1er juillet 1945 il reçoit ses galons de Sergent.
Les reliquats des 6 Bataillons de Choc de la 1ère Armée française vont former le 1er Régiment d’Infanterie de Choc Aéro-Porté (1 R.I.C.A.P.) et regagnent la France au camp de la PALU à Bordeaux.
Le Sergent LUQUET embarque à Marseille le 2 novembre 1945 et débarque au Maroc le 4. Il regagne son foyer dans la capitale marocaine, à RABAT le 10 décembre 1945.
Il reprend du service en Algérie quelques années plus tard.
Il décède le 27 septembre 2011 à Evian-les-Bains(74).
Ses décorations :
La Croix de Guerre 1939-1945 avec 3 étoiles,
La Médaille des blessés avec un étoile,
La médaille Commémorative 1939-1945 avec agrafes Italie France Allemagne,
La médaille Commémorative A.F.N avec agrafes Maroc et Algérie.
Nous remercions Henri Simorre, grand spécialiste du Bataillon de Choc pour les informations et photos mises à disposition pour la rédaction et l’illustration de ce portrait.
Si l’Histoire du bataillon de Choc vous intéresse : https://1erbataillondechoc.forumactif.com/
Pierre MASSON 1921 – 1944
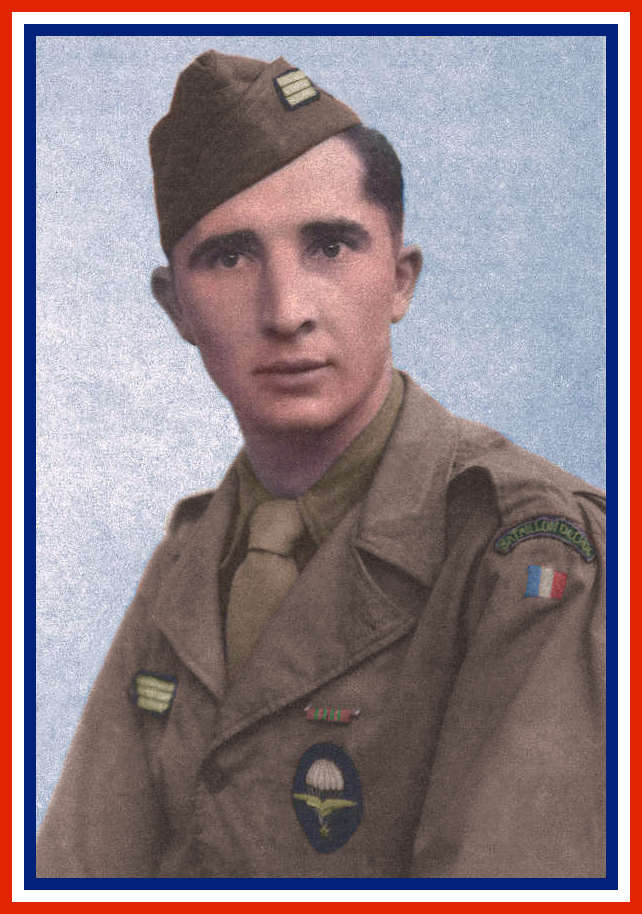
Fils de Charles Masson, originaire de Sommevoire, et de Marie-Louise Marchand, native de Droyes, Pierre Masson naît le 23 février 1921 à Montier-en-Der, rue Audiffred.
Il est le cadet de trois enfants. Sa famille s’installe rapidement à Brousseval (aux Cités du Maroc), où son père travaille aux haut-fourneaux et fonderies, et où Pierre réussit son certificat d’études en 1933.
En octobre de la même année, il intègre l’école des enfants de troupe à Autun, avec son ami Jean-Marie Héritier (futur maire de Brousseval, ancien interné du camp de Rawa-Ruska). Deux autres jeunes du village rejoignent cette école : Gilbert Vernet (vétéran des campagnes d’Italie, de France et d’Allemagne, futur lieutenant-colonel), et Fernand Collignon (héros des maquis de l’Ain). En 1934, Pierre Masson entre à l’école militaire préparatoire d’Epinal puis s’engage pour cinq ans le 23 février 1939. Affecté au 150e régiment d’infanterie à Verdun, sergent le 23 mars 1940, il est muté au 332e RI et détaché au centre d’instruction divisionnaire 56, comme chef de groupe.
Le 18 juin 1940, il défend la Meuse, et est capturé à Traveron. Interné dans un stalag Outre-Rhin, il s’évade le 12 juillet 1942, se présente aux autorités militaires à Lyon, et obtient une nouvelle affectation : le 11e régiment de tirailleurs algériens, qu’il rejoint à Fès (Maroc) le 10 avril 1943. Muté au 7e RTA, il intègre finalement le Bataillon de choc du commandant Gambiez, où il est promu sergent-chef le 15 juin 1944 et où il décroche le brevet militaire de parachutisme n°6634.
Le sous-officier haut-marnais est affecté dans la section Corley, où sert l’aspirant Raymond Muelle. Initialement destinée au Vercors, cette unité est finalement parachutée les 31 juillet et 1er août 1944 près de Dieulefit, dans la Drôme, soit quatorze jours avant le débarquement de Provence. Au sein de son groupe, Masson a sous ses ordres un futur ministre de l’Intérieur, le caporal-chef Michel Poniatowski.
Il est cité à l’ordre du régiment pour sa conduite le 21 août 1944 lors du combat de Pont-de-Claix (Isère), tuant le major allemand commandant la localité. Pierre Masson se distingue encore les 8 et 9 octobre dans les combats sous-bois de Château-Lambert, en Haute-Saône (citation à l’ordre de la division).
Il fait un saut à Gevrey-Chambertin (Côte-d’Or) pour rendre visite à sa sœur ainée et sa mère, puis retrouve son unité en Haute-Saône.
Le 9 novembre 1944, en revenant d’une patrouille de nuit dans la forêt de Chérimont, le chef de groupe saute sur une mine avec deux de ses hommes, dont le caporal Gérard Verguain. Tous trois décèdent le jour même à l’hôpital de Lure.
Le sergent-chef Masson repose depuis 1949 dans le cimetière de Brousseval, où une exposition concoctée par le club Mémoires 52 lui rendra hommage en 2001.
La même année, son nom a été donné à une promotion de l’école nationale de sous-officiers de Saint-Maixent. Coïncidence : une autre promo de cette même école a été baptisée du nom d’un autre sous-officier haut-marnais du Bataillon de choc, le sergent-chef André Mugnier, tombé en Allemagne le 22 avril 1945. Sources : supplément n°29 de Dossier 52 (2001).
Source : http://memoires52.blogspot.com/2013/07/pierre-masson-un-brave-du-bataillon-de.html
Michel DURRMEYER 1916 – 1945
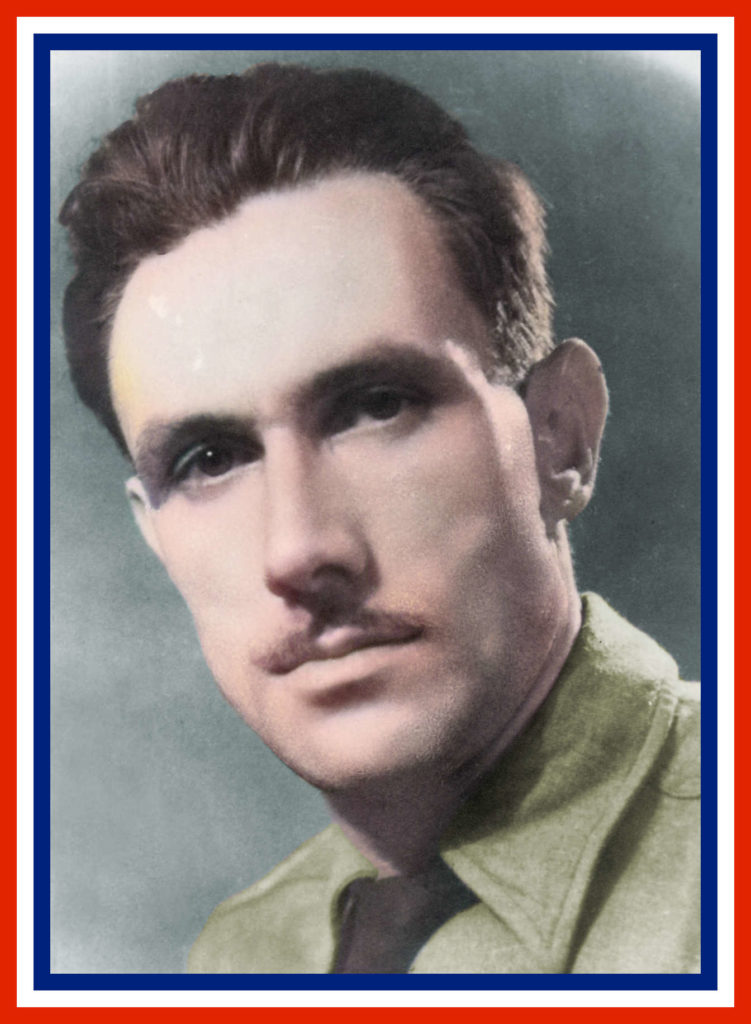
Il est né le 16 avril 1916 à Marseille dans les Bouches-du-Rhône.
Il est l’un des ainés d’une fratrie de 7 garçons et une fille. Ils sont élevés un peu à la mode militaire mais avec beaucoup d’affection. Son père Robert Durrmeyer(1877-1954) est Général de Division. Il est arrêté par la Gestapo, déporté au camp de concentration de Plansee. Il est libéré par les Alliés.
Avant guerre il commence à préparer l’Ecole des Chartes avant de changer d’orientation et devenir étudiant en Médecine (2 ans).
Il est mobilisé en septembre 1939 à l’Ecole d’application du Génie de Versailles.
Il nommé au grade d’Aspirant en avril 1940.
Il est fait prisonnier le 22 juin 1940 à Cerqueux, dans le Maine-et-Loire et interné au camp de prisonniers « Stalag 1A » en Prusse orientale.

Il tombe gravement malade, et est rapatrié sanitaire en France en mars 1942.
A Lyon, il participe activement à la Résistance en créant avec ses amis une imprimerie clandestine où ils fabriquent des faux papiers. Jusqu’à l’invasion de la zone libre par les troupes allemandes en novembre 1942, il s’occupe également d’une filière d’évasion vers l’Espagne.

Fin 1942,décide avec son frère de rejoindre l’Afrique du Nord et traverse à son tour la frontière espagnole où il est arrêté et interné plusieurs mois.
Après sa libération des geôles Franquiste, il rejoint le Maroc en montant à bord du « Gouverneur Général_Lépine ».

Le 6 juin 1943, il s’engage comme Aspirant au Bataillon de Choc nouvellement créé à Staouéli en Algérie.

Il prend le commandement de la 2ème section de la 2ème Compagnie.
Le 14 septembre 1943, il débarque avec ses hommes en Corse et obtient sa première citation le 1 octobre 1943 :
« Excellent chef de section, a fait toute la campagne en Corse, malgré les plus vives souffrances causées par un état physique défectueux. Très audacieux et cependant toujours pondéré et calme, le 01/10/1943, après s’être infiltré dans les positions ennemies dans le défilé de Lancône (Corse), a surpris un petit poste ennemi lors de son décrochage et a capturé avec l’aide de 2 hommes de sa section 6 soldats de ce poste ».
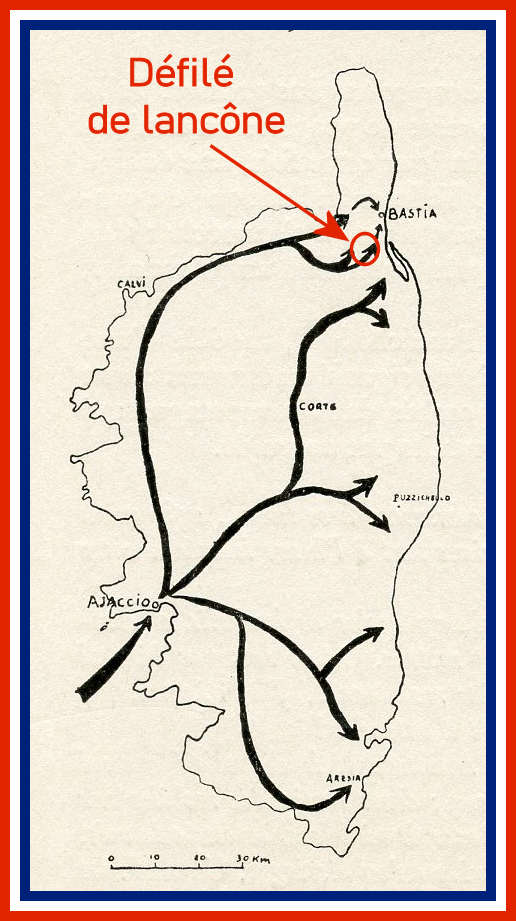
La présente citation comporte l’attribution de la Croix de Guerre 1939-1945 avec étoile de vermeil.
Une fois la Corse libérée, le Bataillon de Choc poursuit son entrainement
Les sections sont à tour de rôle, envoyées à Staouéli(Algérie) pour effectuer les 4 sauts minimum en parachute afin d’obtenir le brevet parachutiste.
Promu Sous-lieutenant, il se distingue lors des opérations de l’île d’ELBE, et pour son action le 17 juin 1944, il est décoré de la Croix de Chevalier de la Légion d’Honneur :
« Chef de section d’élite d’une audace sans pareille, d’un sang-froid et d’un courage au-dessus de tout éloge. Le 17 juin 1944, à l’île d’Elbe, a enlevé le PC de San Pietro Di Marino et poussé hardiment jusqu’à Marciana Marina, anéantissant ou faisant prisonniers les détachements chargés de faire sauter le pont de Bagnio. Au cours d’une reconnaissance ultérieure, étant tombé à l’improviste au milieu d’un nid de mitrailleuses, a fait prisonniers à lui seul les servants. A ensuite, avec un groupe de combat, en coopération avec une section de Sénégalais, fortement contribué à la chute du point d’appui de Procchio, enlevant 2 mitrailleuses. A tué 5 ennemis et fait 34 prisonniers »
Cette nomination comporte l’attribution de La Croix de Guerre 1939-45 avec Palme.
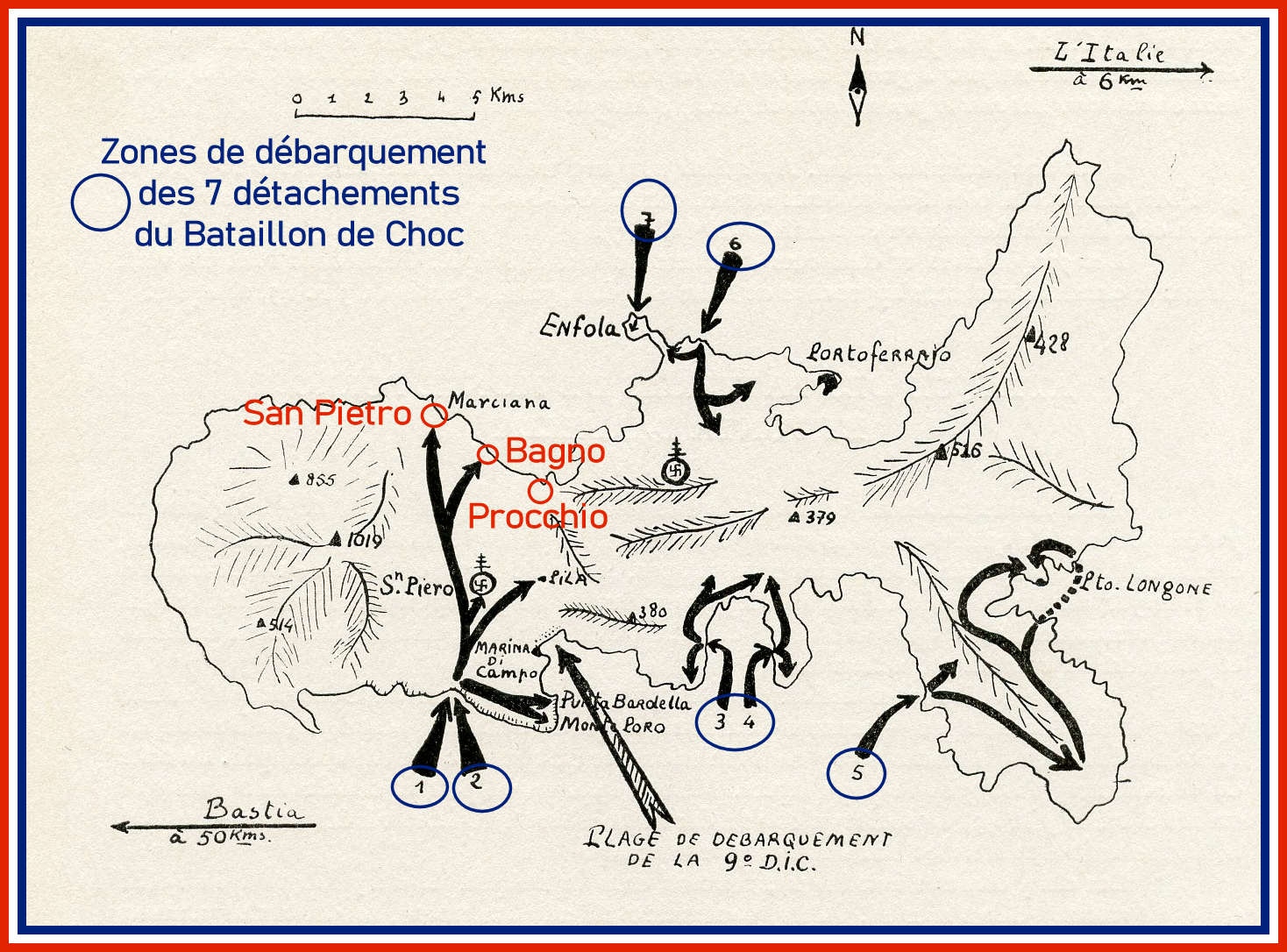
De retour en Corse, le Bataillon se prépare pour le débarquement de Provence à venir.

Le Bataillon de Choc débarque à son tour, en Provence le 19 août 1944 et Participe aux combats de Toulon.
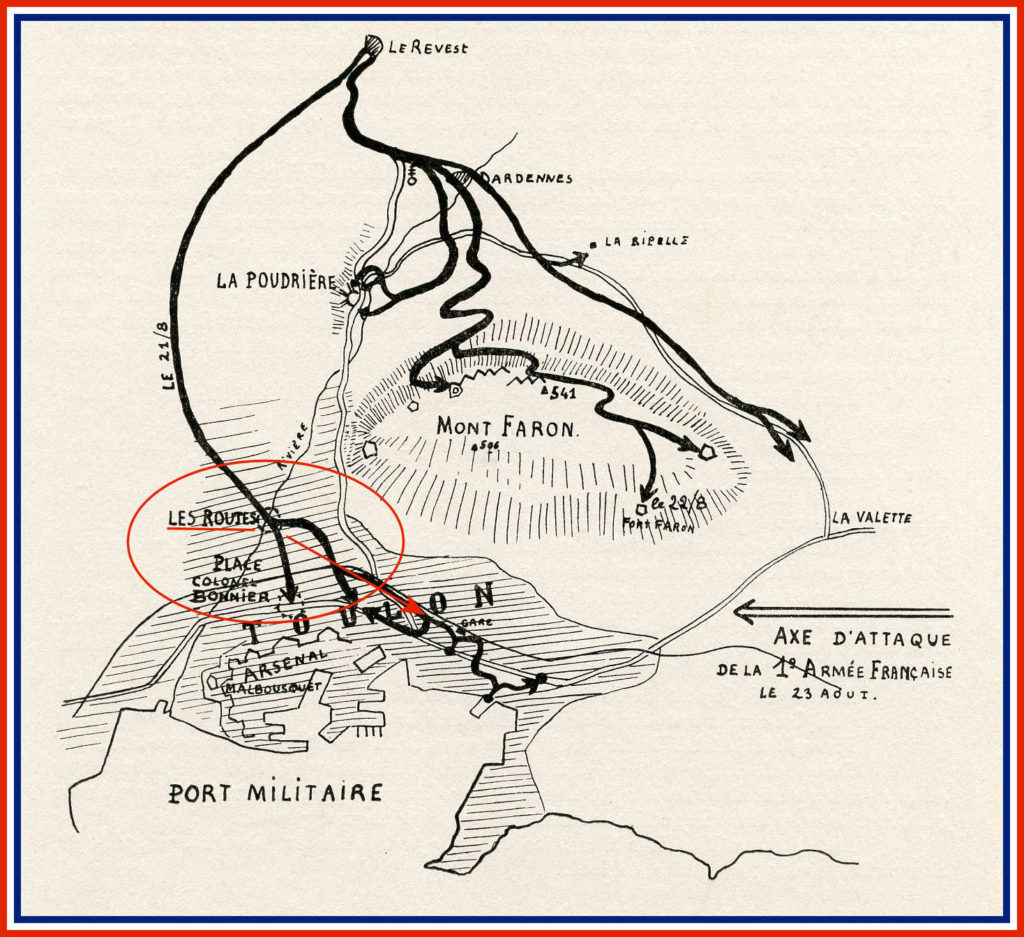
Le Sous-Lieutenant Durrmeyer est cité une troisième fois, à l’ordre du Régiment :
« Officier d’un calme et d’une audace extraordinaire. Dans la journée du 21 août 1944, n’a pas arrêté de pourchasser l’allemand dans les rues et jardins compris entre les Routes et l’Escallion (faubourg de Toulon) et fait refluer devant lui toute une section allemande, lui causant personnellement une dizaine de pertes. Patrouillant sans arrêt dans cette région, a créé chez l’ennemi un désordre inouï, lui faisant croire à une forte occupation de notre part ».
La présente citation comporte l’attribution de la Croix de Guerre 1939-1945 avec étoile de bronze.
Il est également proposé à cette occasion pour la Silver Star, décoration de l’Armée américaine :
« Jeune officier dont la bravoure et l’audace font l’admiration de tous. Toujours en pointe, ardent, agressif, a brillamment réussi dans toutes les missions de choc qui lui ont été confiées. Au cours de violents combats de rue dans Toulon, a infligé à un adversaire acharné et supérieur en nombre des pertes sévères et pénétré de vive force avec sa section jusqu’au cœur même de la ville ».
En Septembre 44, lors des combats pour la libération de Dijon il est blessé d’une balle dans la cuisse à Talant (côte d’or)…
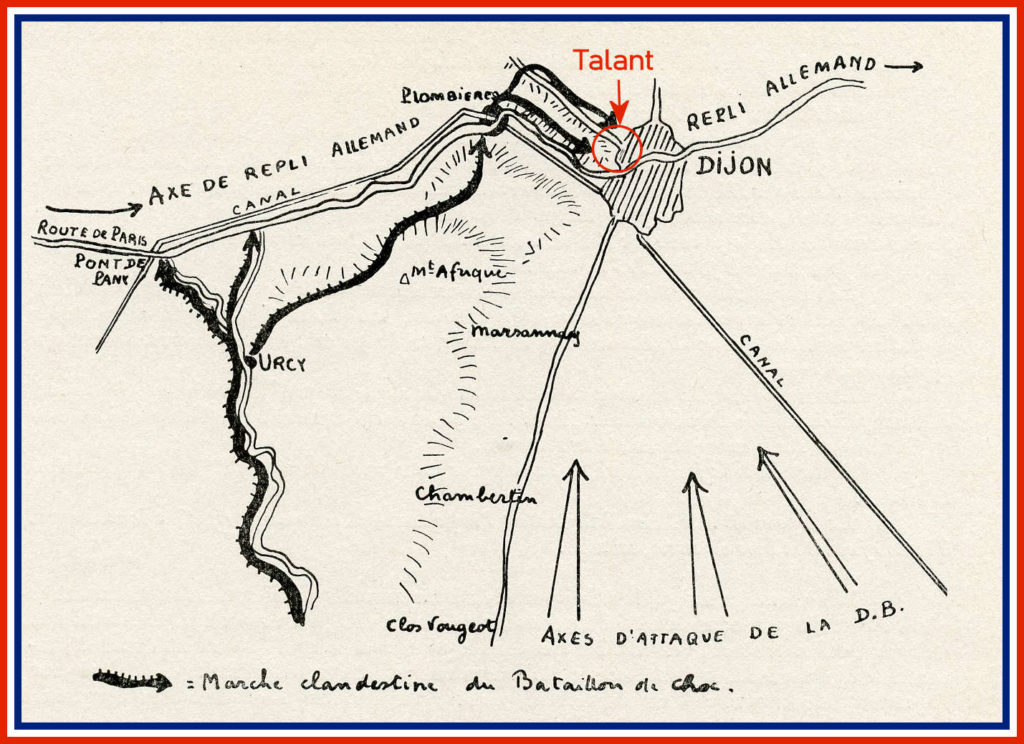
…une nouvelle citation :
« Officier d’une haute valeur morale et spirituelle, portant au plus haut point ses qualité de chef et d’entraîneur d’hommes. Le 10 septembre 1944, au cours de la progression de Dijon, a été blessé après avoir ordonné le repli de sa section, en évacuant le dernier une position rendue intenable par de violents feux d’armes automatiques ».
La présente citation comporte l’attribution de la Croix de Guerre 1939-1945 avec étoile de Vermeil.

Il est de tous les combats et toujours en pointe avec ses hommes…en octobre 1944 lors de la campagne des Vosges.

En novembre 1944 il participe aux combats pour la libération de Belfort et ensuite la campagne d’Alsace, c’est un exemple pour tous !

Comme 371 autres soldats du Choc, il reçoit la médaille de Belfort réservée aux premiers soldats entrés dans Belfort le 20 novembre 1944 (1274 médailles sont décernées mais uniquement aux combattants entrés dans la ville le 20 novembre 1944 des unités suivantes : 1er Bataillon de Choc, 6e Régiment de Chasseur d’Afrique, 10e Cie du Régiment de Marche de la Légion étrangère, 1ère Section du Génie 96-3, 1er Commando d’accompagnement, groupe de Commando de France ).
Il est cité à l’ordre de l’Armée :
« Chef de section remarquable au feu par son sens du combat, son sang-froid et son extraordinaire courage. S’est particulièrement distingué le 20 novembre 1944 en prenant pied avec sa section dans Cravanche, le premier, et à l’entrée de Belfort. A enrayé une contre-attaque allemande et tenu jusqu’à l’arrivée des chars. A pénétré avec eux dans la ville et s’est porté en combattant jusqu’au pont Clémenceau. Le 21 novembre 1944 a participé au nettoyage de la manutention et du parc d’artillerie faisant au cours de cette opération plus de 20 prisonniers. Le 25 novembre, à Etueffont Haut, a pénétré au petit jour dans le village poursuivant et chassant les allemands qui le défendaient. A réussi à encercler 12 d’entre eux et à les capturer. »
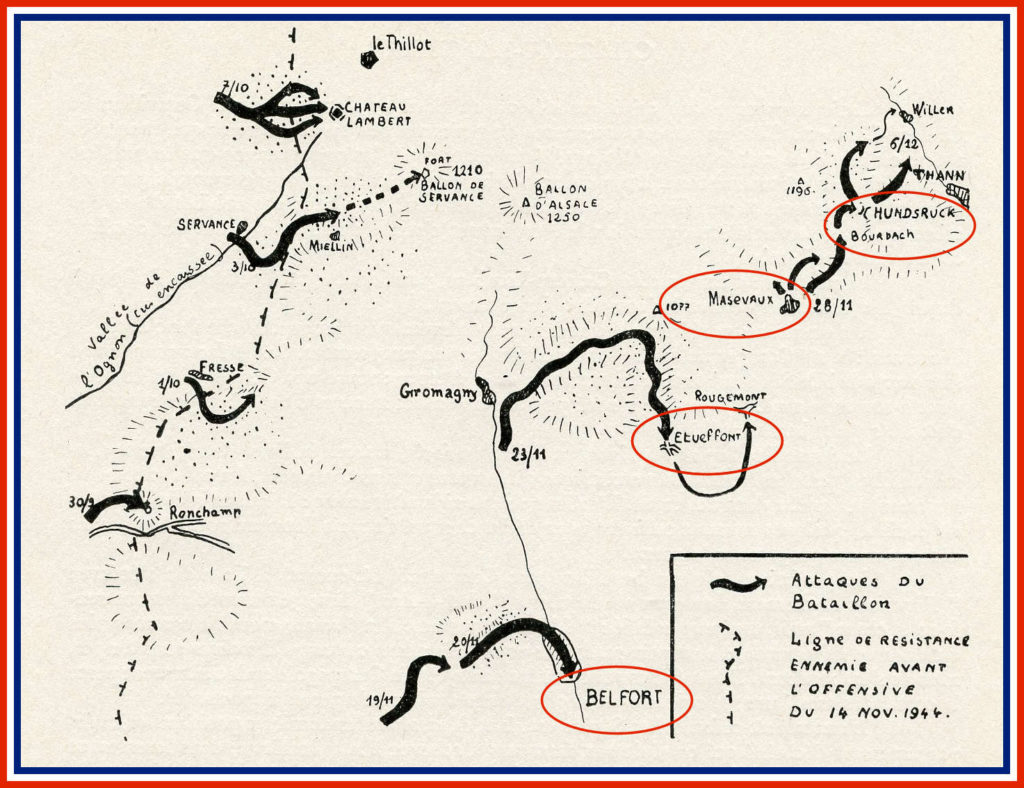
En Novembre 1944 il combat à : Etueffont , Masevaux , Bourbach le Haut , au col du Hundsrück.


Le 6 décembre1944, le Bataillon de Choc laisse le col du Hundsruck aux Tirailleurs et se rend à Froideconche pour un repos bien mérité.
Le 18 décembre 44 le Choc arrive à Delle (territoire de Belfort).
Le 21 janvier 45 « les Chocs » quitte Delle à 11 heures pour arriver le lendemain à 3 heures du matin à Molsheim (67).
Dans la nuit du 22 au 23 le Bataillon part pour Kronenbourg près de Strasbourg où il doit être engagé mais l’ordre est
annulé.

Le 28 janvier 1945 le Choc arrive à Sélestat(67), et doit aller se battre à Jebsheim. Ils ne le savent pas encore, mais le 30 janvier 1945, ce sera « le tombeau » du Bataillon de Choc.
Arrivé en camions à 7h du matin, ce 30 janvier ils s’élancent depuis le sud du village de Jebsheim à peine libéré vers 8h du matin, sans soutien d’artillerie et accompagné de quelques blindés. Leur mission : parcourir 2500 mètres à découvert, avec 50cm de neige, par moins 20 degrés, pour prendre la ligne défensive allemande adossée au canal en direction du Rhin.
Le Capitaine LEFORT, commandant le Bataillon de Choc essaye de faire reporter cet assaut considérant que les moyens ne sont pas suffisants et le Choc n’a pas d’armement lourd…. contrairement à la ligne de défense allemande.
Il lui a été sèchement répondu : « C’est un ordre ! »
Les 4 compagnies s’élancent alors, dont la la 2ème Compagnie, aux ordres du Capitaine TOCE, qui est engagée à gauche du dispositif …avec quelques chars et half-tracks des Chasseurs d’ Afrique et de la Légion.
Une pluie d’obus et de balles s’abat sur toutes les compagnies.
Le Lieutenant Durrmeyer tente de renseigner le chef de char français qui les accompagne vers la position allemande, malheureusement pour eux un projectile antichar explose à proximité et le Lieutenant Durrmeyer est grièvement touché.
L’ Aspirant Neble vient à son secours et le prend sur ses épaules pour le conduire à l’arrière, hélas, un deuxième obus tombe sur eux et il tue Robert Neble sur le coup.

Pendant plusieurs heures les soldats sont cloués sur place (impossible d’avancer ou de reculer)… puis avec l’aide de certains conducteurs de blindés et d’ambulances, qui prennent tous les risques pour leur venir en aide, les soldats encore en états ou blessés, peuvent reculer vers leur point de départ, en s’abritant derrière les véhicules.
Les pertes sont très lourdes avec trente deux tués dont six Officiers, cent blessés (dont 10 officiers) et plus quarante hommes évacués pour cause de pieds gelés.
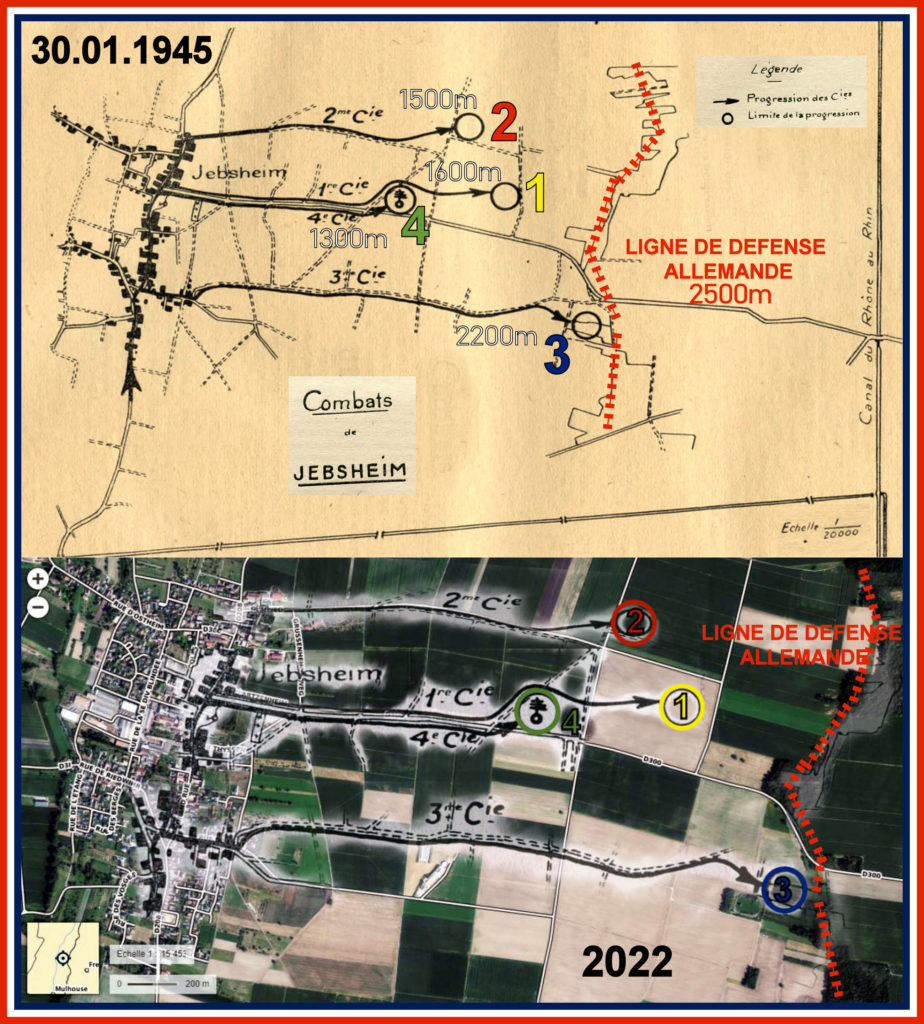
Résultat de cette opération : Après avoir avancé péniblement entre 1500 et 2300 mètres en fonction des compagnies, un déluge de feu (mitrailleuse, mortier, char…) s’abat sur elles, les blindés sont touchés et se retirent…Le Bataillon de Choc n’atteindra jamais l’objectif fixé et subit de très lourdes pertes…pour rien !
Ainsi disparaît dans le feu de l’action, Michel Durrmeyer, un brave parmi les braves, dans sa 29ème année, en pointe toujours, avec l’ardeur et le sens du sacrifice qui le caractérise.
Pour son action au service de la France et son sacrifice ultime, Michel Durrmeyer est fait Compagnon de la Libération à titre posthume par décret du 20 janvier 1946.
Il ne connaîtra pas la joie de la victoire finale du 8 mai 1945, mais il aura participé grandement à la libération du territoire nationale du joug nazi.
Le Lieutenant Durrmeyer meurt peu de temps après lui….Il est enterré provisoirement au cimetière de Jebsheim.
C’est la tombe n°24 qui se trouvait entre celle du chasseur Josephus Schevenels (n°23) né à Borgerhout en Belgique en 1905 et de l’Aspirant Robert Neble (n°25) né au Maroc en 1923, visibles sur la photo ci-dessous.
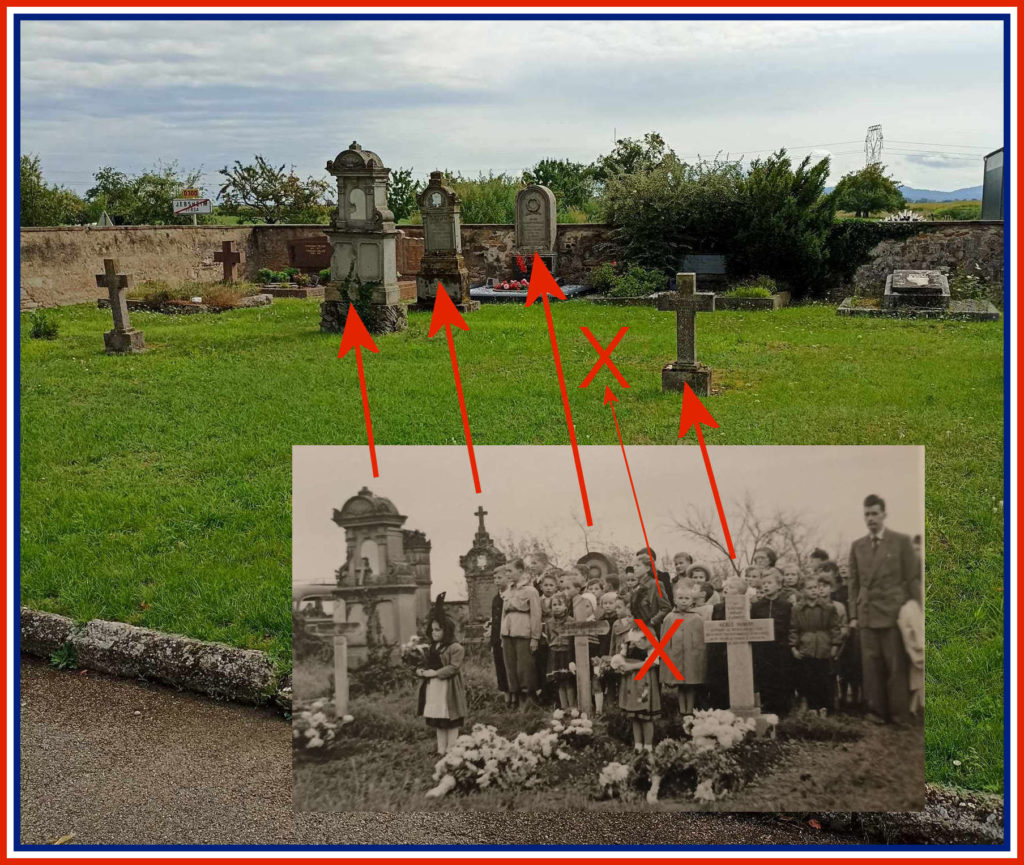
La famille ne récupère son corps le 16 août 1947, pour l’inhumer dans le caveau familial. Il repose depuis au cimetière communale de Saint-Baudile à Nîmes.

Compagnon de la Libération à titre posthume
Chevalier de la Légion d’Honneur
Croix de guerre 39/45, 6 citations
Silver Star (US)
Médaille des blessés
A titre posthume :
Médaille Commémorative 39/45 (1946)
Médaille du Combattant Volontaire (1953)
Médaille commémorative de la Campagne d’Italie pour l’île d’Elbe (1953)
Médaille du Combattant volontaire de la Résistance (1954)
Tous nos remerciements :
A Christian DURRMEYER , neveu du Lieutenant , qui a partagé ses souvenirs familiaux.
A Henri Simorre, Mémoire du Bataillon de Choc pour les informations et photos mises à disposition pour la rédaction et l’illustration de ce portrait.
Si l’Histoire du bataillon de Choc vous intéresse : https://1erbataillondechoc.forumactif.com/
En complément :
En 1975 dans le cadre de l’inauguration future d’une rue de Jebsheim en hommage au sacrifice du lieutenant Durrmeyer les anciens du bataillon de Choc recherchent des témoignages le concernant. C’est à cet occasion là qu’en avril 1975, Marcel Deillas, Chasseur depuis 1943 dans la 2ème section de la 2ème Cie du Lieutenant DURRMEYER, rédige les lignes suivantes (lettre retrouvée en 2023 dans les archives de la commune de Jebsheim) et qu’il nous décrit un homme d’exception au service de la France :
Dès notre premier contact, j’ai compris que non seulement je ne l’oublierais jamais, mais que bien plus encore je m’en souviendrais toujours, Trente ans ont passé, et c’est avec une certaine nostalgie que souvent, bien souvent encore, je le revois et je lui parle. Comme au bon vieux temps nous conversions. Son timbre est toujours grave, étrangement calme et reposant, son regard est toujours droit et me sonde comme en ce jour de Mai 1943 où…Il m’attendait dans une petite pièce de notre cantonnement de Saouéli. Son oeil profond, légèrement enfoncé dans l’orbite, d’un marron foncé presque noir, sous des sourcils en bataille dominés d’un front haut, surmonté lui-même d’une abondante chevelure brune rejetée en arrière. Les joues sont creuses, les pommettes saillantes. Il traine encore les stigmates de son passage dans les geôles espanoles qu’il n’a malheureusement que trop connues. Sur sa bouche un peu gourmande, la moustache, petite et finement taillée, se veut un petit air conquérant.
Je viens d’être muté à sa section : la 2ème de la 2ème Compagnie, je me présente. Ce qui tout de suite retient mon attention, c’est son regard. Il le plonge longuement, très longuement dans le mien, Sans une parole. Puis, toujours muet, il se lève, fait deux pas en avant et me tend la main, Sa poignée de main est ferme, franche, presque virile. Je sens qu’il veut me marquer, m’apprendre quelque chose que je dois saisir Immédiatement. Effectivement, il est Lieutenant, je suis homme de troupe, Je n’ai guère été habitué à de tels comportements. Ces choses vous marquent… profondément. Ce genre d’homme retient l’attention. Il veut et sait créer des liens de la meilleure qualité. Assez grand, légèrement au dessus de la moyenne, des jambes assez longues, i1 émane de toute sa personne ce sentiment de tranquille assurance, de puissance communicative et de réconfortant équilibre auquel on est oblige d’accorder confiance. La mienne… i1 l’a prise d’emblée, je le crois à cet instant. Il la conservera toujours.
Puis, il rompt enfin le silence. Ce silence commençait à me peser, bien que j’eusse senti son désir de me jauger :
“Vous avez fait acte de volontariat pour les parachutistes; c’est bien, Cela seul mérite que je vous adresse des félicitations mais je ne veux rien vous cacher. Je ne sais de quoi demain sera fait. Ce sera dur, très dur, plus que dur que vous ne pouvez le supposer. Ce ne sera pas de tout repos, vous connaissez les risqué que vous prenez. Ils sont considérables; les servitudes seront plus grande encore. Je vous avise, c’est mon devoir. Nous allons en baver ensemble, et ce sera si inhumain, que chez nous, il n’y aura pas de place pour les faibles. Vous devez comprendre dès aujourd’hui. Je ne veux pas avoir à commander, mais tout simplement à demander, beaucoup, énormément. Pour des gens comme nous qui venons pour un même but d’horizons different qui avons les memes aspirations, les memes espoirs et qui envisageons de revoir enfin les memes horizons, cela devrait largement suffire. En consequence je dois obtenir le maximum et même plus encore si possible. Je suis sûr que vous me comprenez ct que nous allons, de ce fait devenir les meilleurs camarades. Je veux eux penser que tout ira bien, Je sens que c’est aussi votre pensée intime”
Avant de me donner congé, il ajouta :
« La guerre, c’est la guerre; elle sait prendre en tous lieux, à toutes époques et à chaque tournant des dimensions différentes, des exisgences nouvelles. Nous devons comprendre dès maintenant qu’elle exige des sacrifices, d’immenses sacrifices, et nos existences mêmes ne représentent que très peu de chose auprès des résultats qui doivent êtres les nôtres. Que sont-elles? Que représentent-elles auprès de toutes celles dont nous devons chercher à assurer la sauvegarde? Vous savez cela
tout aussi bien que moi, autrement vous ne-seriez pas ici. Je vous en redis merci. Pour vous et vos camarades j’essaierai d’être ce que vous attendez certainement que je sois : un patron modèle. Ca ne sera pas toujours facile; mais je crois que nous nous entendrons. Le contraire serait décevant!”
Il me tendit à nouveau la main son shake-hand fut un modèle du genre. Le salut que je lui fis 1e fut aussi vraisemblablement. Jamais je crois, je n’avais salué avec un tel enthousiasme délirant. Il s’en rendit compte, je le sais, ses yeux et ses lèvres prirent une expression nouvelle qui me fit chaud au coeur. Puis, ce fut l’entrainement, Pourquoi s’y appesantir! Vous 1e connaissez tous. I1 n’y avait guère de repos avec « Le DUR », I1 avait des hommes des vrais pourtant, ça ne lui suffisait pas. Il lui fallait des surhommes; n’était-ce pas son état?
“ Allons les gars encore un coup! Encore un effort! Encore un coup! Encore un effort! C’est bientôt que nous y serons!”
Il était insatiable, increvable, inusable. Il voulait et savait obtenir de lui et de nous aussi naturellement, ce que les autres ne recherche pas, ne veulent pas. Il recherchait ce tout petit quelque chose qui lui permettait de dire sans même un sourire : “Hein! J’ai fait mieux et mes hommes m’ont suivi”. Parce qu’en toute circonstance il nous faisait prendre notre part en passant. Bien souvent, nous sûmes l’en remercier.
Cet entraînement devait porter ses fruits: ceux de l’enthousiasme. Un soir longtemps, bien longtemps après, c’était à Froides Conches je crois, Durrmeyer une fois me prit à part :
“Pour se lancer au péril de la vie, me dit-il, dans une grande aventure généreuse comme celle-ci, il faut avoir fait le pour et le contre d’une part, il faut d’autre part un peu de cette folie qui est l’apanage de l’extrême jeunesse. Peut-être inconsciente dans un certaine mesure, mais combine clairvoyante dans une certain autre; ce qui fait qu’elle confine grandement à l’héroïsme. Inconscient, il ne l’était pas, nous ne l’étions certainement pas, mais disons malgré tout qu’en ce qui le concernait, sa témérité en était souvent synonyme. Il portrait en lui des sentiments si nobles, d’une si haute portée, qu’ est vraiment dommage que la vie lui ait été ôtée. S’il avait vécu, ça n’aurait été que justice. Notre monde des vivants aurait conservé dans ses rangs un homme vraiment propre de plus.
Maintenant, Michel, mon camarade, mon ami, tu reposes en terre Alsacienne. Tu reposes en compagnie d’une imposante garde a l’honneur. Ton sacrifice a-t-il été vain? A-t-il vraiment servi? À ces questions je ne trouve pas de vraie réponse, surtout à notre époque de violences, où trop
de jeunes semblent ne pas vouloir se souvenir. Tu t’étais fixé un but et tu avais su nous l’assigner. Non pas dans le commandement, mais sur de simples demandes. Et comment leur faire comprendre que des hommes comme toi dont l’avenir s’annonçait brillant ont consenti le sacrifice de leur bien le plus précieux : la vie pour qu’ils puissent en connaître une qui ne soit pas si malaisée, Le dommage, c’est que ça aille trop loin, beaucoup trop loin. Pas une seconde, pas même une fraction de seconde ils ne se tournent vers l’arrière et disent, avec un sourire désarmant et révoltant tout à La fois : “Ce qui a été votre réalité… peut-être! Pour nous ce n’est que de la littérature. Que cela ne te trouble pas, Michel.
Nous les anciens, les vrais, les purs, tu sais que nous pensons à toi, que nous y pensons sincèrement, très sincèrement. Dans notre Coeur, tu es immortel et tu les resteras jusqu’au jour où le dernier d’entre nous fermera les yeux pour toujours parce que tu tétais grand, immensément grand par la simplicité et la loyauté; que tu l’étais beaucoup plus encore dans la volonté, le courage et l’abnégation. Que le monde pourrait être beau avec de tells hommes.
Auray, le 28 – 4 – 1945, Marcel DEILLAS, Chasseur dans la 2ème section de la 2ème Cie du Lieutenant DURRMEYER.
L’inauguration le 8 juin 1975 de la rue du Lieutenant DURRMEYER :
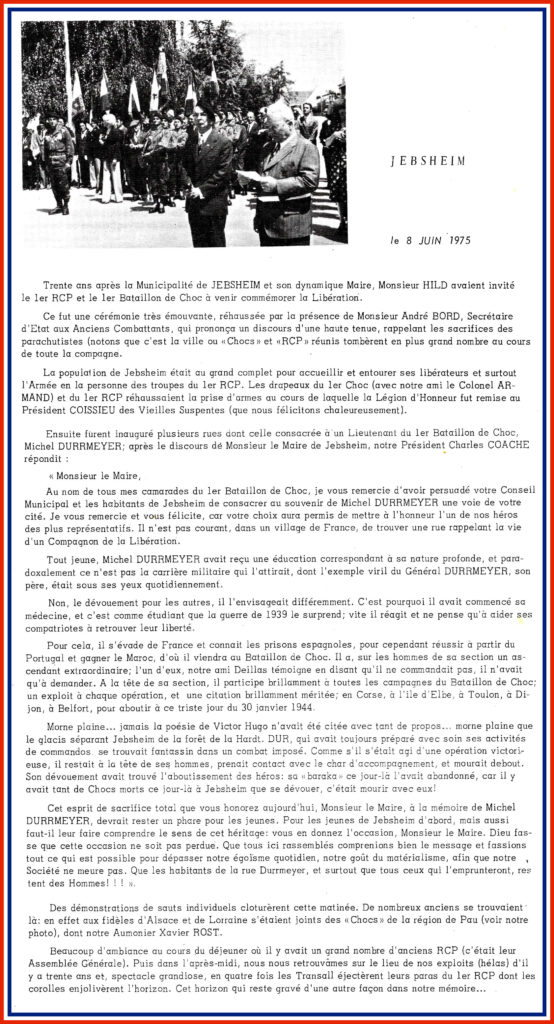
André ANSTETT 1923 – 1974
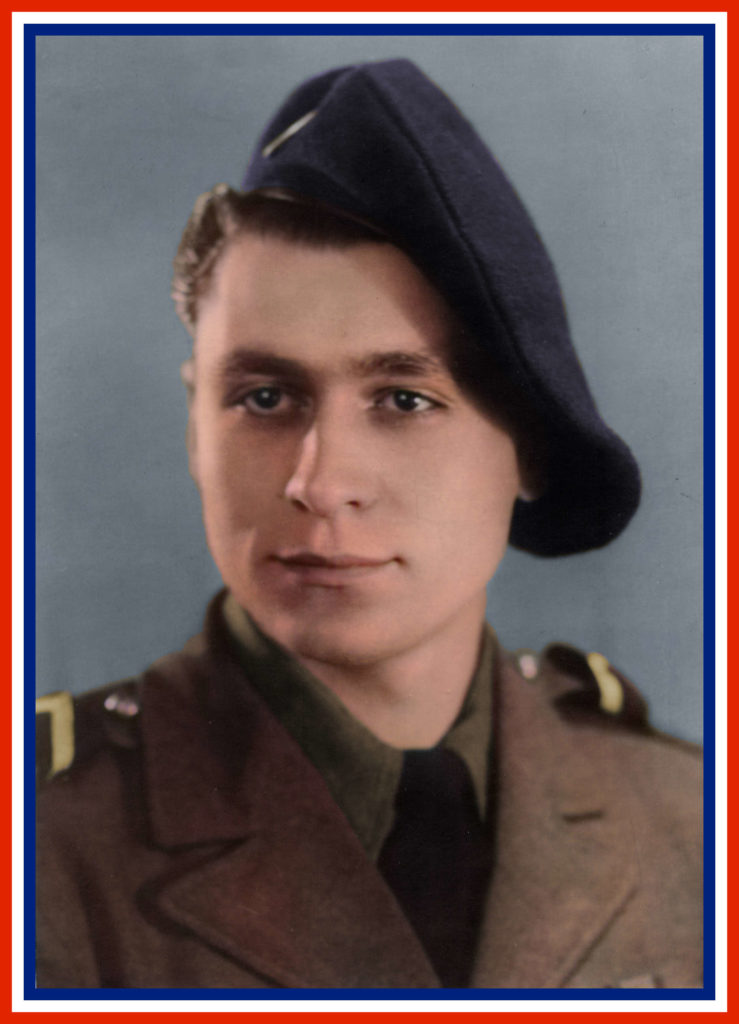
Nous remercions Henri Simorre, grand spécialiste du Bataillon de Choc pour les informations et photos mises à disposition pour la rédaction et l’illustration de ce portrait.
Si l’Histoire du bataillon de Choc vous intéresse : https://1erbataillondechoc.forumactif.com/
Bill George PRATER 1924 – 2019
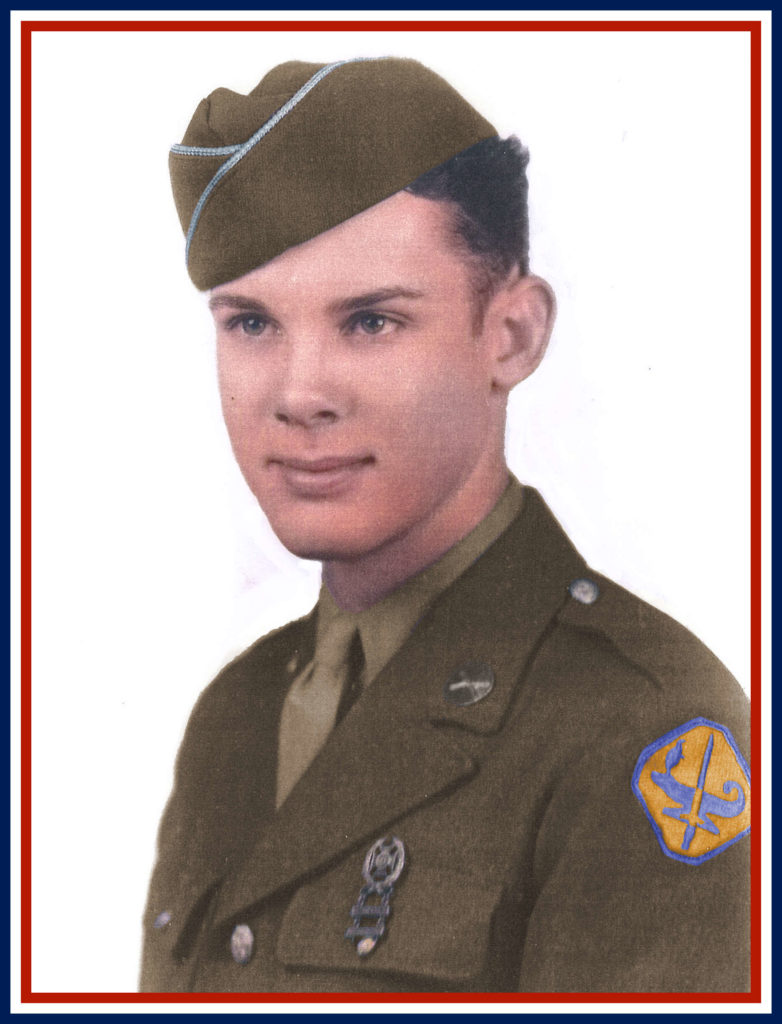
I was born in Springfield, Missouri, October 5, 1924.
After attending Greenwood School from kindergarten through the ninth grade, I transferred to Springfield Senior High School, graduating in 1942.
On December 7, 1941, we were playing sandlot football in a field next to Clara-Thompson Hall at Drury College when we heard about the Japanese bombing Pearl Harbor.
That was a day no one can ever forget. After that horrible event, most of us decided to join the Armed Forces. We found an Army plan that allowed us to stay in school, finish college, and be better prepared for military duty. Therefore, with several high school friends I enrolled in Drury College, September 1942, and signed up for the Army School Program.
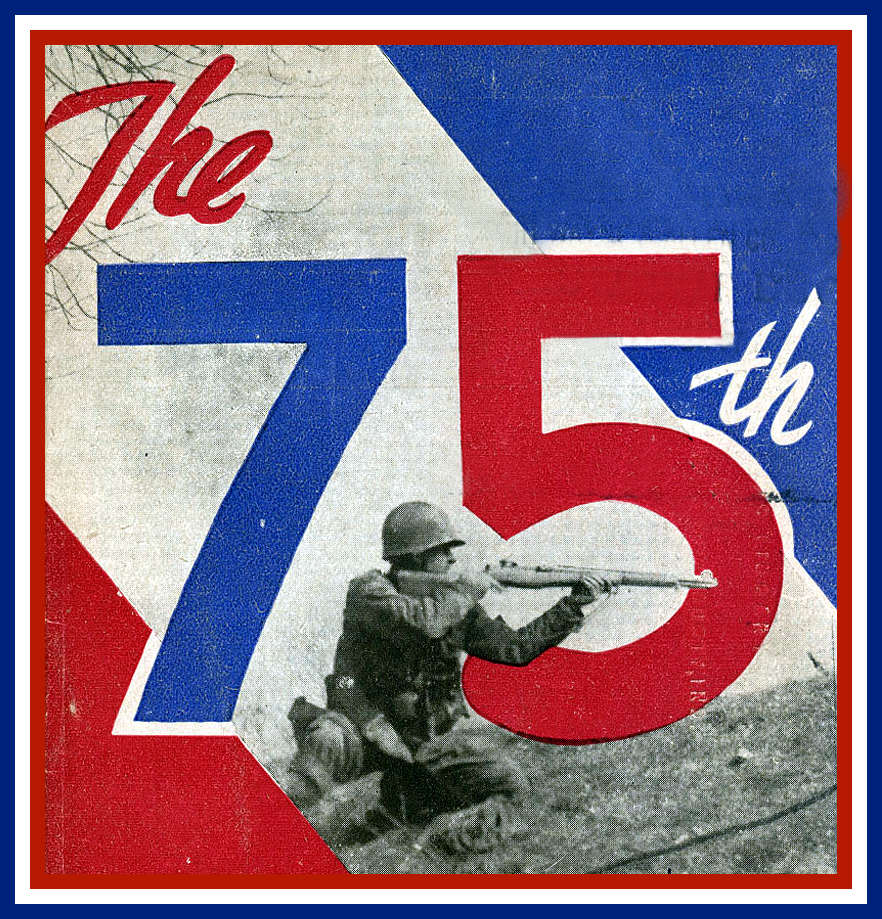
However, the war was not going well for the Allies in Europe nor the South Pacific and our plans changed. In the Spring of 1943, the enrollees in most of the military school programs were called into active service. Our group from Drury College was ordered to report to Jefferson Barracks in St. Louis where we were inducted into the U.S. Army. Following training, I was assigned to the 75th Infantry Division, 291st Regiment, 2nd Battalion, “H” Company. While I was training at Camp Breckinridge, Kentucky I met Jim Strong and John Malarich. Our friendships lasted the rest of our lives.
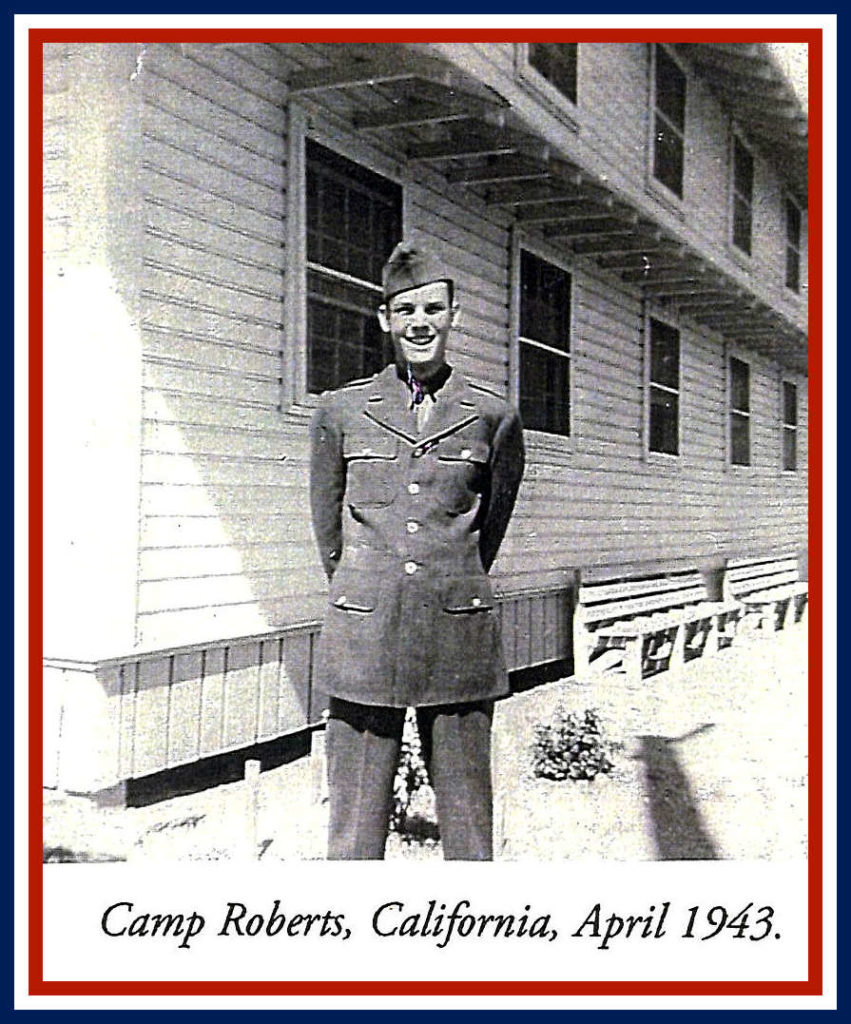
At the end of our Breckinridge program, we were transferred by train to an embarkation port in New Jersey and boarded a Liberty Ship. We crossed the Atlantic arriving at Swansea, South Wales, and were transferred to Haverfordwest in Pembrookshire. An empty, downtown clothing store served as our barracks. There was no furniture, so we slept on the floor, which wasn’t too bad. The worst thing about this time was the food. I remember having over-cooked brussels sprouts twice a day. For years, I wouldn’t eat another one. I was promoted to Private First Class for my position as an assistant squad leader of a mortar squad.
In November 1944, we were taken from Wales, by truck, to Southampton, England where we boarded British landing craft to take us across the English Channel.
We landed on the north shore of France, where we were immediately taken by truck to the southeast near Rheims. We camped out in a field for a week or two, by then the field was ruined with our muddy boots. While stationed there, we would walk to the road and see the local French people and their children. One soldier in our company, who was not too bright, actually asked, “How did those little kids learn to speak French so well?” How do you answer that?
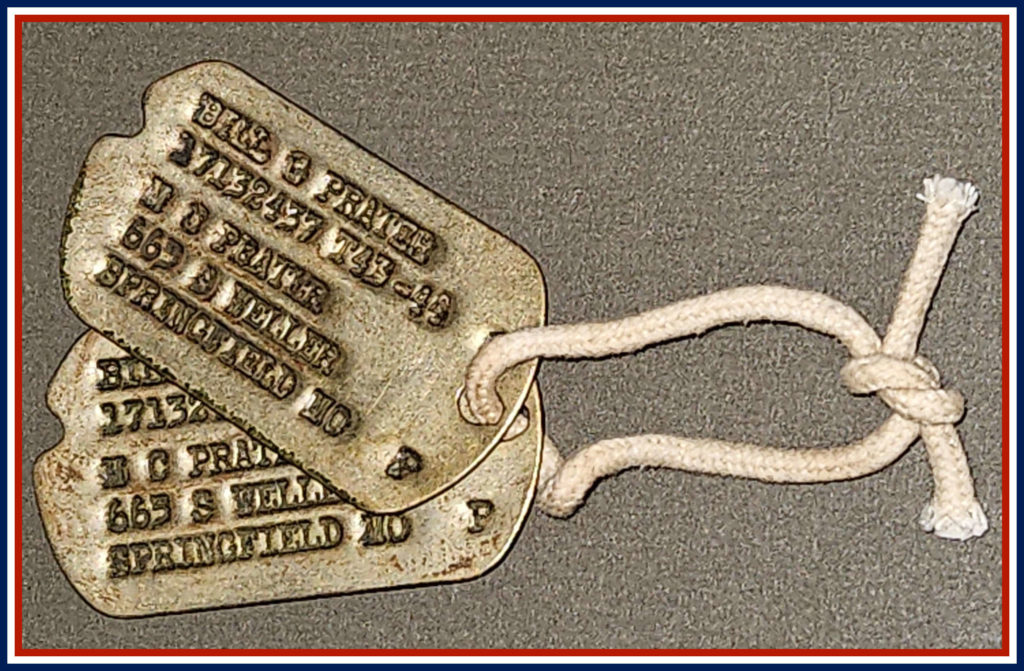
Here I was in France during World War II. It is interesting that my father (Matthew Cyrus Prater) was in France during World War I, serving as a sergeant in the Medical Corps. He was a pharmacist before being drafted.
We moved by truck east into Belgium, through Liege, and toward the battle area. As the vehicles rolled across the Belgium countryside and through the small towns, the citizens wildly greeted us as American soldiers. They would come out waving Belgium flags, giving us postcards—giving us apples. I was riding in the back of a jeep, right in the middle of all this friendliness. We did not know we were about to save the Belgians from the Germans. The German Army had broken through the Allies line in eastern Belgium. The bulge they created was moving westward as we went through Belgium to begin our part in THE BATTLE OF THE BULGE!
BATTLE OF THE BULGE
About December 15th, 1944, we moved to a spot south of Liege, where we dumped our packs, picked up light gear and moved on into an area close to Tongres, Belgium. It was in this area we first heard the artillery shells and the heavy fire that was going on in the “Battle of the Bulge.” From there we moved into the tip of the Bulge, near the town of Marché. There we had our first encounter with German troops. We were on an outpost in the town when our squad was asked to take a forward position and watch for the enemy. Of course, we heard all kinds of noises, artillery fire in the distance, and voices that we thought were Germans behind us although we didn’t see any. One of the rifle companies behind us did and fired at a few of them. Shortly thereafter, one of the machine gunners in our company thought he was encountering a German infiltrator. Our first casualty was friendly fire that killed our company barber. We spent the night on patrol. It was one of the few times I did not take my shoes off. I learned afterwards to always take them off —no matter what—because my feet were almost frozen that night. I could hardly get my galoshes back on over my high-top Army Issue shoes. (We had not received boots.) After that experience I learned to take my shoes off, put them inside my sleeping bag to keep them warm, and put my galoshes under my head as a pillow. My left foot still bothers me in cold weather. During our short stay, we did not encounter any more combat in this area.
We were moved up north and back to the east where we fought in the “Battle of Ardennes.” Our participation in the “Battle of Ardennes” started about the 23rd of December 1944. On the 25th (we thought it was the 25th), we fired our first mortar rounds. These were smoke shells so that some wounded infantry ahead could be rescued. We named our mortar “Smokey Christmas” since we fired it for the first time on Christmas Day. This was the beginning of actual combat where we had our friends killed and wounded. Our troops were eager, but raw and inexperienced, so this was a tough start. The young men quickly became older and ‘combat wise.’

It was here on the edge of the Ardennes Forest that we met a muddy jeep with two soldiers, a captain and an NCO (non-commissioned officer) who were also covered with mud and very scared. They were escaping from the advancing German Army that had overrun the American 106th Division. This Division was totally surprised by the German attack and about two-thirds of them were captured.
The troops of all nations were under General Eisenhower, however General Montgomery had control of the British and American troops on the northern flank of this bulge that the Germans had pushed into Belgium. The plan was to drive south and east while the American Third Army under General Patton drove north toward Bastogne.
Our division got into active combat on the top (north) portion of the wedge of this German bulge. We went through some small towns, the names of which will always be remembered, Grand Halleux and Petit Halleux. This was the area where we were pinned down by the Germans who set up their equipment during the night while we were sleeping in village houses. When we came out of the houses the next morning, we faced machine gun fire from down the street and down the valley behind the house where we had set up our mortars.
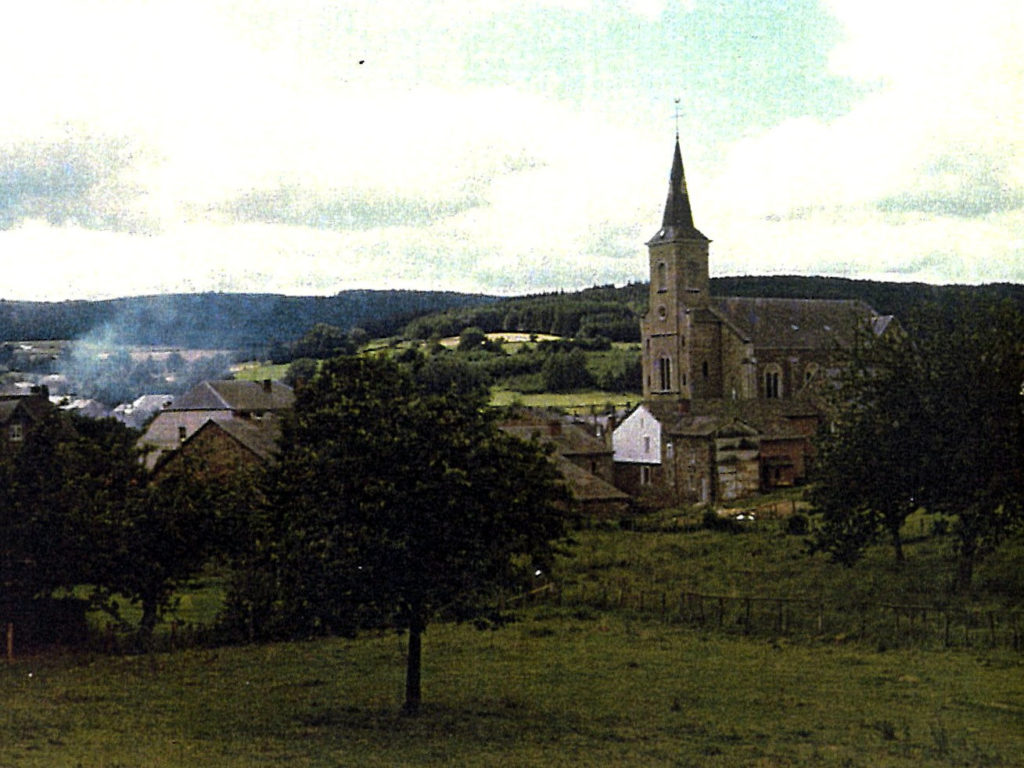
Our first casualty in H Company was Charles Hartraff, who was married and had a child, one of the nicest guys in our company. There were more casualties during the day—in both the machine gunners and the infantry rifle troops. The Germans were on the ground above us, shooting down at us. We were in a terrible position. Fortunately, we had set our mortars on the valley side not at the bottom of the hill, or we would have lost more men. Our ammunition bearers were pinned down by machine gun fire and couldn’t get across the road to bring us supplies.
Our Company Headquarters was shelled. The Company Commander was wounded, killed was one of the lieutenants, our mortar platoon sergeant (Lee), and Sergeant John Bessmer (married only a few months earlier). We lost Lieutenant Leroy Wallis, who was the only officer assigned to our mortar platoon and Sergeants Finke and Stewart from the machine gunner platoon. Three or four other men were wounded in this heavy mortar attack. Our executive officer, Captain Goodnight, took charge. He was a much-liked person, a professional football player, drafted into the army like the rest of us. He was with us for quite a while, and we were fortunate to have him. He was not wounded, but had acute appendicitis, and we lost him after a month and never saw him again. Captain Goodnight was a good officer, and we missed him.
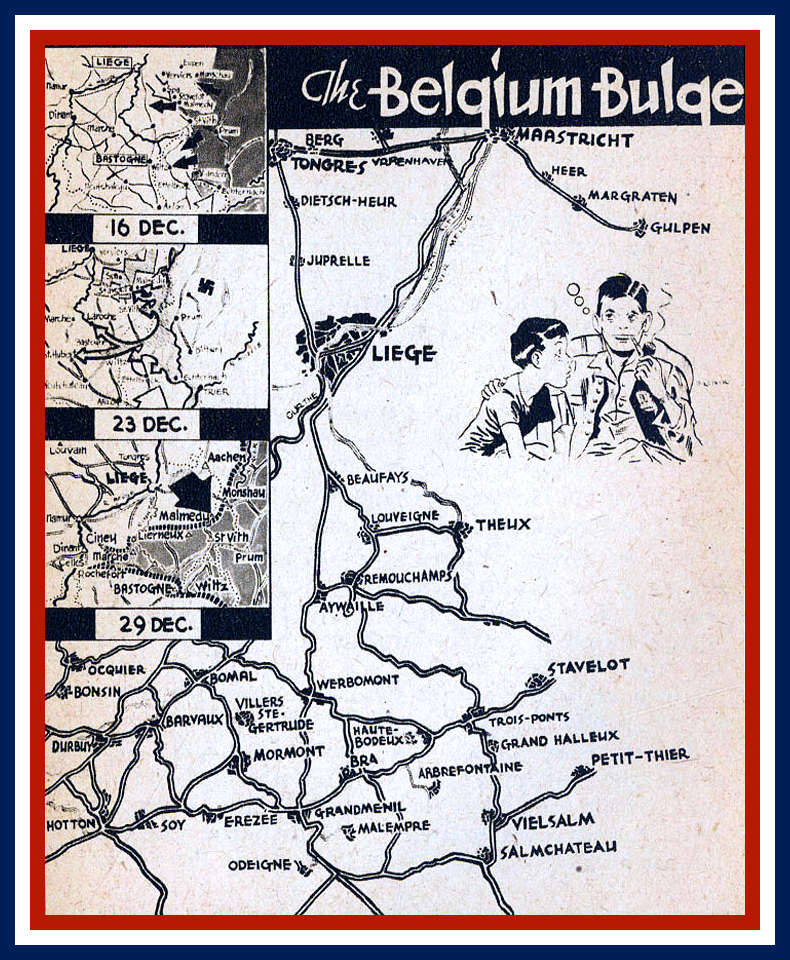
We advanced from Petit Thier, toward the village of Poteau, which was held by the Second Battalion of the 290th Infantry. We came in at night without meeting any resistance or seeing any action. We were awakened in the morning by artillery and mortar fire. I was sleeping on the ground floor of a little wooden shed behind the barn, when a shell hit. It set the shed on fire and one of the mortar gunners sleeping there was killed; Corporal Johnson and I slept in the same house the night before in Petit Thier. We moved into the shed in Poteau after dark. He was killed by the tank shell, and I wasn’t hurt.
We quickly moved out to take a defensive position and could tell the Germans had a tank set up as close as 100 yards away from us! We had one tank knocked out, but soon the German tank also got knocked out by artillery fire. We were firing our mortars at about 100 yards, which is as close as possible, but it was hard to tell how much damage we were doing. At least there was not a flank attack on us. The wounded were difficult to handle because we had only barns and a few houses to protect us. Fortunately, the stone walls were about a foot thick. Behind those stone walls, we were safe from small arms’ fire. We had to move several of our wounded into the building toward the back of the town so they would be protected. We had no physician and only the company aid men to support them. At that time, Colonel Jesse Drain was our battalion commander. He helped considerably in keeping the men together and keeping the defense parameter intact. I think he was awarded a Silver Star medal for his action in this area.
In the area south of Poteau, some Germans were captured. This helped reduce pressure upon us. That night we were relieved by the 517th Parachute Infantry of the 82nd Airborne Division. As we pulled out, there was still enemy fire. Two men from my section (I had control of two squads at this time) were running back toward the woods—Jim Strong and Floyd Ross. An artillery shell hit between them, bounced away without exploding, and they made it safely. I still correspond with them today. (Jim Strong died in December 1998). I walked out along the road with the rest of the squad. We all met up at the far edge of the woods, and then were able to move back from the town.
The next village we were ordered to capture was Vielsalm, but the Germans had withdrawn because our troops were putting pressure on both flanks of their position. However, they left mines and booby traps in the town. Fortunately, we were able to find most of them for the engineers to remove. We moved our division command post, as well as our division, through the woods during the night. This was between January 18 and 21, 1945. We moved farther south and east during that night. This was always an experience; to move at night on trails through the woods. This is where occasionally, we would have to sleep out, scraping the snow away, laying our raincoats down, and throwing our sleeping bags on top. We only took off our shoes but had them handy inside our sleeping bag. At these times, we would get extra food. The loss of personnel from frozen feet, wounds, and death gave those of us remaining, extra rations and extra equipment. One infantry man in our company broke a leg walking in the ruts and snow at night where you could not see.
Company G, an infantry company with whom we were closely associated, had heavy combat south of Poteau after we had moved toward Vielsalm. They faced tanks and German infantry but were able to repel them. Our company gave them some mortar support at that time.
Self-inflicted gunshot wounds during combat became a problem. In our company there were two instances of these injuries. One was shot in the foot, claiming he was knocking snow from the barrel of his M-I rifle. With his finger on the trigger? The other soldier said he was sitting with his back against a tree. He moved and shot himself in the leg when his pistol fired through his holster. These so-called ‘million dollar’ wounds sent both men to the rear. We never heard of them again.
It was interesting during combat that you could identify the small arms’ fire. The German machine guns, which we called “burp” guns, because they were hand-held automatic weapons with a very rapid rate of fire. The “burp” gun fired about twice as many rounds per minute as did our machine guns, so you could identify which side was firing.
Another big problem during The Bulge was the weather. It snowed almost all of the time and was so cloudy that our aircraft could not fly; therefore, we had no air support from England. Ordinarily, we would have expected the B-17s and B-27s flying over giving us protection, but it was impossible for them to get off the ground or to find us if they did. When the weather did break, here came the Air Force! This was the final blow to the German army as we were able to stop their advance and we could go into attack mode. I remember seeing the bombers come in fairly close formation on the first bright day. There were the big brown ones from England which had no fighter support because we were too far for fighter planes to reach.
However, the Germans did have fighter planes in our area. Occasionally, we would see small German fighters up and around the American bombers. The bombers would then spread out, so they were farther apart. We did see a few bombers shot down, but only a few. We saw the parachutes floating when the crew was forced to bail out. The presence of the Air Force was a great morale boost for us. Of course, it made our situation much better since the bombing could resume and we did have air superiority.
During the time of the snowstorms in Belgium, we frequently had to dig in. Usually, we could scrape enough snow away and chop a little of the frozen ground a little to get us a mini-foxhole. One afternoon in particular, we came along an open area on the edge of woods. We stopped and were to dig in before advancing the next morning. We heard tanks in the distance (we knew they were German tiger tanks) and we were pretty anxious to get dug in. We worked very hard and got nowhere. We could not get any ground broken at all, and soon found we were trying to dig on an abandoned air strip. We moved farther into the woods where we could dig in a safer position.
Foxholes, or ditches, were our protection and at night we could use our sleeping bags. When not moving forward, we could get some sleep by posting guards in pairs. Guard duty was nerve-racking because it appeared that every tree or bush would move. We would change positions, very carefully, hoping to see better. We had heard of German soldiers wearing American uniforms behind our lines. We didn’t encounter any infiltrators, but our wariness increased. We stayed close to the roads, not a cross road that could receive artillery fire, but where we could hear approaching vehicles. Tanks could be heard easily in spite of the artillery barrages. Sleeping was at a premium and after guard duty, we would bundle two or three guys together for warmth. We traded guards every two to three hours.
Keeping warm was a problem in the Belgium winter. I wore regular underwear, long wool G.I. underwear, wool shirt and pants, a wool sweater and a wool overcoat. Unfortunately, we had only cotton socks, high top shoes and galoshes. The wool stocking cap we wore under our helmet kept our heads warm, but our gloves were thin and usually wet. We had a raincoat which we put under our sleeping bags to keep us dry and we had double sleeping bags (because we took them from the casualties.) We had to cut up our blankets to make gloves. We also cut holes in blankets to make headbands to keep our ears from freezing.
We often heard German rockets going over our head. They had V-1 and V-2 rockets. One of them was kind of a putt-putt rocket that they were shooting toward Belgium and England. We would hear these go over, but we couldn’t hear their final explosion because they were well behind us. Also, we heard small German aircraft. They were artillery-spotting planes similar to our Piper Cubs. We called them “Bed-check Charlies” because they always came over late afternoon to spot where we were so they could be getting artillery ready for us. We could see one occasionally, but there was no anti-aircraft fire or any action against them. The Americans, of course, had the same situation. Our small planes were doing the same thing.
All of our troops had hand grenades and I put mine in my overcoat pocket. One day I stuck a cold hand in my pocket and felt the loose firing pin on my grenade. I gently pulled the grenade out while holding the firing handle. The pin was half out so I put it back in place then gave it to a machine gunner. He might need it and I certainly did not want it.
It was amazing how dirty we were, particularly our hands and faces. We were black from dirt, mortar shell powder, and smoke when we could build a fire. It seemed perpetual because we had no way to wash. Fortunately, it was so cold we did not perspire. We were always cold, tired, and scared. Usually, we were more fatigued than scared however, since at 18 years of age we were not smart enough to believe anything could happen to us. As the battles went on though, we became smarter.
It was toward the end of January, about the 21st, when we broke contact with combat and went back to an area for reorganization and rehabilitation. This was badly needed since our equipment was in bad shape and our personnel so badly depleted. On the 24th of January, while we were in R&R, Army Commander General Matthew Ridgeway replaced our division commander, General Faye B. Prickett with Major General Ray E. Porter. Prickett was not an aggressive officer and his inability to lead troops had proved he was not the type of division commander that was needed in such a crucial time. At the same time General Ridgeway replaced our division artillery commander.
THE BATTLE OF COLMAR
Our division was moved from the Belgium area once we had accomplished our mission and the final battles in Belgium were well underway. This time we moved by rail south into France, toward Colmar in Alsace. We traveled by rail in ‘40 and 8’s’, which was an experience in itself. We probably had 60 men in a railroad boxcar made for 40 men or 8 horses. There was nothing in the car, everyone had to sit on the floor, but there wasn’t room for everyone to sit at one time. You would stand up for a while, sit down for a while. You put your feet in the middle where the guy whose legs were on the bottom would have to pull his feet out every once in a while and put them back on top. The only way you could sleep was leaning against the side. With that many people, the humidity was so high, the water dripped from the ceiling. It was a couple of days before we arrived at our destination. The German army still held the district of Alsace, and we were called on to help the French First Army drive the last Germans out of France. The French First Army was commanded by General Delattre De Tassigny with the help of General Leclerc.

THE BATTLE OF COLMAR, called the ‘Colmar Pocket’, was another major campaign. There we were awarded our second battle star. The 2nd Battalion of the 291st infantry was setting up in the Colmar woods to allow the infantry to push toward the Rhine River. We fired mortars continually in an anti-personnel pattern. We would fire nine rounds covering an area about 200 yards square. This was probably our most effective mortar fire during the entire campaign. We were able to soften the German lines so our troops could move forward. There were a few roads through the forest, and we were stationed with our mortars at one corner of a road. A lieutenant, who was an engineer, and a couple of enlisted men, walked by with maps to decide where we should move next. About ten minutes later, the enlisted men came back. The lieutenant had tripped a booby trap and was killed.
During this campaign the kitchen was frequently able to get up to the front. They would come up after dark, and we would gorge ourselves, often get sick in the night, then have to get out of our sleeping bag. We knew we had to eat when we had the chance. Occasionally, we would also get breakfast before daylight, then they would leave us rations for the day. The kitchen tried hard, and they took chances getting to us. Usually, it was after dark when we got our only meal of the day.
On cloudy nights, anti-aircraft spot lights were often used for ground light. It was eerie seeing this light reflected from the clouds, but it did enable us to move around to change positions and set up mortars.
While we were in the Colmar area, we received our winter gear. Of course, the snow was gone, the weather was warming up, and the ground was mushy and soft. We received snow-pack boots, which are rubber on the bottom with leather tops, and new wind-breaker jackets, wind-proof pants, and wool socks instead of the thin socks and high-top shoes we had in the Bulge. We also got warm, woolen gloves with a wind-breaker type second glove you put over them. These would have been wonderful in the snow and cold during the “Battle of the Bulge.” Now we had good equipment and were envious of the Quartermaster Corps that had this equipment all the time.
We had fairly heavy casualties in the “Colmar Pocket” amongst the machine gunners and some of the mortar platoon as well. We were under artillery fire that was pretty devastating. Artillery fire is one of the worst fears you can have outside of being bombed. Two machine gunners up the road from us were together in a foxhole with a machine gun. A shell hit close enough to them that one was killed while the other man was not. However, the other fellow never recovered. He had a terrible shock and was taken back as a shell-shock victim.
During this time we received replacements. My section of the mortars, which consisted of two squads of eight men in each, was down to a total of six men. With the replacements, we filled up to about ten so we could handle both mortars but did not have enough ammunition bearers to keep us supplied. Our company suffered about 50% casualties, including battle and non-battle. We did manage to keep our jeep and our quarter-ton trailer. I had been promoted to Staff Sergeant, commanding two mortar (81mm) squads, but I wore no stripes. Our replacements were well trained, fresh and eager. They added a boost to our morale.
The French First Army was interesting in that they were typical Frenchman. They were terribly independent and seemingly fearless. One day their tanks went out in advance of us and the first tank got knocked out on the road. Here came another tank and it also was knocked out. Instead of separating their tanks and going across the field they sent a third tank out and it got knocked out. So, they were taught a different way than the American G.I. However, they prevailed, took another road out and were successful in the end. We then followed after them.
We were bombed while we were in the Colmar area. Only a few bombs were dropped but this was much worse than being in artillery fire because the bombs were so loud and so destructive. One time during the shelling we thought they were getting close to our headquarters house so we decided to evacuate. Running across the open door, I fell flat on the floor thinking I had been hit in the back, but fortunately not so. A small piece of shrapnel tore a little hole in my jacket and no damage was done. There were no civilians at all in the villages and areas we went into in Colmar. They had been evacuated long before and were safe from the Germans and the devastation.
While in the Alsace area, we were put back in reserve in the fortified town of Neuf-Brisach. We were able to look around the town, which was interesting in that it had a medieval-type stone wall all the way around the town. These walls were laid out in a star shape. Fortunately, we were in reserve and our part of the combat was over, while the other regiment of our division drove out to the Rhine River. On February 7, the “Colmar Pocket” was over and the last of the Germans were driven out of France. For this battle, our division received an award from the French called ‘Rhin et Danube.’ This consisted of a small patch and medal that we could wear on our uniforms.
It is amazing that during combat we rarely saw the people in headquarters platoon. I can’t remember seeing the Company H Commander or the First Sergeant during the battles. I know that our First Sergeant was wounded when a shell hit the hood of his jeep. The driver was not hurt. We had no, or occasionally one, officer in our platoon when we should have had four. Leadership was mostly NCO‘s (non-commissioned officers), and the overall plans were made by officers who were much higher up.
Our participation in the “Colmar Pocket” ended on February 9, 1945. We were transferred back behind the lines into the Vosges Mountains for “Rest and Recreation.” We were billeted in a small farming village called Rambéville, near St. Dié. Our platoon slept in a barn where we were supposed to rest, clean our weapons, get our gear in order, and be prepared for our next adventure. During our stay, we walked through the village of fewer than 500 people. We came up to a farm house where we spoke to the people in the yard and they invited us inside. Three of us went in to meet the family. Jim Strong could speak enough French to introduce us, and that is how we got acquainted with the Thiébaut family. There was the father, mother, and two daughters. They told us they had sent their son, Maurice, to southern France so he would not be conscripted by the Germans. I had a ‘D’ chocolate bar in my pocket. With my ‘D’ bar and their milk, I made some chocolate milk for all of us. We sat around the kitchen table and tried to visit, speaking only French. We also tried to play cards with the daughters. We visited the farm house often and soon Jim Strong was interested in getting better acquainted with one of the daughters. This R & R was a pleasant time far different from the rest of the time I spent in Europe during the war.
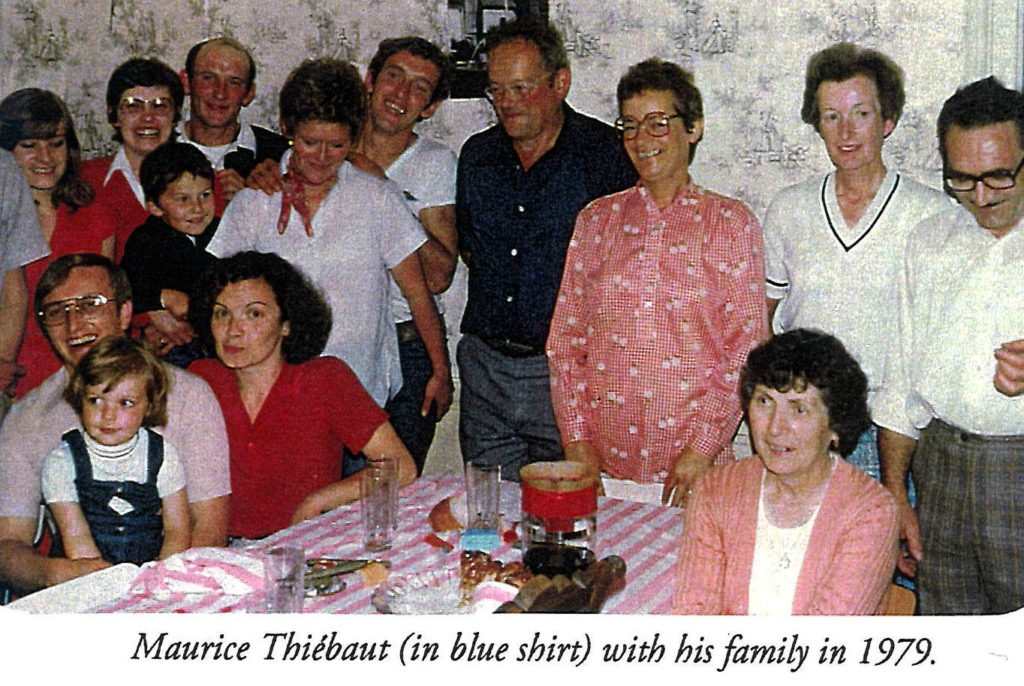
This is the Thiébaut Family that we have visited in post-war times. We had a very nice dinner at their home when our platoon visited them in 1979. Maurice came to the Dordogne area when our family rented a house there in 1985. My wife, Marie, and I visited them again in 1989 when we were in the Vosges. We continued to correspond at Christmas with Maurice. Maurice ran a dairy farm and at one time he also raised flocks of geese for the foie gras. In 1997, Madame Thiébaut wrote that Maurice had died during the year.
BATTLE FOR THE RUHR
Our third battle star was for the BATTLE FOR THE RUHR. The Ruhr is an industrial area of northwestern Germany along the Ruhr River that includes the industrial cities of Essen and Dortmund. On March 9th our division was moved to the Rhine River well north of Essen, closer to the German city of Dorsten. We sat on the Rhine River for one or two weeks in a defensive area, preparing for the “Crossing of the Rhine.” We carried out occasional mortar fire while sitting on the river since German fortifications were just across the river. Our rifle company sent out patrols, but only along the river margin to protect us from German patrols trying to cross. No German patrols got across the river without severe losses. Our mortar section was in a nice home about 200 yards from the river itself. We had our mortars dug into the front yard. The first night we were there, John Malarich and I went to sleep on a soft feather bed. Of course, we slept in our clothes and I slept wonderfully well. I woke the next morning to find that John had gotten out of bed and slept on the floor because he said he just couldn’t stand that soft bed after sleeping on the ground during the rough winter.
During our stay there I was observing mortar fire from a barn down by the Rhine. I climbed up a ladder to the top of the barn and knocked out a shingle so I could see across the river. We had our mortars lined up on about ten different targets so that I could call for target by number and they would automatically set the site on the stake that aimed the mortars at that area. We had captured or found a German binocular periscope that we set up in this opening to observe across the Rhine. I could see the Germans but they were behind their fortifications at the edge of the river. I could see them walking in a courtyard and would call down the ID number of this target. If any troops appeared in the courtyard, I would call for mortar fire. The guys were good with their firing, but I really couldn’t see if I was creating anything more than a disturbance, which at least kept most of them inside their fortifications. One day while I was observing and my crew was shooting a few mortar shells at them, I was watching an artillery piece that was set up by the side of this barn. This was about a 105-millimeter gun that was firing on a low trajectory, more like a rifle, and I could actually see the shell come out of the muzzle of the gun because of my location. I couldn’t see where it ended but I could see it fly out of the piece when fired. Then, while watching for troop movements on the other side of the river, I noticed a shell from the German side hitting just below the barn. A few minutes later, I heard one explode behind the barn. That was enough! I was down the ladder, my radio man was there waiting for me and I said, “Let’s get out of here.” Sure enough, the next shell hit the barn. They didn’t hit the roof where I had been, but they did hit the side of the barn. I don’t know what else happened because by then we were gone.
We were there for a week to ten days while preparations were being made for the Rhine crossing. There was a bridge over the Rhine not too far from us. At night, the Germans would try to bomb this bridge. The artillery fire around the bridge was fantastic. It looked like all the fireworks in the world you could think of. Any time an enemy aircraft would come close, the firing would commence and there would be tracer bullets flying everywhere in the air, both from 50-caliber machine guns and from anti-aircraft guns. I did not see a plane hit, but we saw plenty of them change altitude or direction to get away from that fire power.
The morning of the crossing, we started our mortar fire about 5 a.m. We fired from 5 a.m. to daylight. We had never fired so many rounds of ammunition during the entire time we were there as we did that one morning. The barrel of the mortars is about 40 pounds in weight, approximately four-feet long, and 81-mm. in diameter. It was a heavy piece of equipment and fired a fairly good-sized shell. With that many rounds fired it created enough heat that you could not touch the mortar barrel with your finger. It was really hot and almost glowing. We got a little nervous about dropping the shell in and having it explode before it would hit the firing pin because of that heat. We kept firing at targets that were spotted on our maps, so we had the direction and range we needed. Evidently, we accomplished our goal, as I will indicate later. The next morning, the crossing was made without difficulty, both on the bridge and on pontoon boats. We crossed the following day on a pontoon bridge, which was built to carry vehicles no larger than jeeps and small troop carriers. When we reached the other side, we could see the German entrenchment, well built and deeply dug to keep their men safe. When the rifle companies crossed the river, the German troops had all pulled out. Our bombardments obviously were successful because of the amount of fire power in such a small area, all of the artillery behind us, and our aircraft bombing past the river. It really was a tremendous effort to clear the river for our crossing, and it was quite successful.
Our division was now in the Ninth Army under General Simpson. General Montgomery was the Army Group Commander over English, Canadian and American troops. On the second day after crossing, our battalion captured a large rubber plant of some kind, north of a town named Huls. This was later taken over as Supreme Headquarters of the Allied Expeditionary Force. I don’t remember much about the plant, except it looked like it hadn’t been used for a while. There was only rusted machinery and no evidence of recent occupation.
It was during this advance through the German countryside that freed a small slave labor camp. They were older people, of several nationalities, none of whom we could talk to. When we opened the gates, they came flooding out. We indicated they could go anywhere they wanted to, go into any house and take whatever they could find to eat or wear. They were gone in no time, and that’s the last we saw of
them.
While we were advancing in the Ruhr area, our outfit and a rifle company that was with us started digging in for the night in an open field. We were able to observe some of the American planes coming over from their bases in France. There was a P-47 that came by on its bomb run, which was probably 500 yards in front of us. He made his turn, dropped his bombs, came back over us, and just as we were watching him, another bomb released. We were amazed as we watched this bomb come down. We took cover just before it exploded about one hundred yards away. Fortunately, no one was hurt. One other time we were strafed by British Spitfires. They saw us around some buildings near the woods. I suppose they were not able to identify us because two of them came down to machine gun us. We were fortunate when no one was hurt during the first pass, so we ran out to place our streamers indicating that we were Allied Troops. The next time they came down, they did not fire and left.
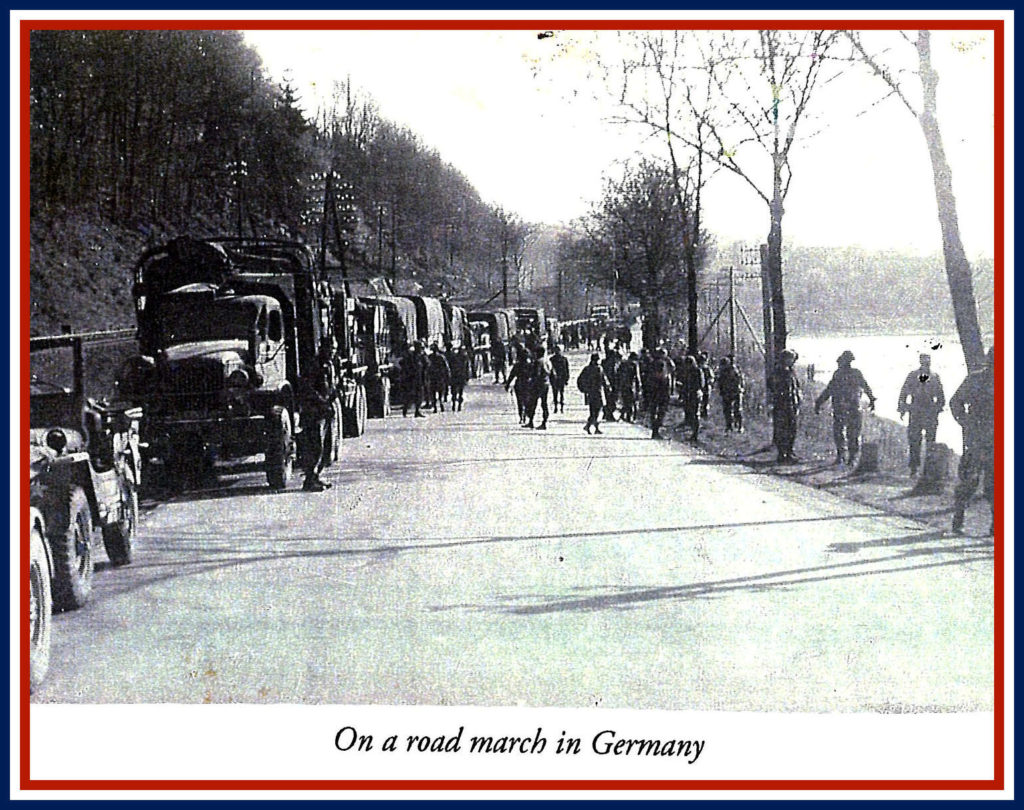
During our experiences in this area, we saw the first of the German jet fighters. We only saw them high in the air. They did not have many fighters and were not able to really do us any harm. Germany, at that time, was running out of fuel. They were not able to fly as much as they would have liked. We also saw horse-drawn ambulances that had been destroyed by artillery fire. The Germans used their horse-drawn ambulances to carry ammunition. Unfortunately, as we saw dead German soldiers, we also saw dead horses.
Many POWs (Prisoners of War) were captured in Germany. We saw them marching back through us, escorted by a couple of G.I. riflemen. They were both old and young. We were amazed at their ages. Some of them looked like they were hardly out of high school and some were really too old to be in combat. The Germans were using every man they could find.
The resistance was fairly strong through the Dortmund Canal area. Our goal was one of the canals that crisscrossed through this industrial region. We had obstacles to cross and German resistance along the way. When we moved up to the front into attack, many of us, me included, would often get nausea and some diarrhea. This would last one or two hours then disappear. I knew one man in our platoon that always got sick and finally was sent to the rear. He never returned. One of our riflemen had his canteen shot so the water poured on him, and he thought for a minute he had been hit. Another man told the story of having the tip of his shovel that he carried on his belt shot off. I can recall being in a bomb crater with John Malarich, our gunner, hearing a shell explode, hearing the shrapnel whistle, then pop—one hit him right on the leg. He grabbed his leg and said, “I’ve been hit in the leg.” We looked down at his leg, but it was all right. We looked over in the bomb crater and there was a piece of shrapnel about 3 x 2 x 1-inches smoking, lying in the dirt. The flat side had hit John on the leg and did not even break the skin. It bruised a little bit, but he was so lucky; for he could have lost his leg due to the jagged edges of the steel.
As we moved on through Germany after the infantry had cleaned out some of the resistance, we even hopped rides on the tanks since we were moving fairly rapidly. In some spots, we rode the tanks into small villages the German soldiers had just left, and the civilians were still there. I remember walking into a village bar where three or four of us lined up. The bartender poured us a beer, while some Germans sat on the other side of the room, nervously trying to pay very little attention to us. I also remember storming a house, not knowing who was there, and some old German folks came out with their arms up in the air, saying, “Nich Nazi, nich Nazi.” We confiscated a few chickens and rabbits along the way that we would cook in our helmets. We had boiled rabbit and boiled chicken, but it was hardly a worthwhile meal.
As we approached the canals, my duty was as a forward observer. I would go up with the rifle company as we approached the canals. I remembered helping a couple of injured guys coming out of a ditch. They were not seriously wounded and recovered in the rear area. Another time, my radio man and I went into a field bunker that evidently had been a food storage cellar. Two young German soldiers held up their hands and came right out with us. So, we captured two Germans without even trying! Another time, I climbed up along the edge of a small canal with the rifle company. We could look across the canal, which was probably 30–40 yards, and see the Germans moving back and forth, in their trenches. You could just barely see the tops of their helmets. Some of the riflemen would try to shoot one every once in a while, but they did not have much luck. Pretty soon, the German soldiers left. While we were there, I would often call for mortar fire, usually just smoke, to cover our men removing the wounded. Sometimes we would be able to give them good cover, other times they would be out of our range. Our platoon leader, in the rear, would try to add extra power to the mortars to get shells up there, but we did not always succeed. There was considerable German sniper fire from the buildings close to the canals. While I was with G company, a lieutenant climbing on a fence was killed by sniper fire. I think the sniper was caught shortly afterwards.
The Rhine River bombardment was around March 31. The “Battle for the Ruhr” ended approximately April 13th or 14th. This completed our last major battle in Europe. It was here, after the Germans surrendered, that we ran on to a couple of Russian soldiers on one of the canal bridges. We only spoke briefly since the only thing we could say was “Comrade.”
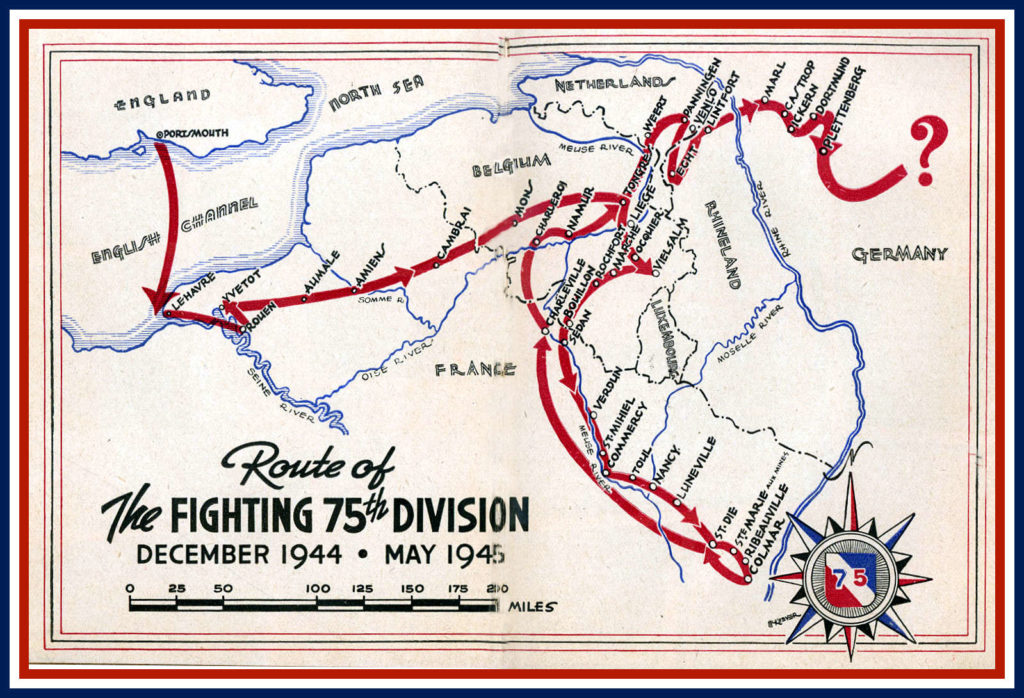
POST COMBAT
After the Ruhr campaign we were transferred to a small town in Westphalia, Germany where we served as Occupation Troops. We lived in a school house and were in charge of a DP (Displaced Persons) Camp. These were Russians, Poles and other Slavic peoples, both men and women. Our company shot a few deer in the surrounding woods. We took them to the DP Camp for the cooks to prepare for the inhabitants. They would usually prepare the tenderloins for us, which we greatly appreciated.
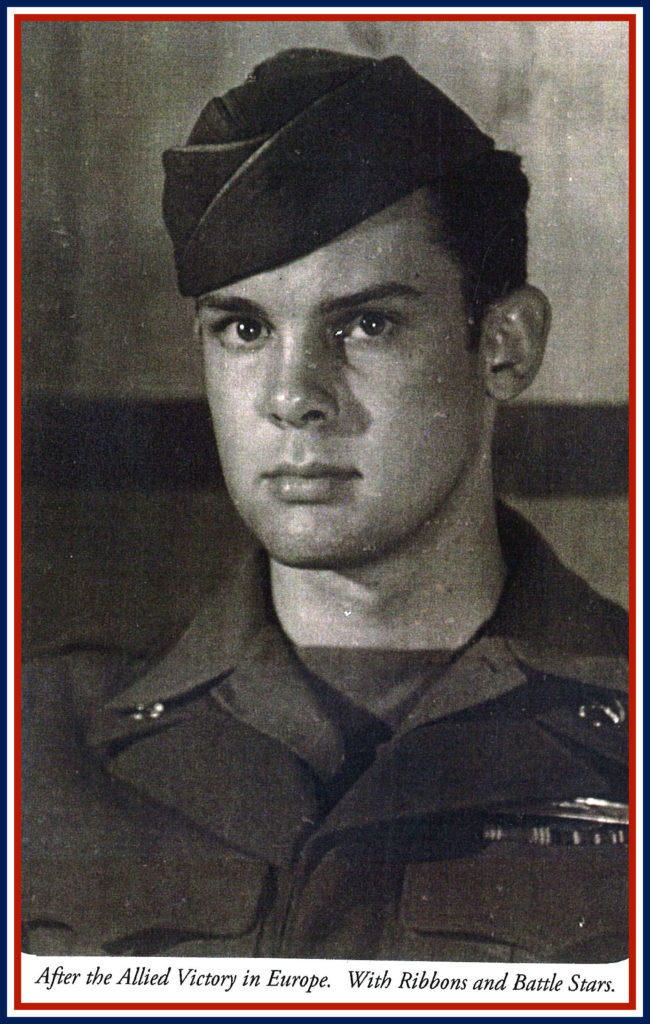
The War in Europe ended on May 8, 1945. We were pulled back to France. Troops were being assigned to return to the U.S., where they would be re-outfitted and transferred to the South Pacific. I was fortunate, for our division was sent to Camp New York in France for reassignment. I was assigned to the Signal Corps to process troops going to the South Pacific. The war with Japan ended in August of 1945, and again I was lucky. I was offered a chance to stay in France and go to school. I ended up in Paris studying ‘French Language and Civilization’ at the Sorbonne. This was definitely my best post while in Europe.
After several months, my number came up for transfer back to the States. I was offered a place in Officers Candidate School but going home sounded much better. The trip back to St. Louis was quick and uneventful. I was discharged (no reserve for me) at Jefferson Barracks in south St. Louis.
We were given a duffel with Army clothes, and I received my awards; “Combat Infantry Badge,” “American Theater Ribbon,” “European Theater Ribbon” with three “Battle Stars,” the “Bronze Star Medal” for performance in combat and the “Victory Medal.” Our division received the “Rhin et Danube Medal” and a “Liberation of France Medal.” In April 1947, the second battalion, including Company H, of the 291st Infantry received the Belgian “Croix de Guerre” by a decree of Charles, Prince of Belgium. This honor came as a result of our action in Belgium, during “The Battle of the Bulge.”

I immediately came home to Springfield.
I enrolled in Drury College again in January 1946. After completing that semester, I transferred to Washington University in St. Louis to finish my under-grad schooling. I was accepted into Washington University Medical School in the fall of 1947, graduating with a “Doctor of Medicine” degree in 1951. My schooling at Drury College and Washington University was covered by the “G.I. Bill.” These funds from a grateful country made those five and one-half years of education possible.
Following my Ophthalmology Residency, I returned to Springfield to practice medicine. In 1956 I did the first corneal transplant in Springfield and our office also did the first series of intra-ocular lens implants. In 1987 I volunteered for a month at the mission eye clinic in Sierra Leone on the West Africa coast.
Marie and I were married in May 1956 and had three children: Thomas George (b. 1957), Amy Marie (b. 1959), and Christopher William (b. 1960) and five wonderful grandchildren: Ford and Mac Wesner, Allie and Bryn Prater and Jackson Prater.
Marie and I have traveled back to France and Belgium several times, including a reunion trip to the battlefield areas with our platoon in 1979.
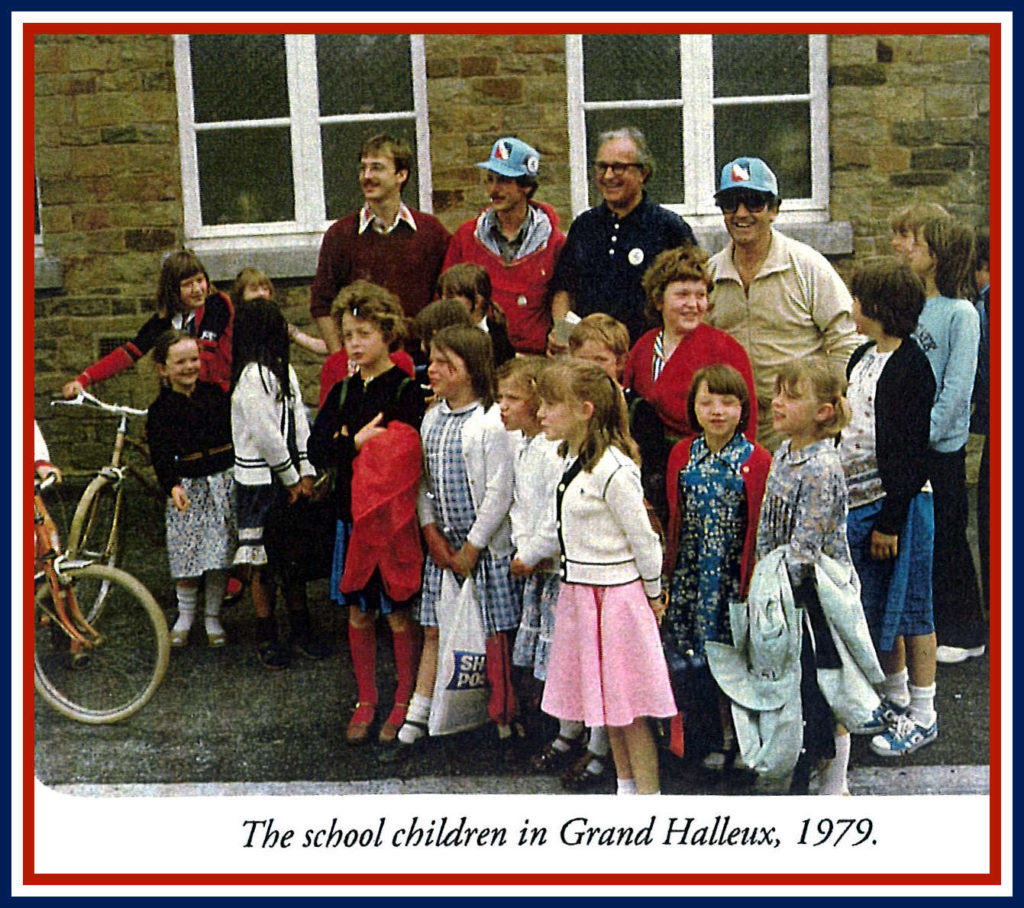
We visited Bastogne, Vielsalm and Grand Halleux, Belgium.
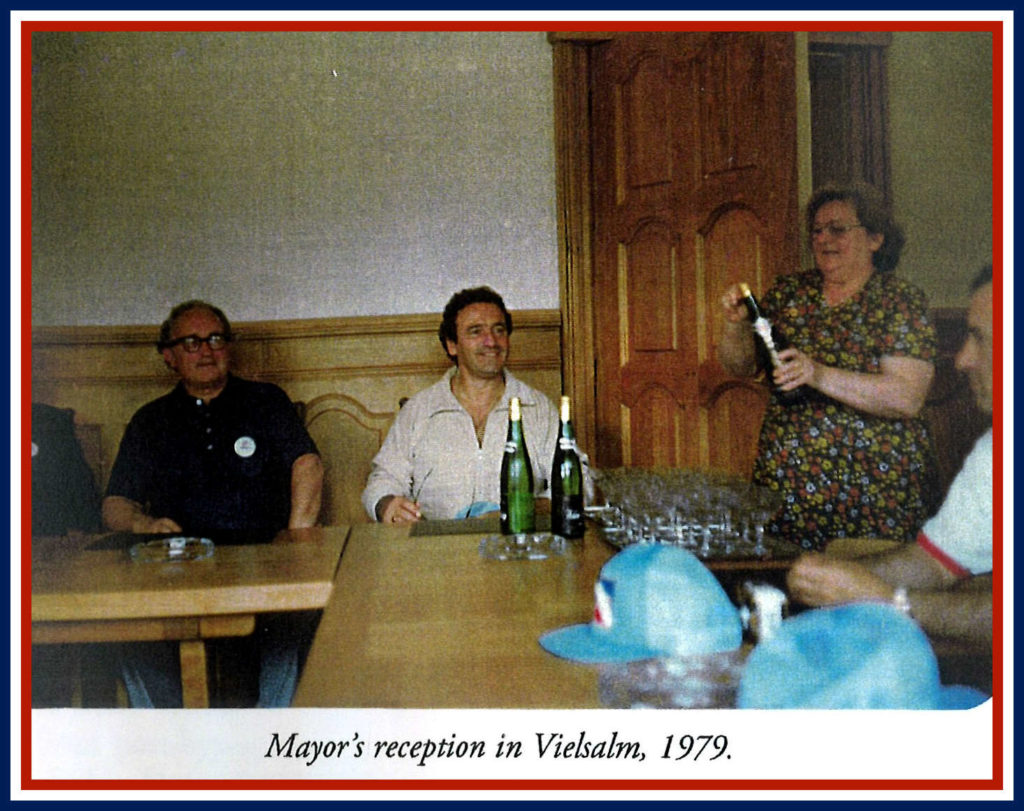
Then we traveled to the Vosges to visit the Thiébaut Family and tour the Colmar area.
Wherever we went, we were always met by the mayor at the Hotel de Ville and offered cookies and champagne, no matter how early in the morning we happened to visit. There were a number of very stirring moments, and the local French people made it a wonderful experience for us.
I enjoy golf, snow skiing, and skeet shooting. Our greatest pleasure has been traveling with our family. Since retirement at the age of 70, we have had five wonderful trips with our children and their spouses; rafting the Middle Fork of the Salmon River in Idaho, a cruise along the Inside Passage to Alaska, a barge trip through Holland during the Tulip Season, a trip to Peru and Chile, and a cruise up the west coast of Norway to above the Arctic Circle. We also enjoy spending time with our grandchildren and have skied with all of them in Aspen in the winters.
EPILOGUE
Dad passed away in 2019 at the age of 94.
He was a remarkable man and much loved by his family and friends.
He didn’t talk much about his time in Europe during World War II until the last few years of his life, but we always knew he came away from his time in the service with a love for France and the French people.
We are thankful that he put together his memoirs to share his experiences.
His son Chris Prater.
Thank you, Mr. Prater, for your commitment and for liberating our country with your comrades…we will never forget you!

Albert « Berry » BAUM 1922 – 1988

Albert BAUM est né le 4 octobre 1922 à Jebsheim (68).
Ses parents Emile Baum et Salomé née Bossert sont de petits agriculteurs locaux. Comme la majorité des alsaciens de leur époque Ils vont changer plusieurs fois de nationalité dans leur vie sans jamais quitter leur village de Jebsheim : nés en 1894 et 1895 sous la première annexion allemande (de 1871 à 1918) suite au traité de Francfort de 1871 après la défaite de l’armée de Napoléon III contre la Prusse (en dédommagement de guerre la France cède à la Prusse l’Alsace et la Moselle) ils deviennent des citoyens français en novembre 1918 à la fin de la première guerre mondiale (traité de Versailles). Après la signature de l’armistice, le 22 juin 1940 avec les nazis, l’Alsace et la Moselle sont à nouveau annexées sans grande résistance de la part du gouvernement de Vichy à ce sujet. Emile, Salomé et toute leur famille deviennent des citoyens du Reich allemand. Il faudra attendre la fin de 4 longues années de souffrance sous le régime nazi pour recouvrer la nationalité française après la fin de la deuxième guerre mondiale (libération de l’Alsace entre fin novembre 44 et mi-mars 1945). Pour cette génération les gens parlent le plus souvent en alsacien qui est un dialecte d’origine germanique (beaucoup de personnes nées entre 1871 et 1918 ne parlent pas couramment le français).
Emile et Salomé ont 3 enfants : l’ainé Alfred né le 19 mai 1921 ; Albert né le 4 octobre 1922 et Lucie la petite dernière, née le 26 avril 1927. Les 2 garçons sont très complices et chamailleurs comme beaucoup d’enfants de cet âge. Pour l’anecdote : un jour leur maman leur donne un sou et les envoie acheter de la levure à la boulangerie pour faire du pain. Sur le chemin les deux se disputent et Albert de rage avale la pièce…les garçons rentrent sans levure, avec l’air coupable et s’attendent à se faire gronder. Amusé par cette situation (Albert s’inquiétait de ne pas digérer cette pièce) la maman en profita pour leur expliquer comment fonctionnait le tube digestif et promit à « Berry » (diminutif d’Albert en alsacien) qu’il allait bien récupérer « naturellement » son sou (ce qui arriva 2 jours plus tard et sa maman après nettoyage lui permit de la mettre dans sa tirelire).

Alfred, le frère ainé est passionné par l’aviation mais décédera subitement d’une méningite aiguë le 25 septembre 1938 à seulement 17 ans. En son souvenir Albert prénommera son fils unique de ce même prénom (encouragé en ce sens par sa maman qui fut terriblement touchée par sa disparition).
Albert alias « Berry » passe plusieurs étés en vacances chez sa tante Anna à Metzeral qui, dans l’impossibilité d’avoir des enfants, reportait toute son affection sur ses neveux et nièces. Il parlait souvent de ses séjours sur les contres-fort vosgiens.
C’est un grand passionné des chevaux Hafflinger (petits et trapus), il aime se promener et les activités en forêt. Comme tous les enfants de son âge il aide ses parents à la ferme tout en effectuant une scolarité exemplaire à l’école communale. Ne parlant quasiment qu’alsacien avec sa famille et ses copains il se débrouille bien en français. Il est sélectionné pour passer le certificat d’études (seulement les 5 meilleurs élèves de la classe). L’instituteur emmène Berry et ses camarades passer l’épreuve à Andolsheim (68), chef-lieu de canton, avec sa charrette. L’examen dure 1 journée : rédaction/orthographe/calculs/sciences et histoire/chant : chant patriotique dont la Marseillaise/ dessin/écriture.

Berry obtient brillamment le Certificat d’Etudes et termine 1er de son canton. Suite à ses résultat l’instituteur conseille à ses parents de l’envoyer poursuivre ses études au collège mais comme souvent à cette époque les parents (avec peu de moyen) décide qu’il travaillera à la ferme avec eux. Afin d’améliorer la situation financière de la famille Albert se lance dans l’activité de débardage en forêt en joignant l’utile à l’agréable puisqu’il le fera avec ses chevaux qu’il aime tant.
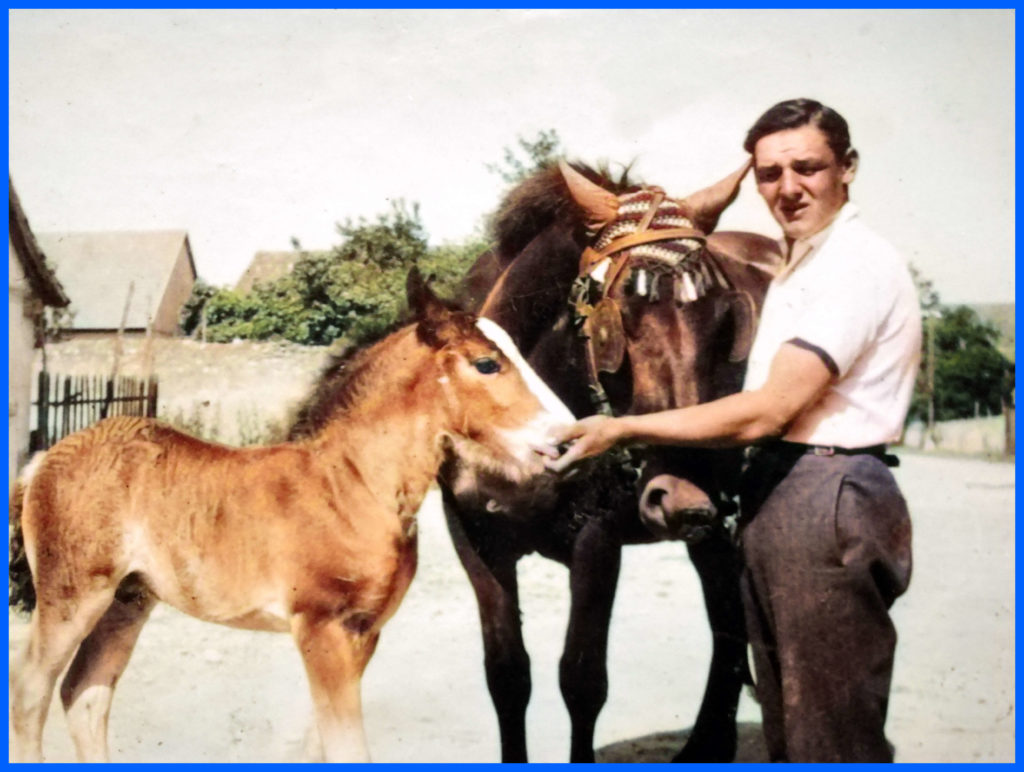
Son activité de débardage (d’abord aux alentours de Jebsheim) l’emmènera jusque dans la vallée de Munster. Il connait tous les chemins forestiers. C’est là qu’il fera connaissance d’un débardeur de la vallée qui n’est autre que le père de sa future épouse Hélène; sur le berceau de laquelle il s’était penché quand il avait 4 ans lors de ses vacances chez sa tante.

Le 1er septembre 1939, veille de la déclaration de guerre de la France à l’Allemagne, la mobilisation française a commencé dès le lendemain : c’est le début de la « drôle de guerre » mais Albert n’est pas mobilisé en raison de son jeune âge (17ans).
Après la défaite de mai-juin 1940 Berry et sa famille subissent le joug nazi comme toutes les familles alsaciennes et mosellanes suite à l’annexion de ces 3 départements par le Reich allemand.
Le gauleiter Wagner, qui dirige l’administration nazi en Alsace a pour objectif de germaniser et nazifier à outrance la région (Hitler avait demandé le 25 septembre 1940 à Wagner de lui annoncer dans dix ans que leurs régions étaient maintenant allemandes et purement allemandes ) : interdiction de parler le français, du port du béret ou tout autre signe distinctif représentatif de la France… sous peine d’être interné au tristement célèbre camp de sureté de Vorbruck-Schirmeck (Sicherungslager); qui est un camp de redressement et de rééducation nazi pour les réfractaire à la nazification de la région (plus de 15 000 hommes et femmes y seront envoyés).
La pression politique et idéologique sur la population alsacienne est quasi à son maximum.
Elle augmente d’un cran en 1941 lorsque le Gauleiter Wagner décrète le Reichsarbeitsdienst (RAD), qui est une sorte de service militaire obligatoire (pour les hommes et les femmes également) et atteint son apogée avec l’incorporation de Force de tous les alsaciens nés entre 1908 et 1927 le 25 août 1942 (idem en Moselle le 19 août 1942). Plus de 100 000 alsaciens et 30 000 mosellans se retrouvent ainsi à porter l’uniforme de l’armée allemande qu’ils n’ont pas choisi (reconnu comme crime de guerre lors du procès de Nuremberg en 1945), et sont envoyés principalement sur le front Russe.
C’est le cas de Berry (classe 1922) qui est incorporé de force sous le drapeau nazi, le 2 décembre 1942, comme tous les jeunes de son village qui ont le même âge. Anti-hitlérien avéré, personne de conviction, Berry part sur le front russe dans l’uniforme de la Wehrmacht, à contre coeur. Il a pensé à déserter ou ne pas se présenter à sa convocation mais le danger pour toute sa famille est trop grand
(Pour décourager les désertions le gauleiter Wagner décrète la Sippenhafft ou « responsabilité du clan » qui en cas de non-respect des dictates nazis engendre immédiatement des représailles contre l’ensemble de la famille dont la déportation).
Il participe à de nombreuses batailles sur le front russe, où il connait des périodes de très grand froid : -54°. Les conditions de vie y sont terribles (dont les poux et les puces qui résistaient à tout). Il dort chez les paysans russes ou dans la neige. Il est palefrenier en chef : c’est lui qui prend soin des chevaux des gradés. Il arrive ainsi à «se faire bien voir » bien qu’il continue à être français à cent pour cent dans son coeur.
Son bataillon finit par quitter le grand froid pour se retrouver au bord de la mer Noire par plus de 35°. L’armée allemande n’a pas beaucoup de nourriture à proposer à ses hommes qui se nourrissent de ce qu’ils trouvent dans les champs et les vignes : du raisin et des pastèques. Berry gardera toute sa vie une profonde aversion pour tout ce qui, de près ou de loin, ressemble à une pastèque ou un melon.
Les hommes sont atteints par la dysenterie et ont de nombreuses diarrhées. Mais Albert garde la foi et son humour : « Ich scheisse Hitler » dit-il à son supérieur. « die Haut » en allemand veut dire « la peau »et le diminutif « Hitler » signifie « petites peaux ». « Chier des Hitler » quand Albert le dit, a une double connotation : évacuer les petites peaux des raisins qu’il mange et en même temps dire tout haut de ce qu’il pense du Führer !!! …mais à ses risques et péril.
Fin d’été 1944, Berry reçoit sur le front russe un télégramme qui lui apprend que son père a été renversé par son cheval et qu’il est gravement blessé : « Vater schwer verunglückt ! ». Avec le soutien de son supérieur il obtient une permission exceptionnelle (suite au débarquement de Normandie en juin 1944 la plupart des alsaciens ne peuvent plus rentrer chez eux en permission par crainte des désertions) pour rentrer à Jebsheim (toujours annexé) et y passer quelques semaines loin du terrible front de l’est.
Emile va plutôt bien. Albert en profite pour se reposer et surtout prendre contact avec la résistance grâce à sa sœur Lucie qui n’a alors que 17 ans !
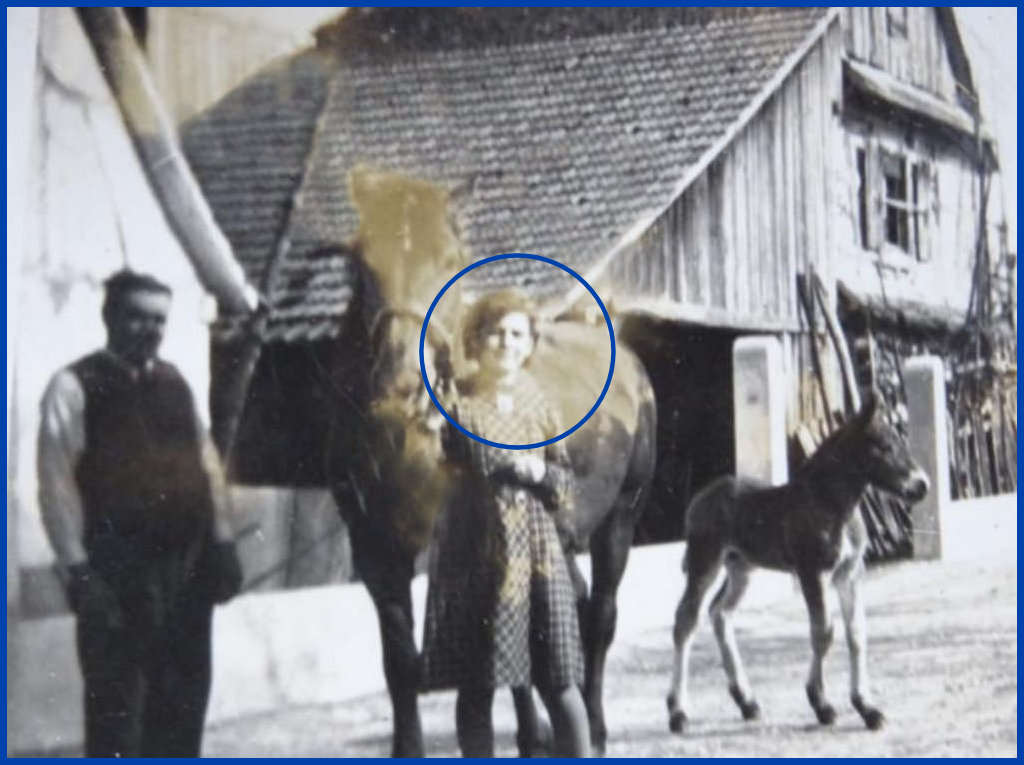
Berry sent que la fin de la guerre est proche. Il est rappelé par l’armée allemande en déroute pour rejoindre le front de l’est. Il quitte l’Alsace en train, envoie une carte postale de Baden-Baden (Allemagne) à sa mère et …saute du train !
Le 28 août 1944 il déserte l’armée du Reich et rentre à pied jusqu’en Alsace où il revient à Jebsheim, mais sans en avertir ses parents (pour les protéger).

Sa sœur Lucie est sa complice. Il rejoint la résistance et les FFI le 28 septembre 1944. Sa grande connaissance des chemins forestiers fait de lui un passeur et un messager hors pair. Bon nageur, il lui arrive de traverser l’Ill (rivière) à la nage en plein hiver.
C’est Lucie qui le cache dans le fenil de la ferme familiale et qui lui donne des provisions. C’est durant ces mois de « cache-cache » qu’il rencontre ceux qui seront ses amis pour la vie : Charles Schwartz et Xavier Meyer. Ces deux jeunes viticulteurs de Husseren-les-Châteaux (68) sont ses compagnons de résistance et plus tard ses compagnons d’infortune.
Le 11 janvier 1945, Berry est caché dans le foin au-dessus de l’étable familiale. Une voix d’homme l’appelle : dans la cour, Lucie est tenue en joug par deux agents de la Gestapo, dont l’un crie : « Ergebe dich oder ich schiesse » (« rends-toi où je l’abats »). Berry a été dénoncé et il se rend pour sauver sa sœur. Il prétendra toujours savoir qui était le traître, mais n’a jamais souhaité dévoiler son nom. Sa soeur Lucie devait également le savoir, mais elle aussi a emporté ce secret dans sa tombe.
L’ensemble du réseau et Berry sont déportés à Dachau (à 17 km au nord-ouest de Munich).

En tant que déserteurs il sont considérés comme des traîtres de l’armée allemande. Encore une fois, sa connaissance des chevaux va lui permettre d’avoir un « poste » privilégié. Mais il est torturé, battu, fouetté : ses escarres ont zébré son dos et il gardera ces marques indélébiles jusqu’à sa mort. Berry a très peu parlé de sa détention mais nous savons que sa position lui permettait de passer par les cuisines des officiers et qu’il en profitait pour chaparder ce qu’il pouvait afin de nourrir ses amis. Ces derniers lui promettent alors d’arroser son futur mariage au vin d’Alsace si jamais ils se sortent vivant de ce cauchemar.
Le 2 février 1945, jour de la libération de Colmar par les troupes françaises et américaines, Berry et ses amis sont condamnés à mort par le tribunal de guerre de Dachau. « Je crois que j’ai pleuré toute la nuit, toutes les larmes de mon corps » disait Berry encore bien des années après la guerre.
Heureusement l’armée allemande est déjà en déroute, c’est le chaos dans le pays et la sanction n’est pas exécutée.
Le 29 avril 1945, le 3e bataillon du 157e régiment de la 45ème Division d’Infanterie de la 7ème Armée américaine libèrent le camp de Dachau.

Malheureusement le calvaire n’est pas terminé pour nos alsaciens. Ils ont combattu sous l’uniforme allemand et sont considérés comme des ennemis par les américains. Ils sont tous enfermés dans des camps de transit, en attendant de pouvoir justifier de leur « nationalité alsacienne » et de leur incorporation de force. Le 5 juin 1945, depuis Augsburg, Berry écrit au crayon de papier une lettre à ses parents et à sa sœur :
Mes chers parents et soeur,
Comme j’en ai l’occasion, j’en profite pour vous donner enfin de mes nouvelles. Je suis en bonne santé ce que j’espère aussi pour vous. Je me trouve dans un camp de prisonniers américain et suis l’ordonnance auprès du bureau des officiers. Nous n’avons pas encore entendu parler de libération, nos papiers d’identité ayant été détruits en prison. Comme je peux l’imaginer, vous avez dû passer de nombreuses nuits blanches depuis que je vous ai quittés. C’était pareil pour moi. J’ai été condamné à mort et il s’en est fallu de peu de jours que la sanction ne soit exécutée, mais tout est fini maintenant. Pour le travail, vous faites comme vous pouvez : je ne pense pas être à la maison pour les fenaisons mais au moins pour la moisson.
Je vous salue et vous embrasse votre Berry.
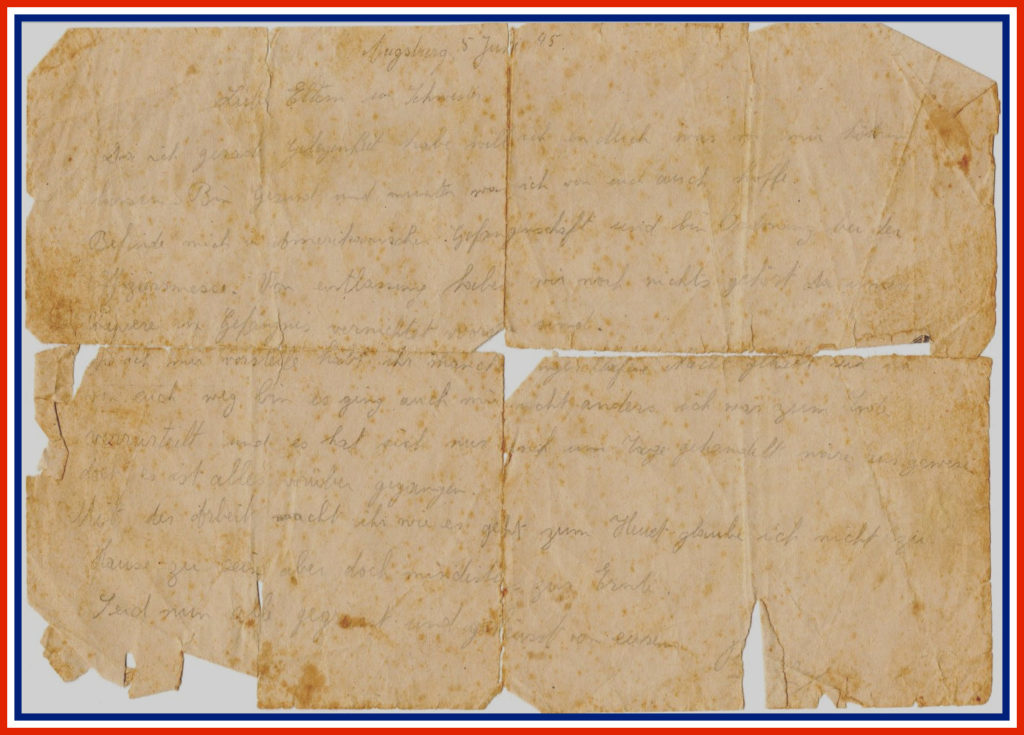
Albert est enfin rapatrié le 7 juillet 1945 et ne pèse pas plus de 50 kg…il n’a pas encore 23 ans !
NB : Sur les 100 000 alsaciens et 30 000 mosellans, enrôlés de force dans l’armée allemande, les « Malgré-Nous », 32 000 d’entre eux ne sont pas rentrés à la fin de la guerre : 24 000 sont morts ou portés disparus et 8 000 dans les camps russes dont le tristement célèbre camp de Tambov.
Ceux qui sont revenus, resteront à tout jamais marqués par cette jeunesse qui leur a été volée et les souffrances endurées !
De cette triste période, Berry, comme beaucoup d’incorporés de force, ne souhaite conserver aucune photo ou document et les brûle à son retour de captivité, car ils lui rappellent de trop mauvais souvenirs.
Après son retour les blessures physiques et surtout morales vont mettre du temps à s’estomper. Berry, décide d’oublier et ne va évoquer que très rarement cette période de sa vie. Il reprend sa vie d’agriculteur et de débardeur, ses sorties avec ses chers chevaux, ses rencontres avec les amis qui lui restent dont Charles Schwartz et Xavier Meyer qui eux aussi ont eu la chance de revenir de l’enfer !

Entre moisson et débardage, entre vaches et chevaux, Berry trouve le temps de tomber amoureux. Il retrouve la petite Hélène de Metzeral qui a bien grandi et qui est devenue une jolie jeune femme de 21 ans. Pour la retrouver, Berry n’est pas paresseux : il n’a pas de permis de conduire et pas de voiture…Metzeral est à 38km de Jebsheim. Alors pour voir son amoureuse, il prend sa bicyclette. Tous les samedis, après une journée aux champs, il enfourche sa monture et pédale jusqu’au fond de la vallée de Munster.

De son vivant Berry adorait raconter ses exploits : en été, après avoir passé la journée à la « Dreschmachin » (l’ancêtre de la moissonneuse batteuse), à transporter des sacs de blés de plus 50kg, depuis la machine, jusqu’au grenier à grains via des escaliers abrupts, il se lavait au savon de Marseille au « schepfbruna » (la pompe à bras), à l’eau froide. Puis il prenait sa bicyclette, pour aller flirter et danser car le samedi soir, c’était souvent bal populaire dans les villages. Les danseurs pouvaient virevolter jusqu’au petit matin, prendre un bon petit déjeuner, lacer leurs chaussures de marche et partir randonner sur les hauteurs vosgiennes. Et tout ça, sans dormir ! Après une journée de marche et quelques baisers partagés, Berry reprenait sa bicyclette pour retourner dans la plaine. Il lui est arrivé une fois, de s’endormir en pédalant et de se réveiller dans le fossé avec son vélo en guise de couverture !
En novembre 1947, Hélène et Berry se marient en l’église de Metzeral. Le repas des noces à lieu à Jebsheim. Il fait un temps magnifique pour une fin novembre : plus de 20 degrés et les hommes sont en manches de chemises ! Comme ils l’avaient promis, Charles et Xavier, les deux viticulteurs de Husseren-les-Châteaux(68), font acheminer des tonneaux de vin par charrette. Les invités se déplacent en bus. Ceux de la vallée sont logés chez les habitants de Jebsheim. Jeunes gens et jeunes filles dorment dans les fenils. Ils vont tous faire la fête pendant trois jours. De nombreuses idylles sont nées lors de ce mariage et les liens entre plaine et vallée se sont encore renforcés !

De cette union vont naître successivement Christiane (2 juin 1947), Marguerite (6 janvier 1949), Alfred dit « Freddy » (22 janvier 1950) et la petite dernière Myriam (14 octobre 1961).

Berry travaille aux champs et la famille agrandie vit chichement. En 1961 pour améliorer les conditions matérielles de sa famille Albert décide de travailler également à l’usine Hild de Jebsheim.
Tout au long de sa vie Berry, en tant que président des anciens combattants, milite pour la reconnaissance de la nation du sacrifice et de la souffrance des incorporés de force et rencontre à ce sujet plusieurs fois André Bord (Ministre et ancien réfractaire et résistant alsacien) et Edmond Borocco (député et ancien résistant alsacien).

Berry part en retraite anticipé à l’âge de 56 ans mais il ne va pas profiter longtemps, auprès de sa chère et tendre Hélène de celle-ci. Il décède malheureusement le 22 février 1988 à Colmar, à l’âge de 66 ans, des suites d’un cancer du foie foudroyant (Le 30 janvier, il était encore en forêt pour faire son bois de chauffe).

Nous remercions chaleureusement Myriam, sa fille, qui nous a mis à disposition l’essai autobiographique de son père (et sa famille) qu’elle a écrit en 2021 afin de partager cette Histoire au plus grand nombre et rendre hommage à son père et tous ceux et celles de sa génération qui ont été happés par les évènement tragiques de 1940 à 1945 pendant l’annexion de notre région par le régime nazi .
Nous laissons à Myriam Stoffel le mot de la fin :
« Pour que nos enfants et petits-enfants, n’oublient jamais
que leurs aïeux se sont battus pour un idéal d’identité,
et pour le pays qui était le leur, La France.
Pour que nos enfants et petits-enfants, n’oublient jamais
que leur liberté d’aujourd’hui, est au prix des combats menés
par des hommes et des femmes comme leur arrière grand père.
A mon père,
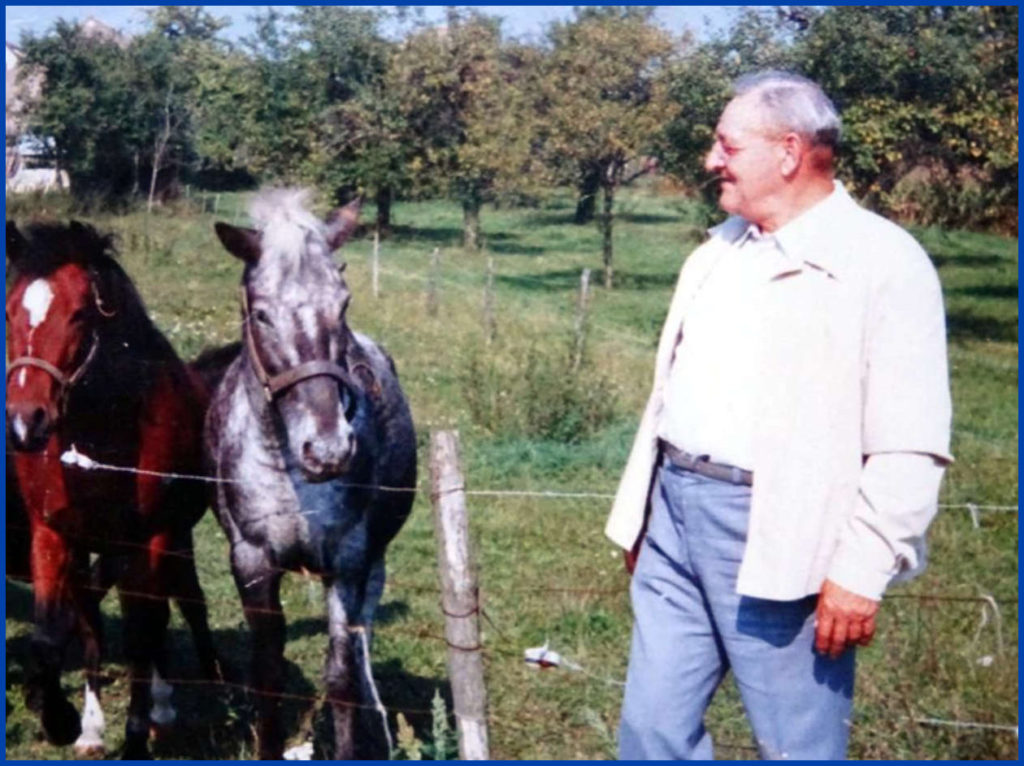
Henri André BOUCHARD 1919 – 2009

André est né le 4 juin 1919 à Alger en Algérie où en dehors de ses études il passe son temps libre sur les courts de tennis…
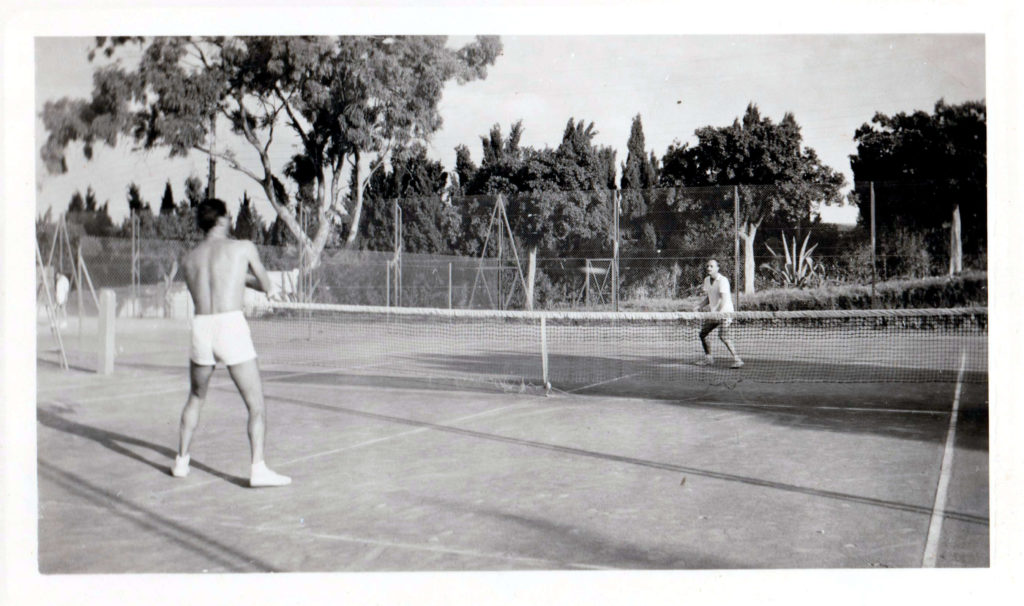
…la plage et se promène dans « Alger la Blanche », surnom de la capitale algérienne en raison de ses nombreuses maisons blanches où il fait bon vivre.
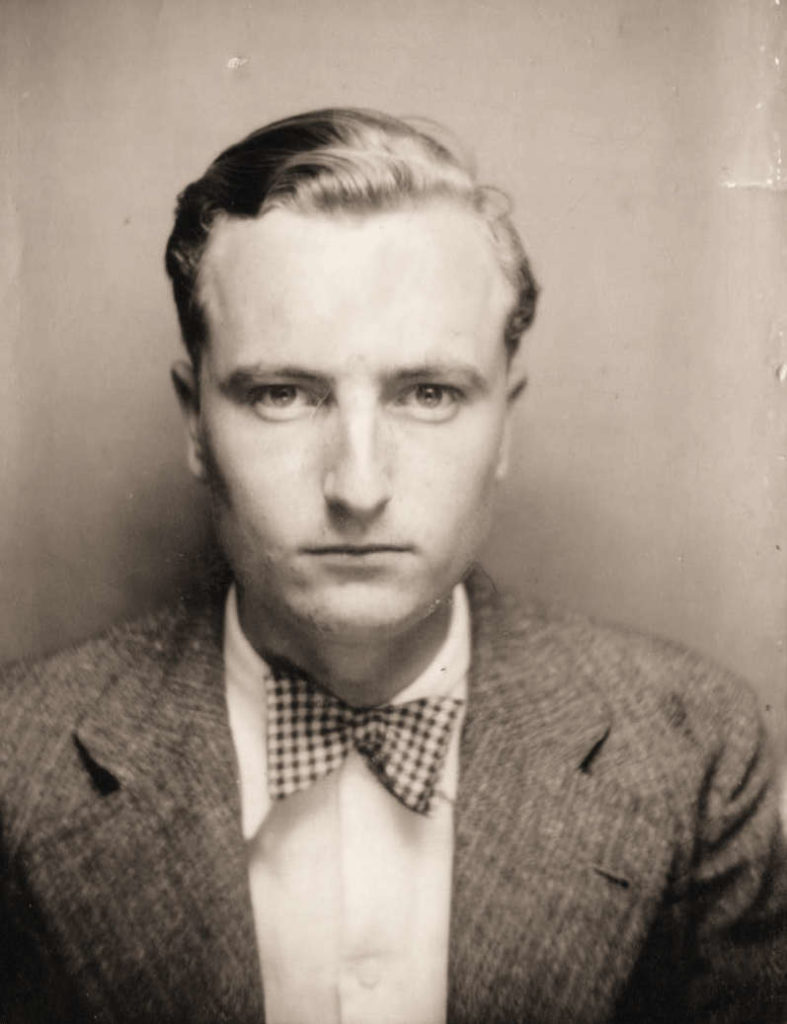
Employé de bureau en 1939 il est « classé armé » par le conseil de révision d’Alger et est appelé à l’activité (service militaire) au 9ème Régiment de Zouaves (9ème RZ) le 15 novembre 1939.

Il arrive au 9ème Zouaves le 27 novembre 1939.

A compter du 16 mars 1940 il est nommé au grade de caporal puis le 1 juin sergent.
Il est dirigé en renfort sur la Tunisie le 6 juin 1940 et affecté au 59ème Bataillon de Pionniers mais la défaite éclair de la France l’empêche de rejoindre la métropole pour combattre. Il rentre de Tunisie le 12 juillet 1940 et rejoint son unité en Algérie le 21 août 1940.
Nommé sergent-chef le 16 avril 1943 il embarque à Alger le 14 décembre 1943 et débarque en Corse, à Ajaccio le 17 décembre 1943.

Il quitte la Corse à Calvi le 10 septembre et met pied à terre sur les plages de Saint-Raphaël le 13 septembre 1944 où commence réellement pour lui sa participation à la libération du territoire national en tant que chef de groupe des éléments d’observation et de reconnaissance du régiment.

Le 2 novembre 1944 le Capitaine John R. Bond de L’US Army lui délivre un titre de propriété où l’on peut lire :
« Cette jeep est la propriété du 9ème régiment de zouaves (france) qui n’a pas de marquage français car elle vient d’être reçue à Marseille. Le nom du chauffeur est Bouchard du 9ème Zouaves. » signé John R. Bond, Capt. Ord. Dept Americans.
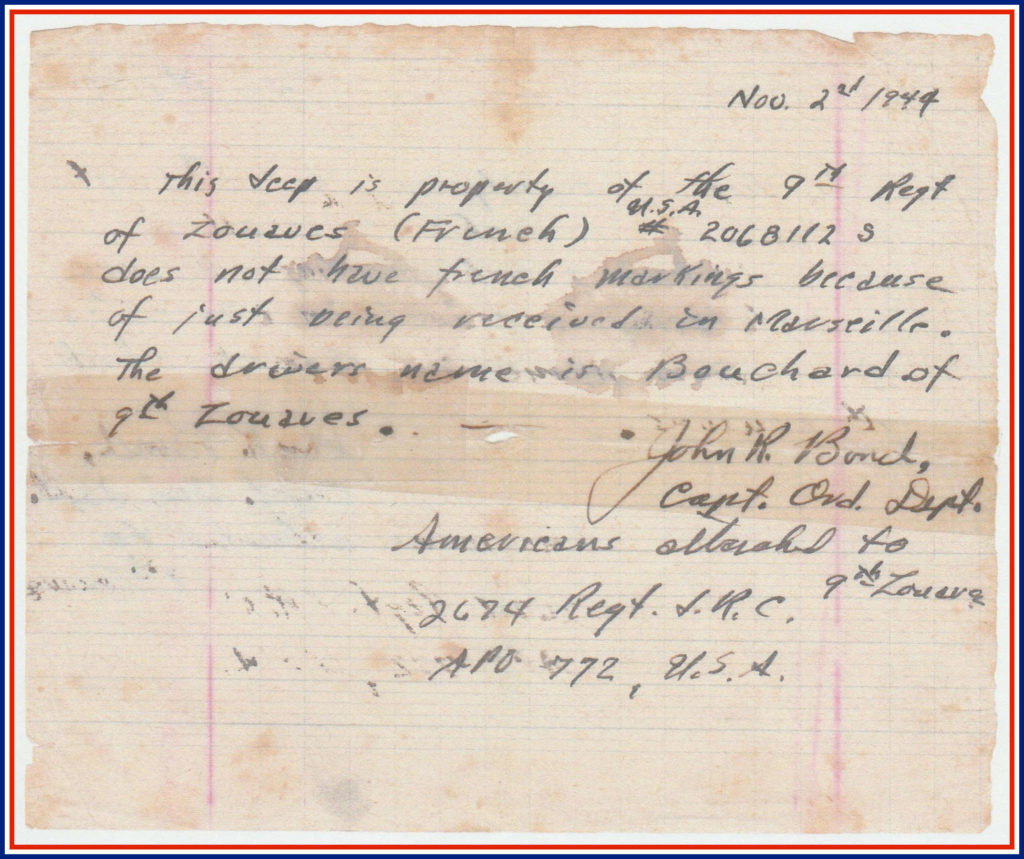
Les zouaves du 9ème RZ participent dans le département du Doubs vers la frontière suisse à une suite de combats acharnés et enlèvent de haute lutte le village de Roches-les Blamont le 16 novembre 1944, puis la ville d’Hérimoncourt le 17 novembre 1944.
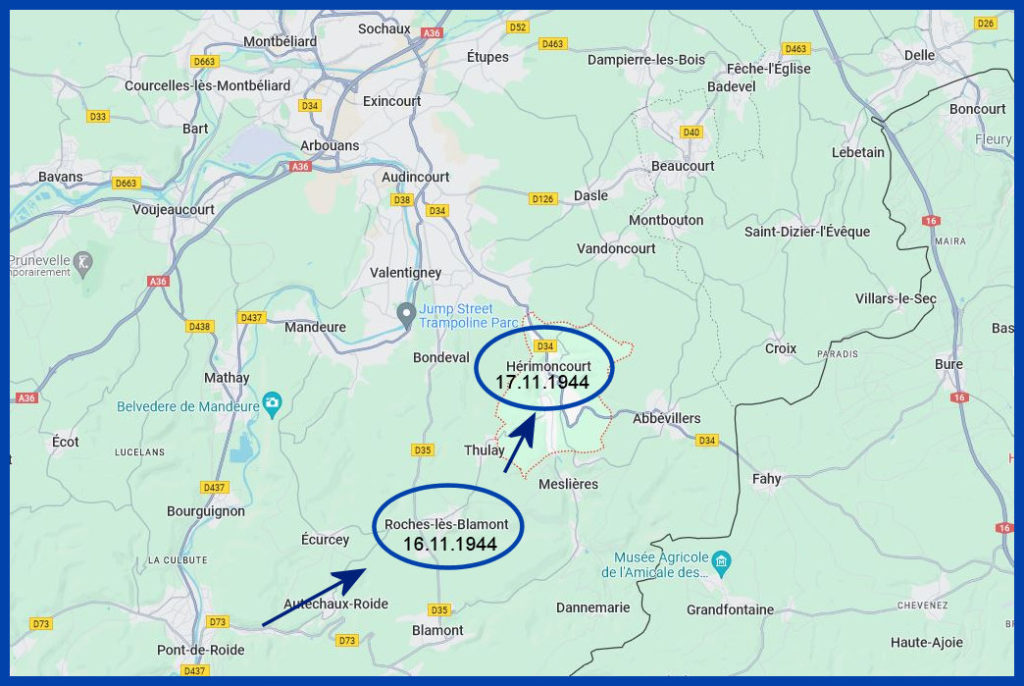
C’est au cours des combats pour libérer Hérimoncourt que le Capitaine FRIANG trouve une mort glorieuse au champs d’Honneur en étant tué par un éclat d’obus (Mort pour la France). Il est le beau-frère d’Henri Bouchard et sert au 2ème bataillon de ce même régiment. D’après le témoignage du fils d’André Bouchard, sa perte fut un coup très dur porté au moral de son père. De nos jours une rue porte son nom dans la ville d’Hérimoncourt; sa fille Claude Moracchini (1928 – 2021), a longtemps assisté aux commémorations en son Honneur, est à présent enterrée auprès de lui pour l’éternité.

Dans le secteur de Mulhouse de décembre 1944 à janvier 1945, le régiment entre à nouveau en action dans le secteur du col de la Schlucht début février et libère Munster le 5 février 1945.

Le 9ème RZ franchit le Rhin le 29 mars 1945 à la hauteur de Karlsruhe. Après les combats pour prendre la ville, le régiment bouscule le dispositif ennemi en Forêt-Noire at après d’âpres combat prend la ville de Baden-Baden puis entre avec les troupes françaises dans Stuttgart. Le 1 mai 1945 il est sur les bords du lac de Constance à Bregenz.
C’est lors d’une reconnaissance au sud de Karlsruhe, qu’André Bouchard est blessé grièvement lors de cette campagne d’Allemagne, le 7 avril 1945, dans le quartier de Aue (commune de Durlach) où avec son copilote et leur officier installé à l’arrière du véhicule, ils furent pris à parti par une arme automatique (mg.34 ou 42). Pour la petite histoire ils n’étaient pas dans leur jeep mais ils avaient « emprunté » une belle décapotable allemande. L’officier installé sur la banquette arrière fut blessé mortellement et le passager avant s’en sortit indemne grâce au sang-froid d’André Bouchard malgré ses blessures.
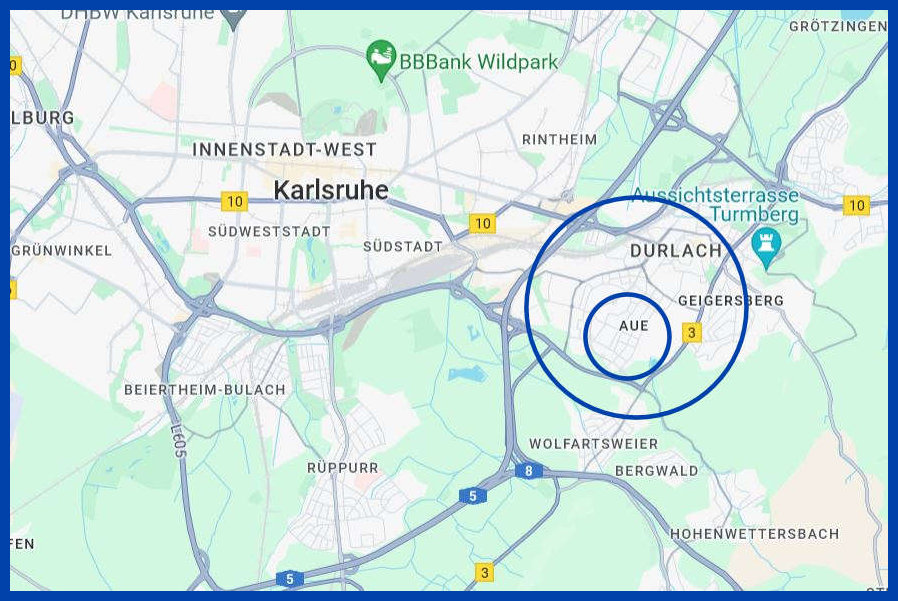
Pour son action le 7 avril 1945, il est cité par le général de Lattre à l’ordre du Corps d’Armée :
« Sous-officier observateur, conducteur d’une jeep transportant un officier établissant une liaison avec un Bataillon détaché du Corps, a fait preuve d’un sang-froid remarquable, le 7 avril 1945 à Haue, sud de Karlsruhe. Blessé par rafales d’armes automatiques, a eu la présence d’esprit de changer d’itinéraire et le courage d’assurer la conduite de son véhicule. A ainsi sauvé la vie d’un sous-officier qui l’accompagnait ».
Cette citation est accompagnée de l’attribution de la Croix de Guerre 1939-1945 avec étoile de Vermeil.
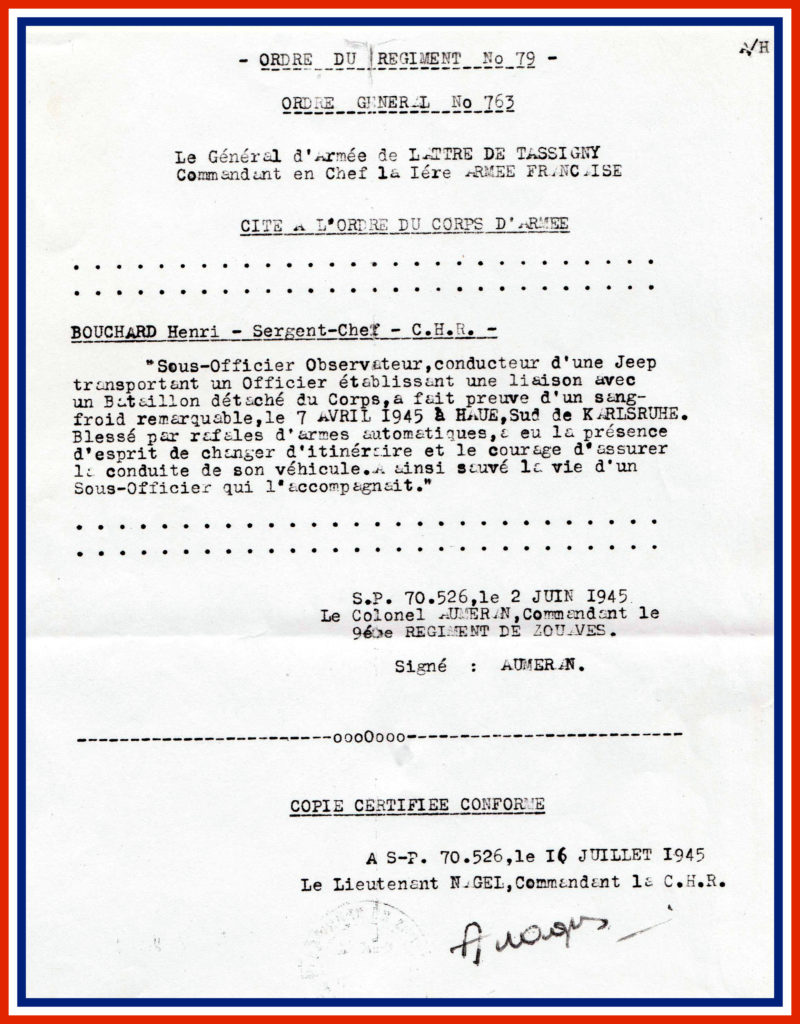
Blessé grièvement à la jambe (deux fois) avec une atteinte du nerf sciatique (d’après les médecins il n’aurait jamais dû remarcher) il est rapatrié en France après son opération pour effectuer sa convalescence à Vichy. Une fois remis sur pied il profite d’une permission pour aller à Paris avant de rentrer chez lui à Alger.
Il est démobilisé et rayé des contrôles de l’armée le 10 novembre 1946.
Il est titulaire de :
la Médaille Militaire
la Croix de Guerre 1939-1945 avec étoile de Vermeil
la Médaille des blessés

Après guerre commence une nouvelle vie pour André en tant que technicien (chef de travaux) dans une entreprise de travaux public.
En 1947 il se marie à Alger avec Paule LAJOUS (née en Tunisie).
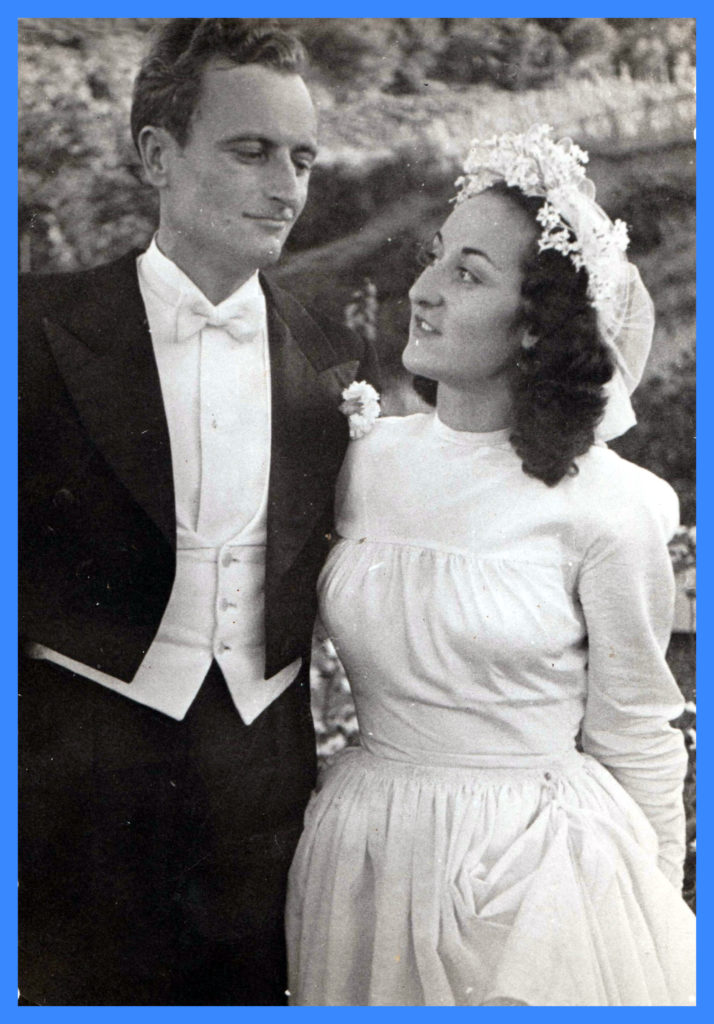
Il se rapproche de la métropole suite au rachat en 1950 par son beau-père d’une usine dédiée à l’automobile à Compiègne (60).
La famille s’agrandit avec les naissances de Jean-Marc en 1950 et Didier 1951 en Algérie. André Bouchard crée une société d’import export de pièces automobiles sur toute l’Afrique du nord. Sur la demande de son beau-père ils s’installent finalement à Compiègne en 1960 pour intégrer le directoire de l’usine. C’est dans cette ville que nait son troisième fils Henri en 1962.
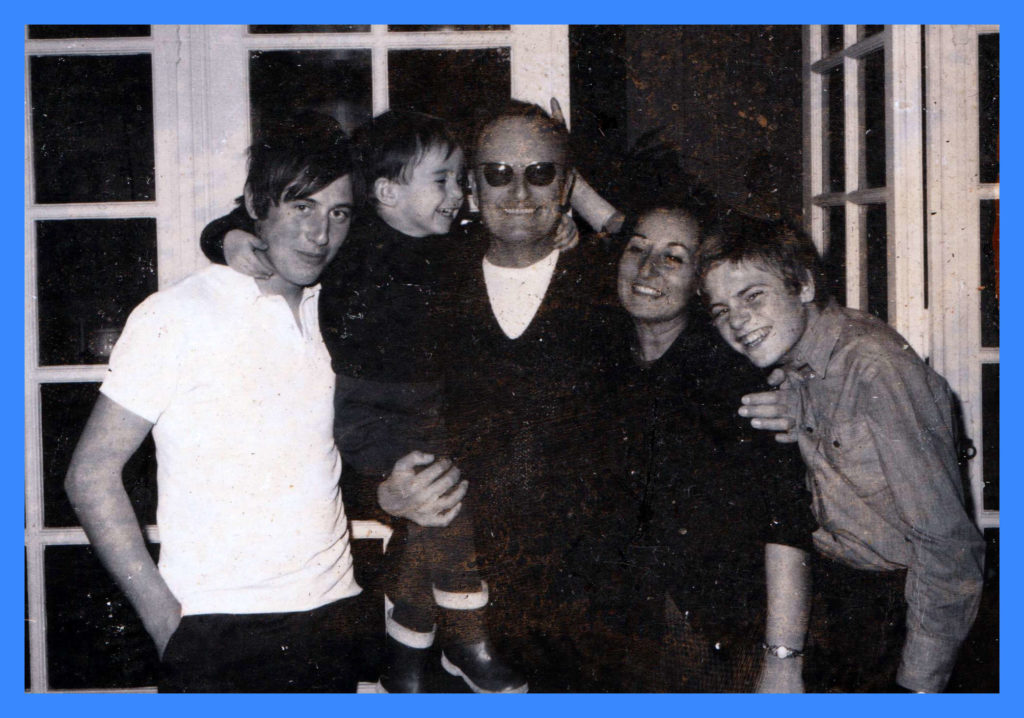
Suite à des différents au sein de cette entreprise André Bouchard achète une concession automobile Ford à Soissons (02) à la fin des années 60 et la dirigera jusqu’à sa retraite dans les années 80. Il passe une retraite tranquille sur SOISSONS auprès de sa famille et ses proches (loin du soleil méditerranéen de sa jeunesse).

Après une vie bien remplie et pleine de rebondissements il décède dans sa 90ème année le 10 mars 2009 à Soissons (02). Sa très chère épouse le « rejoint » le 11 mars 2019, 10 ans après lui jour pour jour (ils étaient mariés ensemble pendant 62 ans).

Nous remercions sincèrement son fils Henri pour la confiance accordée et le partage de ses archives familiales.
En complément :
Lors des campagnes de France et d’Allemagne de septembre 1944 à mai 1945 le 9ème RZ compte 230 tués.
Par ce portrait nous rendons hommage à nos libérateurs dont André Bouchard et ses camarades du 9ème Régiment de Zouaves qui ont « payés » un lourd tribut afin que nous puissions jouir pleinement de notre liberté. Nous ne les oublierons pas.
En complément, un document très intéressant conservé par André Bouchard : une note de service n°87 estampillée « secret » du 9ème Régiment de Zouaves émise le 24 décembre 1944 suite aux agissements du commando SKORZENY pendant la bataille des Ardennes.
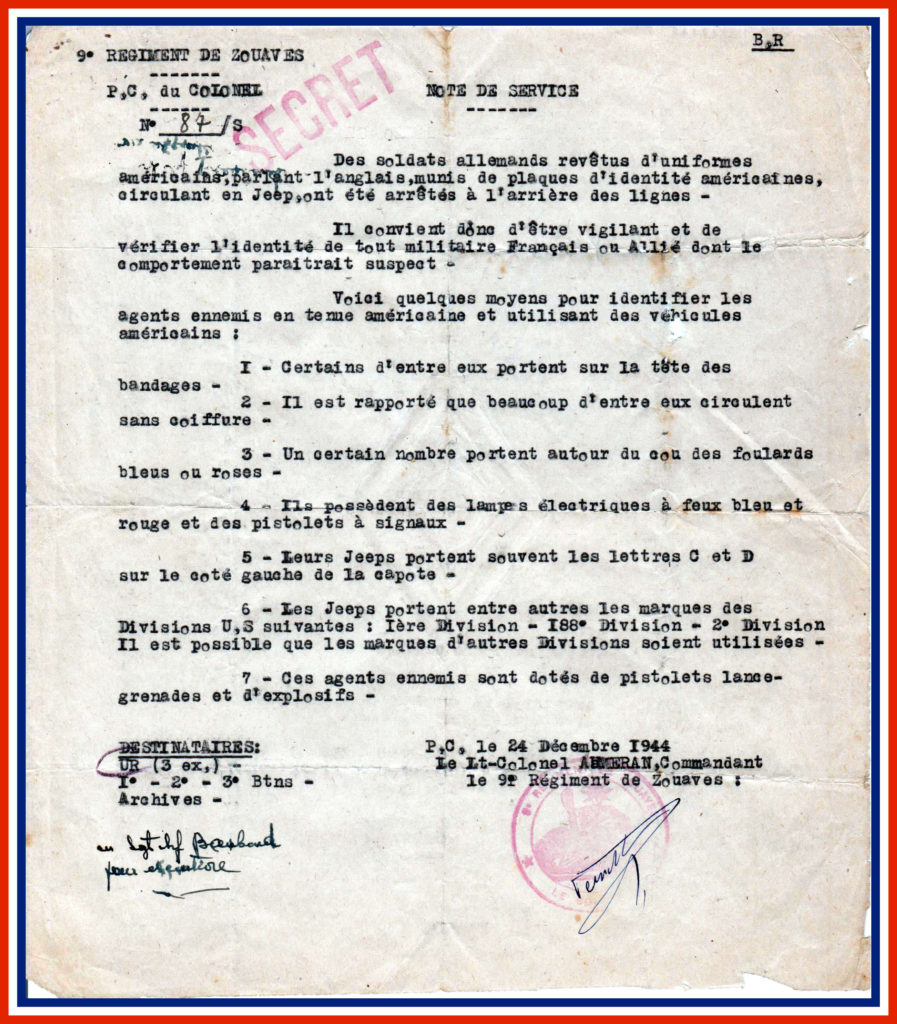
Guy GUIONNET 1922 – 2016
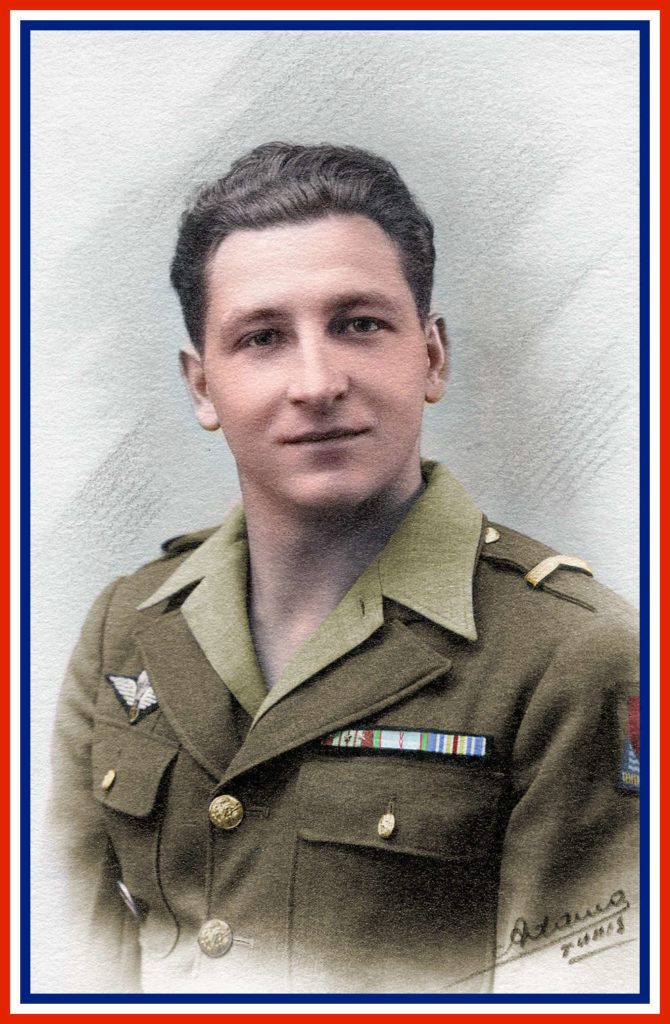
Nous remercions Henri Simorre, grand spécialiste du Bataillon de Choc pour les informations et photos mises à disposition pour la rédaction et l’illustration de ce portrait.
Si l’Histoire du bataillon de Choc vous intéresse : https://1erbataillondechoc.forumactif.com/
Henri SIMORRE 1923 – 1946
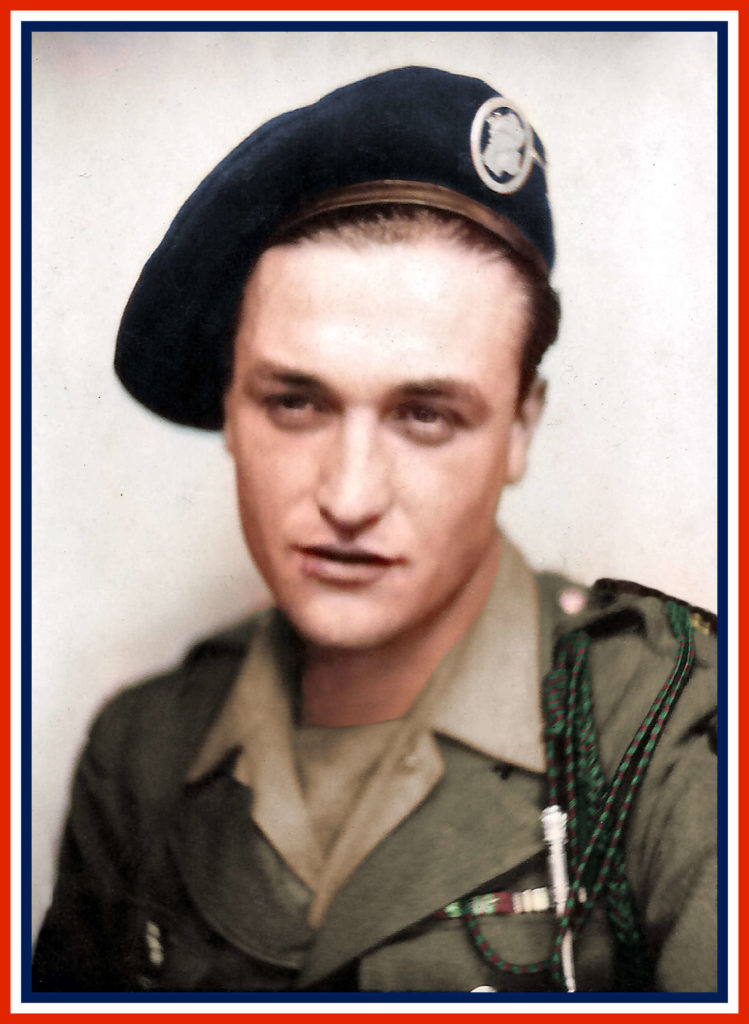
Il est né le 15 juillet 1923 à Arzens dans le département de l’Aude.
Sa dernière carte d’identité civile datée du 26 octobre 1940 nous indique qu’il est étudiant et que c’est un grand gaillard qui mesure 1,83m (à 17 ans).
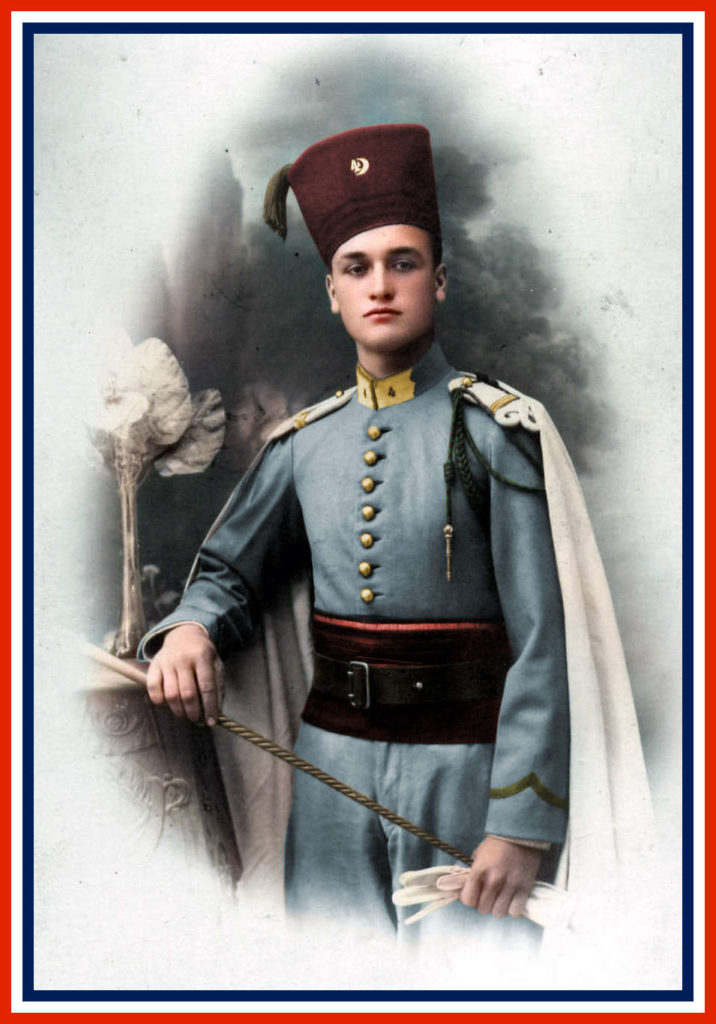
Engagé volontaire au 4ème Régiment de Chasseurs d’Afrique à Tunis en juillet 1941, il est muté au 4ème Escadron à cheval (les 2 premiers escadrons sont motorisés).
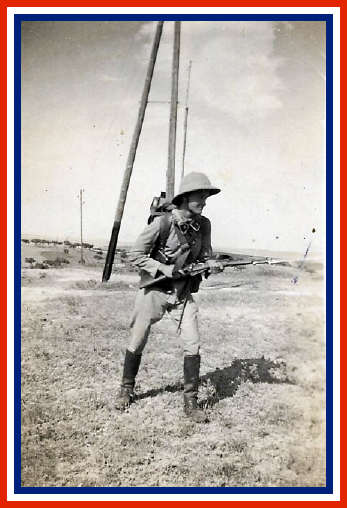
Il combat les Allemands le 19 novembre 1942 à Medjez el Bab en Tunisie ; où il sauve la vie à son chef de groupe, en allant le chercher au péril de sa vie sous le feu ennemi. Après ces combats il se retrouve à Casablanca au Maroc en août 1943 puis Meknès en mars 1944.
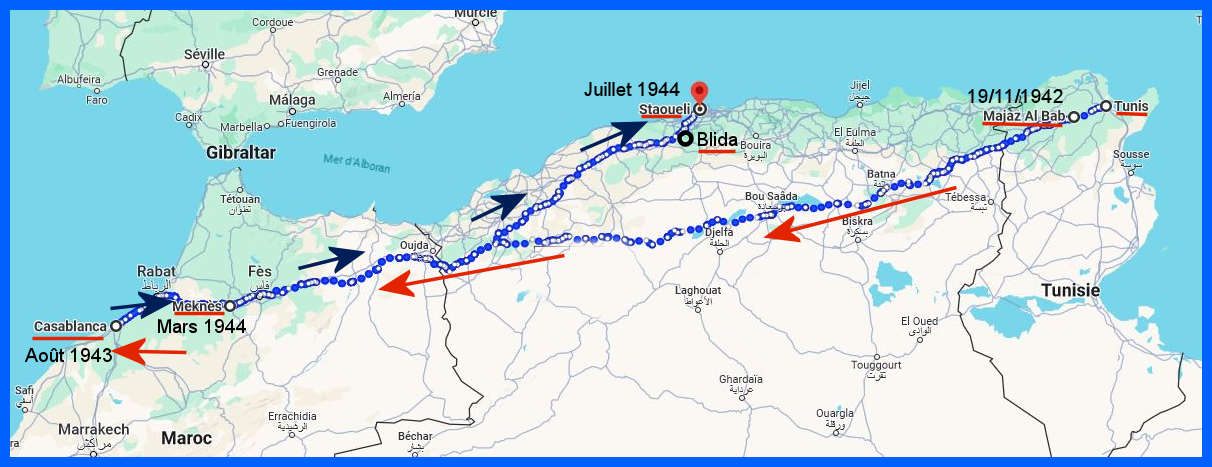
Il rejoint en juillet 1944 le Centre d’Organisation Spécial de Staouéli en Algérie où sont formés les commandos de France et les renforts du Bataillon de Choc.

Le sergent Simorre obtient le brevet para US le 30 août 1944 à Staouéli.

Il a effectué ses sauts entre Sidi-Ferruch et la mer, les avions décollant de Blida.
Il touche enfin le sol métropolitain en Provence le 12 septembre 1944 et il rejoint ses camarades du Bataillon de Choc près de Dijon.
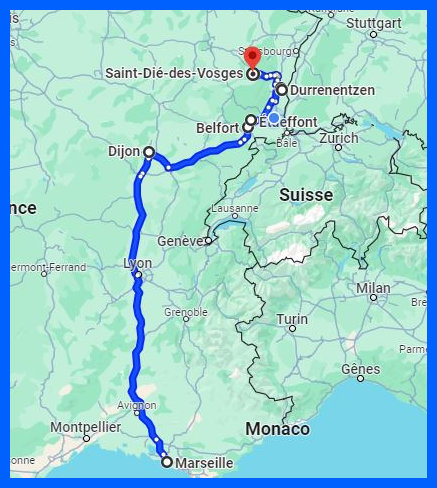
Il est muté dans la 1ère section de la 4ème Compagnie avec laquelle il participe aux âpres combats des Vosges et à la libération de Belfort et obtient la médaille de Belfort décernées par la ville.

Il obtient sa première citation à l’ordre de la Division avec Croix de Guerre 1939-1945 et étoile d’argent, à Ettuefont, à 20 kms de Belfort, lorsqu’il se dirige vers l’Alsace :
« Jeune sous-officier qui a rejoint le Bataillon pour participer aux opérations de Belfort les 20 et 21 novembre 1944, au cours desquelles il a pris son groupe en main et fait preuve de beaucoup de cran sous le feu et d’endurance physique. Le 24 novembre 1944, au cimetière d’Etueffont a efficacement appuyé du feu de ses armes, l’attaque par surprise d’un convoi ennemis dans la région du col du Hundsruck, a tenu pendant toute la nuit un poste avancé et conservé le contact avec l’ennemi ».
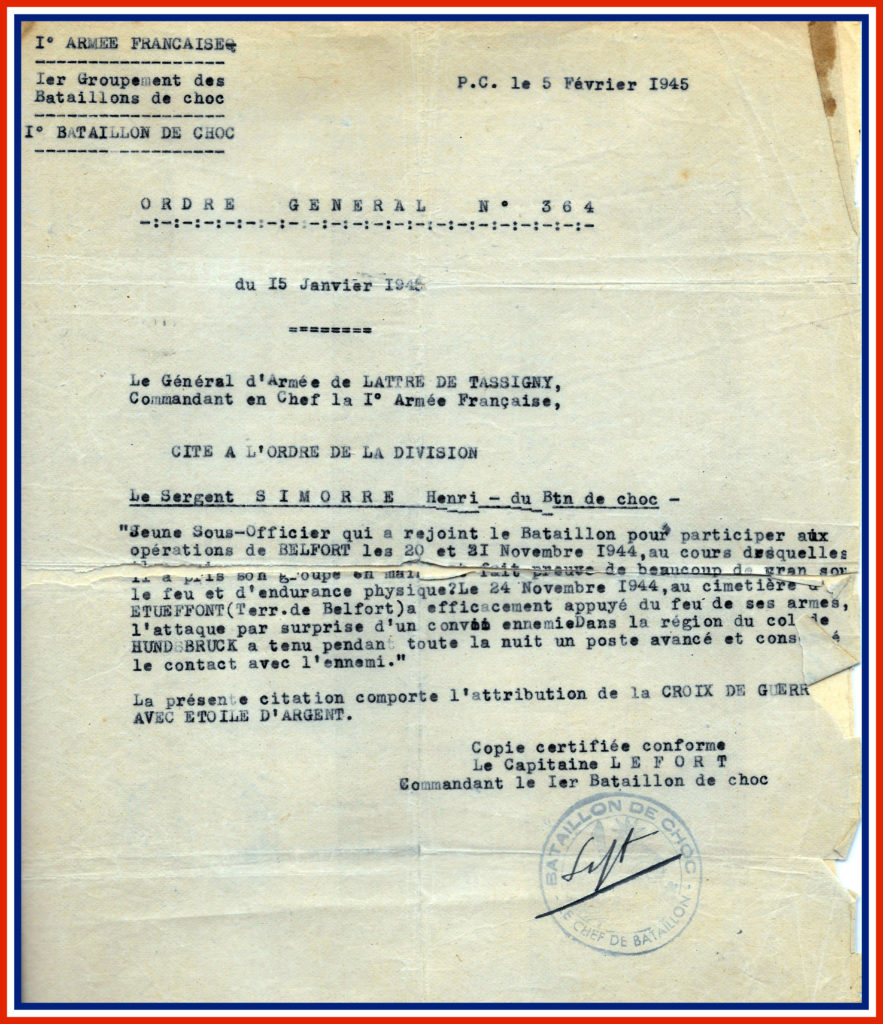
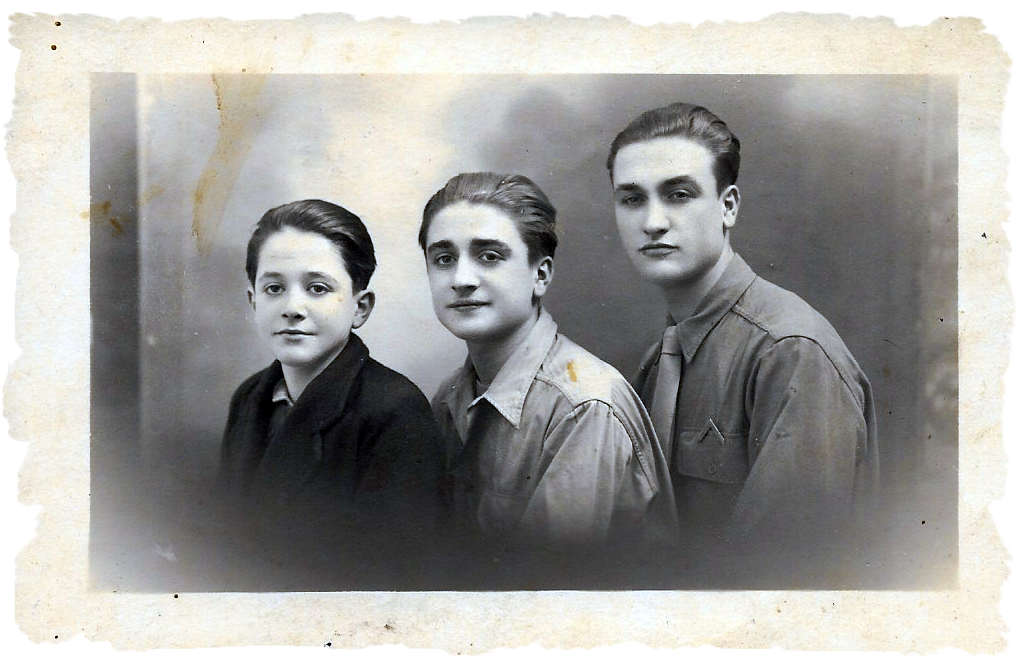
Lors de la campagne d’Alsace il se distingue à Jebsheim(68) et à Durrenentzen(68) où il est blessé par éclats, d’une roquette de panzerschreck, à la tête, au bras gauche et au mollet le 1er février 1945.
Pour ses faits d’arme il est cité une deuxième fois; à l’ordre de la Brigade avec Croix de guerre 1939-1945 et étoile de Bronze :
« Jeune sous-officier courageux et plein d’allant déjà confirmé lors des précédentes opérations auxquelles il participa avec le Bataillon de Choc, vient de nouveau de prendre une part active à la prise de nuit du village de Durrenentzen(68) le 1er février 1945 âprement défendu par l’ennemi. A été blessé alors qu’il enlevait son groupe à l’assaut d’un pâté de maisons fortement tenu ».
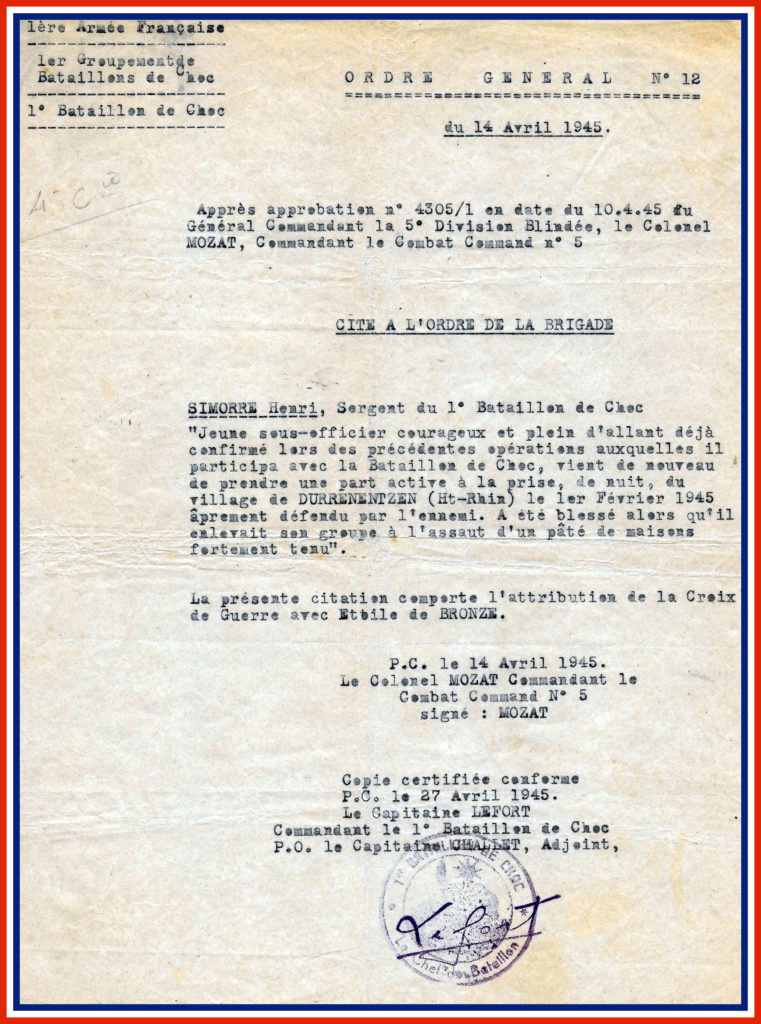
Il est évacué dans les Vosges sur Saint-Dié où se trouve l’un des hôpitaux de campagne de la 1ère Armée française. Après son opération il est transféré à Montpellier pour sa convalescence.
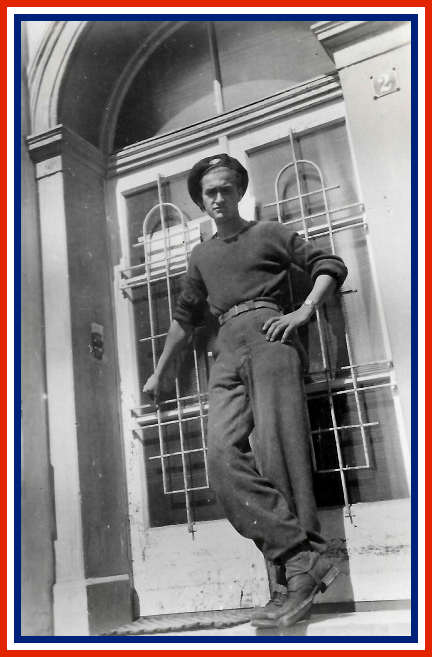
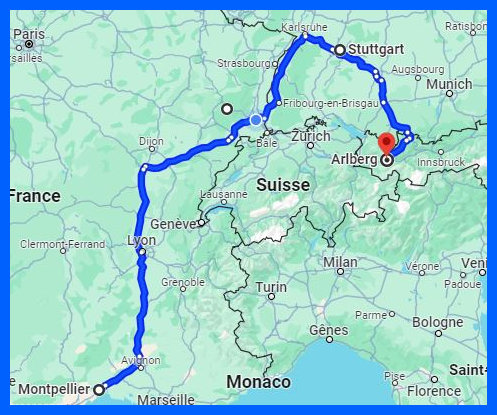
Il rejoint le 1er Bataillon de Choc le 12 avril 1945 pour participer à la campagne d’Allemagne où il obtient pour sa bravoure une troisième citation; à l’ordre du Bataillon avec Croix de guerre 1939-1945 et étoile de Bronze, le 15 avril 1945 :
« Chef de groupe audacieux et volontaire. Le 15 avril 1945 à 1 heure au soir s’est porté volontairement à la reconnaissance du village de neuweiller (Wurtemberg). A su par son infiltration audacieuse et intelligente s’approcher à 5 mètres de la sentinelle ennemie placées à la deuxième maison de ce village. A rejoint nos lignes sans se dévoiler à l’ennemi et rapporter le renseignement demandé ».
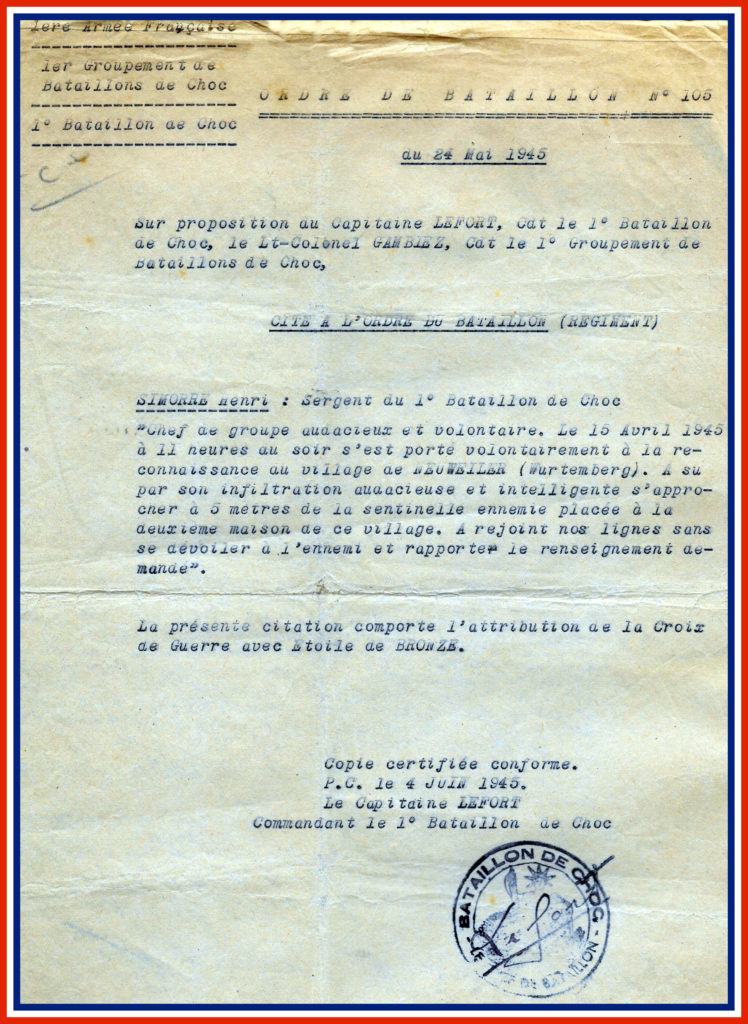
Le 8 mai 1945 il termine victorieusement la guerre avec le 1er Bataillon de Choc en Autriche au sommet de l’Arlberg.
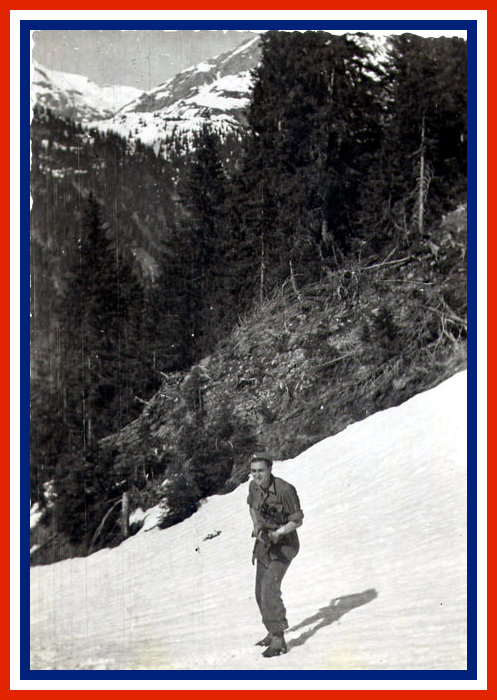
Après la seconde guerre mondiale les différents Bataillons de Choc sont regroupés et deviennent le 1er Régiment d’Infanterie de Choc Aéroporté (1er R.I.C.A.P.). Le 1er RICAP rentre en France le 2 décembre 1945 au Camp de La Palu à Bordeaux (33) construit par les Allemands au nord de la base sous-marine en 1942.

Il est muté au 2ème Bataillon de Choc S.A.S. d’Extrême-Orient à Mont-de-Marsan (landes) le 5 Mars1946. Il obtient son brevet Parachutiste français le 27 mars 1946 à Pau.
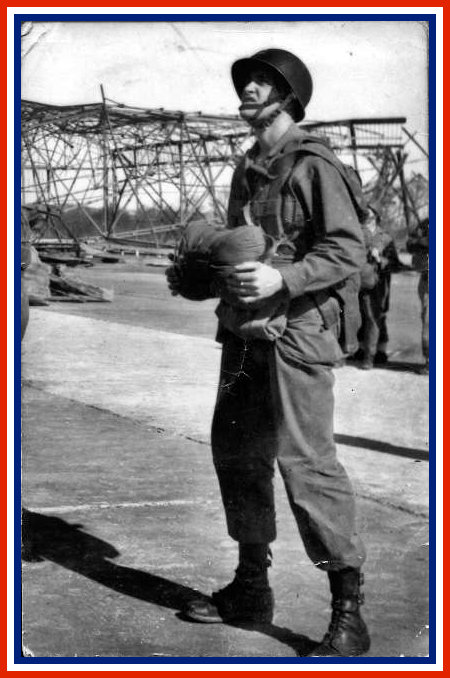
Il embarque sur le paquebot « Ville de Strasbourg » pour l’Indochine le 13 mai 1946 et débarque après 1 mois de voyage à Saïgon (Hô chi Minh-ville) le 20 juin 1946. Il est nommé au grade de sergent-chef le 1er juillet 1946.


Le 18 juillet 1946, 3 jours après ses 23 ans, de retour d’opérations, la barge de la marine qui ramène son groupe de combat vers Saïgon, dans le secteur de NHA-BE, chavire….c’est le drame !

Avec son adjoint le Sergent Congues, Henri Simorre tente de sauver ses hommes de la noyade mais malheureusement il disparait avec eux (ils sont 6) dans les eaux troubles de la rivière qui serpente à Saïgon.
Seul le corps du Sergent Congues est retrouvé plusieurs jours après et est identifié grâce à son briquet aux armes de la ville de Pau qu’il avait toujours sur lui.

Ainsi disparaît accidentellement le Sergent-Chef Henri SIMORRE en voulant sauver ses hommes…il venait d’avoir 23 ans.
Par décret du 17 janvier 1947 il est décoré, à titre posthume de la Médaille Militaire et de la Croix de Guerre des Théâtres d’Opérations Extérieurs avec Palme :
« Sous-officier d’élite dont le courage et l’allant lui valent 3 citations élogieuses au cours des campagnes de France et d’Allemagne. Dès son arrivée en Indochine il attire l’attention sur lui par son mordant, son calme, son entrain. Le 2 juillet 1946 à APp-Nhay il entraine son groupe à l’assaut d’une résistance rebelle, abat le chef de groupe adverse au moment où ce dernier ouvrait le feu et fait 5 prisonniers. Le 3 juillet 1946 dans la région de Phu-an-Thon il met en fuite un groupe ennemi et s’empare d’un dépôt de munitions. Le 18 juillet 1946 au retour d’une opération dans le secteur de Nha-Be où il s’était à nouveau distingué, l’embarcation qui portait son groupe ayant chaviré au cours de la remontée de la rivière de Saigon, il se porte au secours d’un de ses hommes en péril, le soutient jusqu’à la limite de ses forces et disparaît avec lui. Héritier des plus belles traditions du soldat français, entraîneur d’hommes hors de pair admiré par ses hommes, estimé par ses chefs, aimé de tous, restera au Bataillon un vivant exemple de droiture et de dévouement poussé jusqu’au sacrifice ».
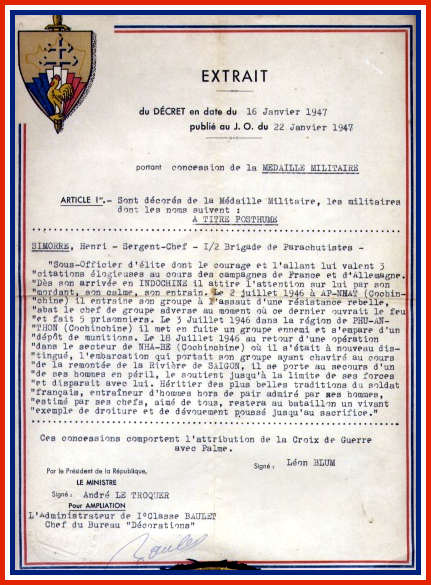
Nous le remercions sincèrement pour son engagement au service de la France et avons une pensée émue pour nos anciens combattant qui nous ont libéré du joug nazi.
Décorations :
Médaille Militaire à titre posthume,
Croix de guerre 1939-1945 avec 3 citations,
Croix de Guerre des Théâtres d’opérations extérieurs (T.O.E) avec Palme
Médaille des blessés,
Médaille Coloniale avec agrafe TUNISIE 1942/1943,
Médaille commémorative 1939-1945 avec agrafes « Engagé Volontaire – Afrique – Libération – Allemagne » à titre posthume.
Médaille commémorative Indochine à titre posthume.




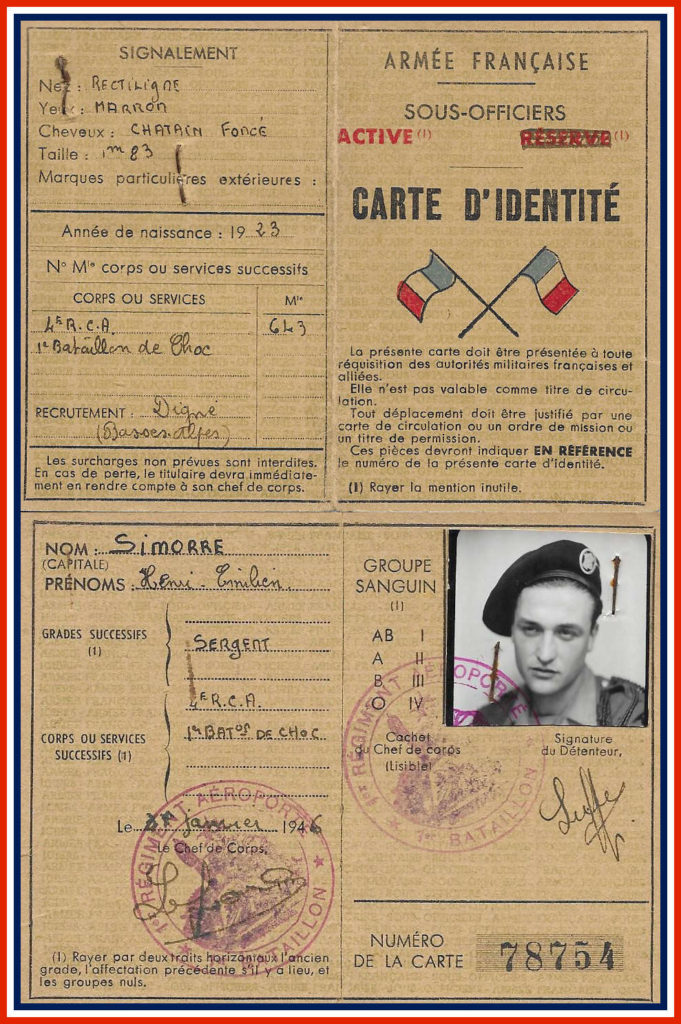
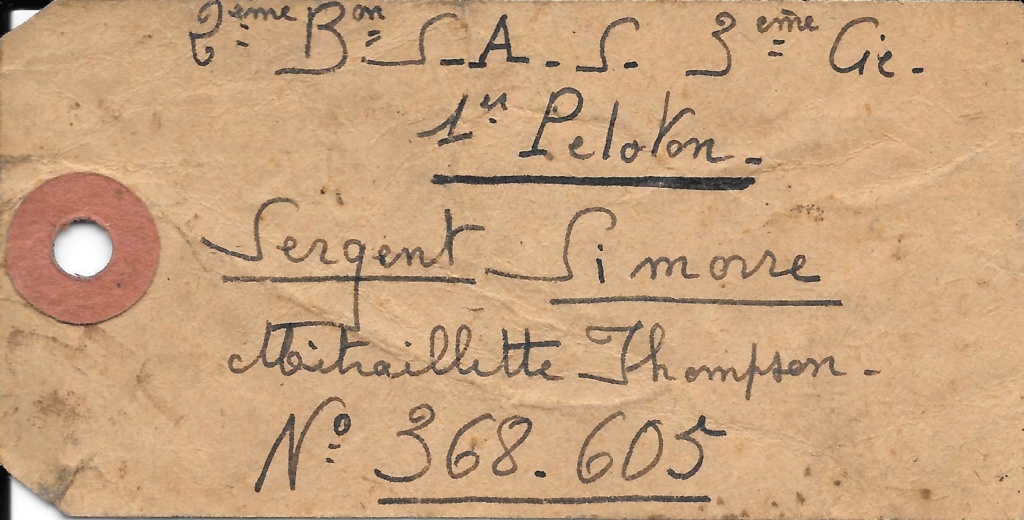
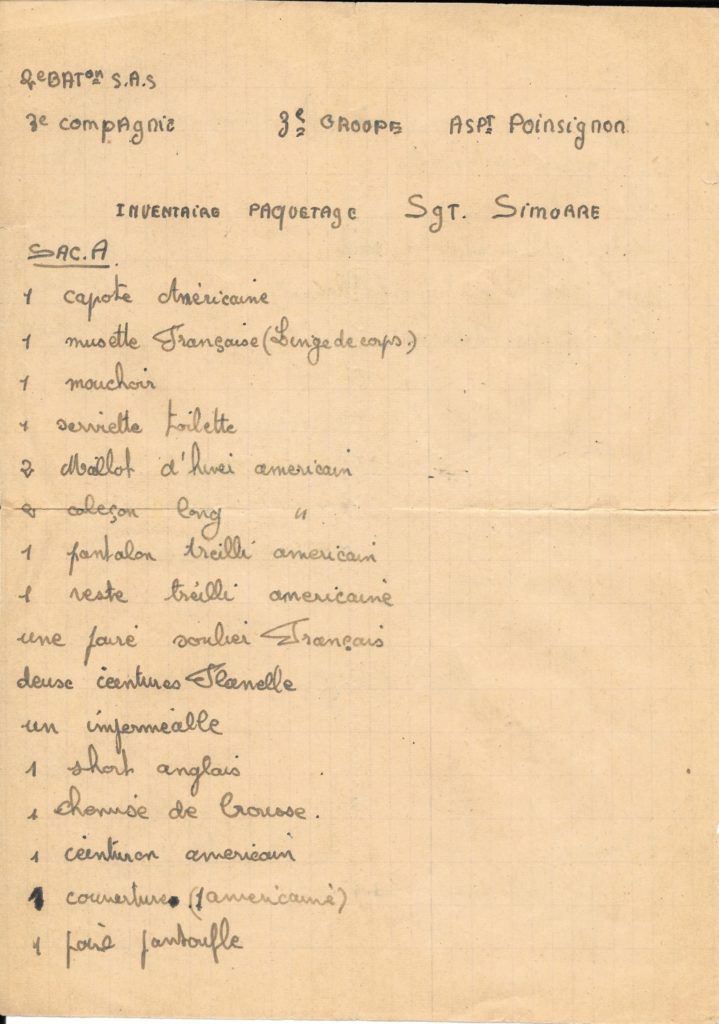
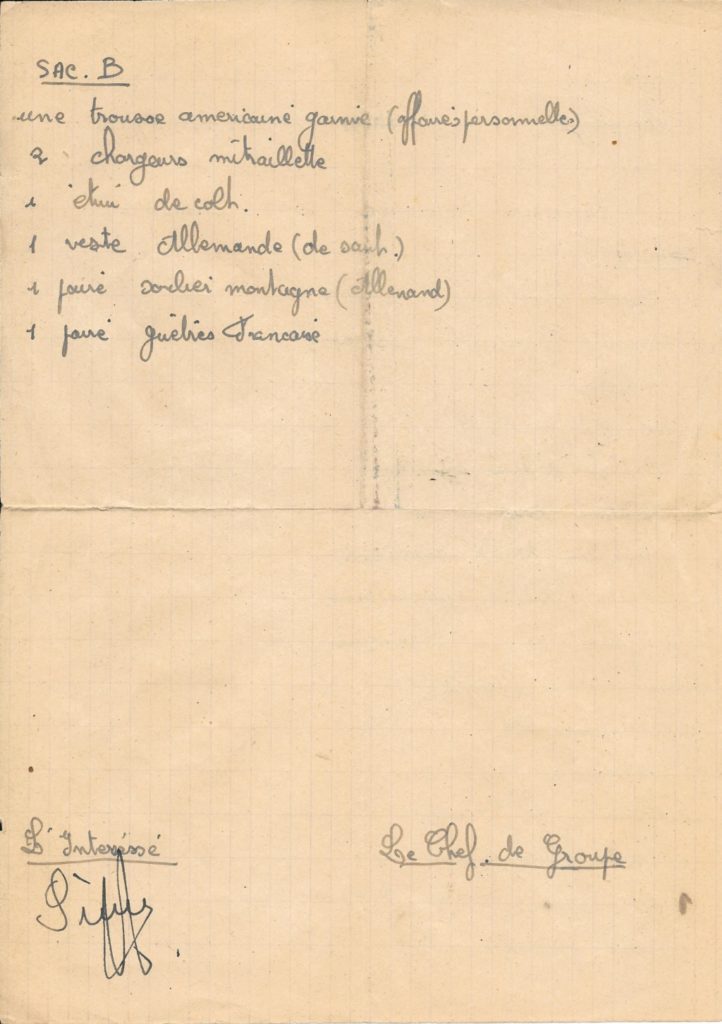
Nous remercions sincèrement son neveu prénommé Henri également(en son hommage), grand Ami du Musée Mémorial et fin connaisseur du Bataillon de Choc, pour le partage de son histoire familial et de ses archives personnelles.
pour en savoir plus sur le Bataillon de Choc : https://1erbataillondechoc.forumactif.com/